Clinique
de
l’action culturelle scientifique
Brouillon de travail
Version du 15 octobre 2005,
Olivier Las Vergnas
o.lasvergnas@noos.fr
Précaution liminaire :
Les lignes qui suivent proposent le regard clinique d’un praticien impliqué dans l’animation et la médiation scientifique depuis un peu plus de trois décennies. Au delà de mes propres actions ou engagements, elles font fréquemment référence aux opinions et écrits de nombreux autres acteurs, décideurs et observateurs. Si la posture choisie dans ce texte conduit par principe à s’interroger – a posteriori – dans la durée sur les questions de cohérence et de persévérance, il doit être compris que l’intention n’est jamais de mettre en cause telle ou telle personne physique. Bien au contraire, nous pensons que les acteurs et auteurs cités ici se sont tous engagés et impliqués dans leurs projets et écrits avec une fougue qui force le respect, mais que chacun d’entre nous se heurte systématiquement à un contexte social, économique et culturel de nature à faire dériver les plus nobles intentions, affaiblir le plus grand enthousiasme ou fragiliser le plus intéressant des programmes d’action. Ce ne sont donc pas les personnes qui sont à mettre en cause, mais bien le contexte dont on ne prend souvent conscience qu’à posteriori, en observant ethnologiquement des bégaiements de l’histoire contemporaine.
A.1. Des professions de foi récurrentes
A.1.1 Des rapports qui se répètent
En France, de nombreuses personnalités politiques [1] déplorent aujourd’hui une « désaffection » pour les sciences et appellent de leurs vœux le développement de politiques nationales de « diffusion de la culture scientifique et technique » qu’ils qualifient « d’enjeu national ». Ainsi, à l’été 2003, le Premier Ministre affirmait-il qu’une telle diffusion devait être capable de « nouer ou de renouer le dialogue entre la société et les sciences, … [de] contribuer à réduire des inégalités et des fractures au sein de la société, … [constituant] un moyen essentiel d’affirmer une citoyenneté forte» [2]. Quelques mois plus tard, un rapport du Sénat rappelait que « chaque année, à l'occasion de l'examen des crédits de la recherche inscrits au projet de loi de finances, [la] commission des affaires culturelles attire l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité, cruciale pour notre pays, de promouvoir sur l'ensemble de son territoire une véritable politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ». Le rapport Hamelin rédigé à la demande du Premier Ministre expose quant à lui qu’ « Il convient de constater la faiblesse du socle commun de connaissances scientifiques, ce qui est d’autant plus grave puisque cela constitue aujourd’hui l’une des principales fractures sociales ».
Ces discours se révèlent similaires de multiples autres tenus périodiquement depuis plusieurs décennies, comme le rappelle l’encadré n°1 consacré à ces bégaiement de notre histoire culturelle. Ainsi, lors des Etats généraux de la culture scientifique et technique, mis en place par le gouvernement en 1989, tenait-on déjà des propos proches : « l’appropriation collective de cette culture est, dans notre société, un facteur essentiel de sa compétitivité économique, de sa cohésion sociale, de ses chances de rayonnement industriel et de sa démocratie » [3] , en préconisant d’ailleurs les mêmes solutions.
Encadré 1 : bégaiement de l’histoire des rapports sur la culture scientifique
Il est d’ailleurs facile de montrer que ce type de déclaration s’enchaînent régulièrement à la suite de multiples commandes d’organismes publics et ce au moins depuis le début des années 80 : En 1981, Yves Malécot publiait pour la DATAR un rapport intitulé « culture technique et aménagement du territoire, pour un réseau de centres régionaux » qui préconisait que de tels centres devraient remplir une double mission du conservation du patrimoine industriel et technique et de promotion de la science contemporaine ; en 1883, Michel Crozon (et al.) publiaient « l’animation culturelle scientifique et technique en France 1960-1980 » pour le Ministère de la Culture ; Il fut suivi à l’occasion d’un imposant « Programme mobilisateur interministériel : pour la culture scientifique et technique » par Bernard Maitte qui produisit à la demande du « Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle » justement mis en place par le dit-programme mobilisateur, le rapport institutionnalisateur des CCSTI.
Il serait fastidieux de poursuivre ici et de citer exhaustivement la dizaine d’études et professions de fois similaires qui peuplèrent les deux dernières décennies, mais très instructif de trouver un thésard qui aurait le temps de chercher corrélations et causes entre ces différents cycles de bégaiement de l’histoire. Il est frappant en tout cas qu’aucun de ces multiples auteurs n’ait cherché dans cette voie : « celui qui voudra s’en tenir au présent à l’actuel ne comprendra pas l’actuel » disait déjà Michelet.
On pourrait arguer qu’ils s’agit là de rapports officiels et quel malheureusement ce type de documents sont naturellement d’une faible pérennité et peu accessibles aux publics. Or, ces propos ne se répètent pas seulement dans des textes vite inaccessibles. On relira avec intérêt les cahiers du Groupe de l’iaison pour l’action culturelle scientifique (GLACS) ; parues à partir de décembre 1974, elles seront bientôt disponibles en ligne grâce au laboratoire « Communication, Culture et Société » (Université de Lyon II et ENS Lsh) à l’adresse http://sciences-medias.ens-lsh.fr/scs/rubrique.php3?id_rubrique=125 et les premiers ouvrages publiés dans la collection « science ouverte » dirigée par J.-M. Levy Leblond au Seuil. Citons par exemple, en plus de propres ouvrages de ce dernier (« L’esprit de sel » et « (Auto)critique de la science »), les deux essais de Philippe Roqueplo « Le partage du savoir » et « Penser la technique » parus respectivement en 1979 et 1982, dont la relecture produit un intéressant effet de miroir à 25 ans d’intervalle.
Certes, en terme de politiques nationales, on constate sans doute les mêmes bégaiements dans bien des domaines. Politique pénitentiaire, déficit de l’assurance maladie, organisation des urgences, de l’orientation scolaire, des réseaux de transport… … Les rapports sur la nécessité d’un grand réseau autoroutier en France sont fréquents, mais au moins, il s’en construit vraiment. Pour le Ferroutage, la situation est moins claire. Sans doute par ce que les enjeux économiques sont plus obscurs. En serait-il de même pour la culture scientifique et technique ?
Pourquoi ces prises de position se répètent-elles ? Est-ce parce que la « désaffection pour les sciences» ne se réduit pas, voire s’aggrave ? Chercher la réponse à cette question, conduit à analyser les données sur lesquels les dits rapports se fondent et les solutions qu’ils préconisent. Et là, surprise ! Force est alors de constater qu’ils prennent plus la forme de professions de foi que d’études étayées. D’une part, ils ne cherchent pas à établir de constats précis de la prétendue « désaffection » [4] et d’autre part, ne s’intéressent pas à l’analyse de l’efficacité des actions déjà mises en place.
A.1.2 Moins d’intérêt pour les constats que pour les préconisations
Ainsi, les trois rapports ou plans « officiels » qui viennent de se succéder en 2003-2004 [5] ne consacrent qu’une part faible à l’analyse des représentations des activités scientifiques par les citoyens. Ils ne contiennent aucune donnée nouvelle à ce sujet, les auteurs n’ayant pas commandé d’enquête ad hoc.
De fait, le rapport Hamelin se contente d’une très brève allusion à des données dont il ne cite pas la source [6] tandis que celui du Sénat rappelle certains résultats de deux enquêtes préexistantes [7], datées respectivement de 2000 et 2001. De plus, si ces rapports se servent de données sociologiques, c’est surtout pour asseoir l’idée que les représentations de la science sont ambiguës ou paradoxales. Ainsi, lit-on dans le rapport du Sénat que la science « n'est plus assimilée au progrès dans une vision positive qui avait largement cours il y a trente ans, mais relève d'une perception plus ambiguë » ce qui fait écho la lettre de mission du rapport Hamelin qui notait que : « la société française perçoit la science de manière ambiguë ».
A.1.3 Action cultuelle ou action culturelle ?
En s’intéressant à ces quelques éléments quantitatifs sur lesquels les auteurs insistent dans leurs courtes descriptions de ce qui les préoccupe, on découvre qu’il font surtout référence à une forme de « défiance » vis à vis du progrès scientifique : ils donnent l’impression de vouloir alerter sur une « perte de foi » dans les techno sciences [8] comme pour suggérer l’urgence et l’importance à mettre en place des politiques culturelles pour la restaurer.
Ainsi, le rapport Hamelin [9] déplore-t-il que « les immenses succès de la science finissent par créer une sorte de saturation de l’émerveillement, tout en laissant subsister l’inquiétude » tandis que celui du Sénat relève que si « la capacité de la science à contribuer à la connaissance n'est pas remise en cause. En revanche, l'optimisme quant aux retombées du progrès scientifique et technologique s'érode, (…) évolution des esprits qui affecte l'ensemble des pays de l'Union européenne, et vraisemblablement l'ensemble des pays industrialisés ». Bref pour reprendre les termes du rapport Porchet [10], aujourd’hui « L’image de la science est ternie ; elle est souvent mise en débat ».
Ainsi, pour ces auteurs, l'enjeu serait l'optimisme vis à vis du progrès, plus que la démythification de la Science. De fait, loin de militer pour une désacralisation des sciences, ils regrettent que le progrès ne soit pas plus vénéré et appellent à l'action en ce sens. Pour un peu, on serait là plus face à une « action cultuelle » qu’à une action culturelle. Pour éviter amalgames et ambiguïtés, ce point doit être analysé finement. On observe deux niveaux de discours.
D’une part lorsqu’on les interroge explicitement sur les conséquences des avancées scientifiques, la plupart des acteurs politiques et culturels se défendent aujourd’hui de prendre partie et de situer les sciences et leurs productions du côté du "bien" ou du "mal". La tendance étant à ce niveau de répondre que « cela dépend de l’usage que l’on en fait » . Même si la mémoire des écrits d'Herbert Marcuse et de toute l'école de Francfort est diluée, les spectres d'Hiroshima et de la Shoa, sans doute ravivés par des inquiétudes plus contemporaines, obligent à une prudente réserve et nul n'oserait aujourd'hui assimiler brutalement toute découverte scientifique avec bonheur de l'humanité et progrès social.
D'autre part, malgré cela, lorsque qu'ils analysent les représentations populaires, nombre de nos hommes politiques se laissent aller à regretter en bloc le désamour dont souffrent globalement les sciences, voire même "la" Science. Et tout se passe alors comme si, sans pour autant l'avoir annoncé clairement, ils se reprochaient de ne pas réussir à faire passer cette représentation d'une Science, synonyme de progrès et bonheur assurés, militant déçus d'un dogme positif dans lequel on devrait avoir foi, et qui fournit en quelque sorte des "biens de salut" [11].
De là à percevoir certaines de leurs recommandations comme des préceptes pour mieux administrer un culte sacralisant une telle conception de cette Science, il n’y a qu’un pas. Voilà qui pourrait conduire certains à se remémorer la violente diatribe de Paul Feyerhabend qui militait dans le dernier chapitre (18) de son pamphlet "contre la méthode" (1975) pour la séparation de la "Science" et de l'Etat : "comme c'est à chaque individu d'accepter ou de rejeter des idéologies, il s'en suit que la séparation de l'église et de l'Etat doit être complétée par la séparation de l'Etat et de la Science, la plus récente, la plus agressive et la plus dogmatique des institutions religieuses" [12].
A.1.4 Peu d’intérêt pour les enseignements de l’action
Un autre élément surprenant de ces rapports, c’est qu’ils s’intéressent peu à tirer des enseignements objectifs des multiples initiatives d'animation, de médiation et d'actions culturelles scientifiques mises en place durant les trente dernières années.
Ce désintérêt pour l’analyse objective est d’autant plus étonnant que ces actions culturelles se sont indéniablement multipliées et très fortement institutionnalisées : la fête annuelle de la science, le réseau de lieux labellisés CCSTI, l’existence même de ces rapports parlementaires ou gouvernementaux, conseil nationaux et plans gouvernementaux en témoignent. Or, ces mêmes rapports de décideurs se contentent d’acter l’existence de ces actions sans chercher en aucune manière à en faire une analyse différentielle critique fondée sur des données observées. Certes, le rapport Renar - Blandin illustre son propos d’une énumération des programmes mis en place (y compris d’ailleurs dans d’autres pays), mais même, lorsque ses actions et programmes comportaient une dimension d’évaluation de leurs effets sur les publics qu’ils touchent ; ces évaluations sont juste citées et ne font pas l’objet d’analyse comparée.
Comment interpréter cette absence d’intérêt à évaluer l’impact réel de cet ensemble d’actions et de programmes ? Jugerait-on ces actions velléitaires au point d’avoir la certitude qu'elles n'ont eu aucun effet social ? Voire, pire, auraient-elles amplifié la soi-disant « désaffection »? Penserait-on plutôt que l’important n’est pas l’efficacité sociale réelle, soit pas ce qu’elle ne serait pas mesurable, soit parce qu’en fait, elle n’a pas vraiment d’importance ? Ne serait-il pas surtout important pour les politiques de prendre position, d'affirmer une nécessité ?
A.2.
Désaffection des études scientifiques ou crise
de foi ?
A.2.1 Des curieux discours sur une désaffection présumée
Un autre sujet semble préoccuper fortement nos auteurs « la désaffection des élèves et des étudiants vis-à-vis des filières scientifiques [qui] est préoccupante pour nos entreprises et notre compétitivité au plan international.»[13] On lit la même inquiétude dans le constat initial du Rapport Blandin (p 11) « la régression des vocations pour la science, les techniques et les emplois qui y sont liés est même inquiétante» ainsi que dans le plan Aillagon qui indique en introduction « L'ambition économique de la France nécessite de plus en plus l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. Or les vocations scientifiques reculent. Les inscriptions dans les filières de sciences de la matière diminuent par exemple de 4 % par an. » [14].
Or, comme cela est montré dans l’encadre n°2 :’ « on ne peut pas parler de désaffection des sciences au niveau des bacheliers de l'enseignement secondaire en France »[15] et « Il n'y a pas de désaffection pour les études scientifiques au niveau de l'enseignement supérieur"[16] ». Bref c’est à autre chose que l’on assiste. Le rapport Porchet explicite simplement le phénomène qui pourrait laisser penser à la soi-disant « crise des vocations »: « Les bacheliers S recherchent en priorité des filières professionnalisantes, à effectifs réduits et bien encadrées. […] On observe en effet, qu’un nombre croissant de bacheliers à vocation scientifique, tente de contourner le DEUG et d’enchaîner sur un second cycle à l’université. Le DEUG Sciences et technologies est en cause. Il doit intégrer les attentes des bacheliers ou accepter de voir ses effectifs continuer à baisser. »
Encadré 2 : Seules les études non professionnalisantes subissent une « désaffection »
Plusieurs personnalités du monde politique ou scientifique s'inquiètent d'une "désaffection des sciences par les jeunes". Une baisse spectaculaire des inscriptions en DEUG de sciences (de 52 à 32 milliers par an entre 1995 et 2001) et un tassement du nombre de nouveaux bacheliers scientifiques (il est passé par un maximum de 19,5% d'une classe d'âge en 1994 et est retombé depuis à 14,8% en 1998 et se trouve aujourd'hui aux alentours de 16,5%) a en effet attiré l'attention sur cette question.
Ce constat est en fait à tempérer, ces évolutions pouvant s'interpréter comme l'effet d'une préférence aux études jugées plus professionnalisantes. Ainsi, DUT, BTS et classes préparatoires scientifiques ne subissent pas le même effet et au total, c'est un ratio quasiment stable (de 1995 à 2001) de six bacheliers scientifiques sur dix qui poursuit des études scientifiques ou technologiques.
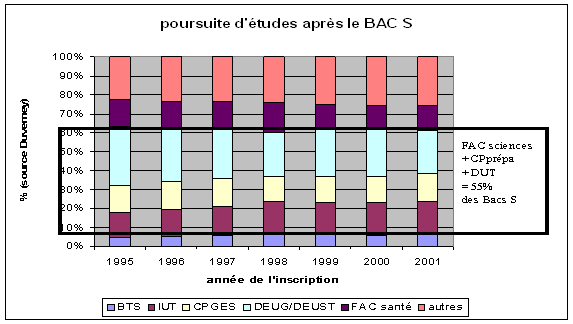
Fig 2-1 : un ratio
constant de 5,5 bacheliers S sur dix poursuit des études scientifiques ou
techniques
(hors médecine et pharmacie)
Quant à la baisse des baccalauréats scientifiques, elle doit être également pondérée : certes, le nombre de Bac S est passé de 139 à 129 milles sur a période 1995-2002(soit - 6,5%) ; mais il faut avoir en tête que sur la même période 1995-2002, les bac littéraires sont passés de 71 milles à 50 milles (soit -30%) et les Bac pro de 67 à 93,5 milles (soit +40%), les Bacc sciences éco et techno ayant eux peu variés (Bac ES en légère croissance de 76,5 à 79 milles et Bac techno à l'équilibre ayant passé de 138 à 141 milles avec un max en 152 milles en 2000) [sources : DEP MEJENR, rapports Ourisson et Duverney].
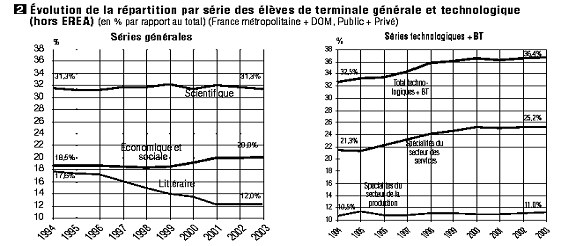
Fig 2-2 : évolution des effectifs des bacheliers par série
^
Pas de crise des vocations, mais une perte de crédibilité des DEUG contournés par les DUT
Moralité, il n’y a pas de crise des vocations scientifiques de nature à menacer la compétitivité nationale. C’est d’ailleurs ce que confirment les experts. Ainsi, le rapport Porchet, p11 (http:/www.u-bordeaux1.fr/Colloque-Sciences/RapportPorchet.pdf, p 11) est explicite pour les Bacs "On ne peut pas parler de désaffection des sciences au niveau des bacheliers de l'enseignement secondaire en France" et le rapport Duverney (page 16 http://smf.emath.fr/Enseignement/Duverney.pdf, page 16) pour les post Bac : "Il n'y a pas de désaffection pour les études scientifiques au niveau de l'enseignement supérieur".
Les phénomènes que l’on observe résultent surtout d’une préférence des jeunes pour les études professionnalisantes. Le rapport Porchet est explicite sur ce point : « Les bacheliers S recherchent en priorité des filières professionnalisantes (81 % des souhaits exprimés), à effectifs réduits et bien encadrées (proche de la structure du lycée). On constate que cette offre de formation est abondante dans le secteur sciences et technologies (IUT, STS, CPGE). Un étudiant qui souhaite faire des études juridiques est obligé d’aller à l’université alors que l’université n’est pas un passage obligé pour les études scientifiques (exception faitedes études médicales). Les DEUG scientifiques résistent mal à cette concurrence car leur image relayée dans le public et les médias persiste à évoquer l’anonymat, les amphis surchargés et l’absence de lisibilité professionnelle. Le terme de désaffection peut être retenu essentiellement pour le premier cycle scientifique universitaire (la baisse des effectifs dans le secteur de la Santé est atténuée en raison du numerus clausus de fin de première année). On observe en effet, qu’un nombre croissant de bacheliers à vocation scientifique, tente de contourner le DEUG et d’enchaîner sur un second cycle à l’université. Le DEUG Sciences et technologies est en cause. Il doit intégrer les attentes des bacheliers ou accepter de voir ses effectifs continuer à baisser. »
A contrario, le problème ce sont les postes disponibles, en particulier aux CAPES scientifiques
Près de 5 300 candidats se sont présentés cette année (2003) aux concours d'entrée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour 357 postes. En 2000, ils n'étaient qu'un peu plus de 4 000 postulants. Qui a parlé de crise des vocations scientifiques ? » s’étonnait Pierre le Hir dans le Monde en septembre 2003. (cf encadré 2 bis).
De fait, c'est sans doute surtout le risque de non renouvellement des enseignants de sciences qui est préoccupant : les effectifs des candidats au CAPES de sciences ont chuté de 18000 à 12000 de 1997 à 2002, un diminution qui a suivi avec quelques années de décalage la réduction de 50% du nombre de postes ouverts (de quatre à deux milles) au maximum de la courbe à savoir entre 1994 et 1996. Depuis 2002, la situation a empiré : 2897 postes externes et 11834 candidats en 2002, 2920 postes et 11009 candidats en 2003 puis seulement 2269 postes en 2004 pour 10973 candidats (soit –21% sur la dernière année, source MEN, DEP). A signaler également, la corrélation entre la courbe des postes ouverts et celles des effectifs des candidats : Cette dernière la suit, décalée de cinq ans, sans doute le temps du découragement des putatifs candidats.
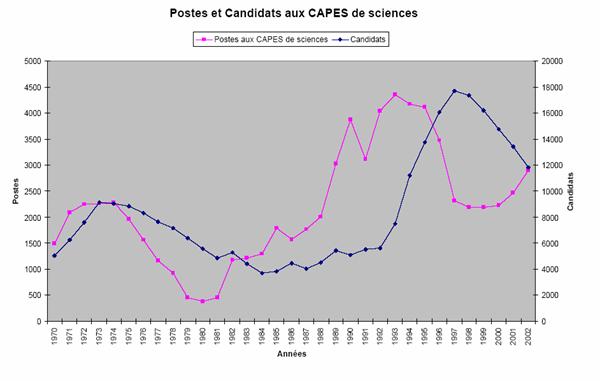
Fig 2-3 : évolution des ouvertures de postes aux CAPES scientifiques
Source de la courbe : http://www.sfc.fr/SocietesSavantes/CAPES.pdf .
A.3. Un brouillage d’image par manque de recul
L’encadré n°2 bis est tout à fait significatif de la confusion qui règne dans les esprits sur cette question. On y voit qu’à quelques mois d’intervalle, le journal Le Monde a publié trois articles se démentant l’un l’autre sur le sujet dont le plus ancien reste le plus clair. Son titre : « La filière scientifique souffre d'une image brouillée » et pour cause, malgré les discours alarmistes, il y a plus de 10 candidats pour un poste au CNRS [17]. D’ailleurs, il n’est pas très difficile de confirmer que globalement il n’y a pas pénurie de chercheurs en analysant le marché du travail : La réalité est bien plus à la pénurie de postes et de contrats. Voir par exemple le dernier rapport du CES sur l’insertion des jeunes diplômés du supérieur http://www.ces.fr/rapport/doclon/05071112.pdf. Notons aussi que nous parlons là toute « disciplines scientifiques » confondues. Les sciences humaines mériteraient bien un traitement spécial en la matière : personne ne se risque à parler aujourd’hui d’une pénurie de sociologues ou d’anthropologues.
Encadré 2bis, les avatars de la désaffection dans le Monde (2003-2004)
« Le Monde » (signé Antoine Reverchon) a publié le 27 avril 2004, sous le titre « L'Académie s'en prend au mythe de la « désaffection » pour les sciences » un article en forme de démenti : « Les effectifs ne baissent pas mais les étudiants délaissent les matières fondamentales au profit de spécialités appliquées. Parmi les ingrédients de la crise de la recherche en France figure en bonne place la désaffection à l'égard des études scientifiques. Chiffres à l'appui, nombreux sont les rapports qui ont sonné l'alarme, craignant que la baisse du nombre d'étudiants engagés dans les filières scientifiques n'interdise de compenser les départs massifs en retraite des chercheurs et des enseignants dans les prochaines années. »
Il suivait un autre article titré « Comment redonner aux élèves le goût des disciplines scientifiques » (3 décembre 2003, signé lui Pierre Le Hir) Au moment où commence un débat national sur l'école, la désaffection massive dont souffrent certaines filières, en partie liée au manque de perspectives professionnelles dans la recherche, exige de repenser la transmission des savoirs, du primaire à l’université. La France va-t-elle bientôt manquer de professeurs de sciences et de chercheurs ? Le risque est réel, avec la DÉSAFFECTION des jeunes pour les filières scientifiques. En cinq ans, les effectifs ont chuté de 46 % en premier cycle universitaire de physique-chimie, et de 27 % en sciences de la vie et de la Terre.
A signaler le 30 septembre 2003 « La filière scientifique souffre d'une image brouillée », toujours de Pierre Le Hir « La désaffection des jeunes pour les sciences fait craindre une pénurie de chercheurs. Près de 5 300 candidats se sont présentés cette année aux concours d'entrée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour 357 postes. En 2000, ils n'étaient qu'un peu plus de 4 000 postulants. Qui a parlé de crise des vocations scientifiques ? « La demande reste très forte, constate Michel Lannoo, directeur du département des sciences physiques et mathématiques. Nous n'avons aucune difficulté à trouver, dans les disciplines de base, des recrues de qualité »
A.3.1 D’où vient cette invention de la Crise des vocations ?
Comment interpréter ce « brouillage » ? Comment se fait-il qu’une telle représentation continue d’être colportée et d’ailleurs peu démentie ? Pour répondre à cette question, il faut avoir en tête que les décalages entre les discours sur les « tensions de recrutement » et la réalité du marché du travail sont fréquents et qu’à ce titre le secteur des filières scientifiques ne constitue pas un cas unique. La situation des infirmières constitue un exemple éclairant : c’est un secteur qui souffre à la fois de pénurie de recrutement et d’un fort taux d’échec aux principaux concours de recrutement : (il n’y a pas de concours commun aux différentes écoles).
A noter d’ailleurs que les tenants des études littéraires ont des protestations tout à fait symétriques, comme en témoigne par exemple une « note sur l’avenir de la sérié L » du groupe « lettres » de l’inspection générale de l’EN, publiée mars 2005 sur http://www.sauv.net/serieL.php qui expose : « La présente note s'appuie en premier lieu sur un constat : l'affaiblissement progressif de la série littéraire, qui risque de devenir irréversible, voire fatal, s'il se poursuit et si le taux de fréquentation des élèves passe sous la barre des 10 %. Inversement, les polémiques qui ont agité les milieux universitaire et politique depuis deux ans autour des nouveaux programmes de lycée et des nouvelles épreuves de français du baccalauréat ont monté combien la question de l'enseignement de la littérature reste inscrite au cœur des débats sur la société. Ce déclin de la série L met particulièrement en relief l'urgence qu'il y a à repenser l'architecture générale des enseignements au Lycée dans la perspective d'une orientation des élèves (par rapport à des débouchés et au marché de l'emploi). » [18]
Essayons en l’occurrence de clarifier les ambiguïtés qui nourrissent ces « discours de crise » des vocations de scientifiques. Certes, les responsables des DEUG peuvent penser -à tord- que le phénomène d’effondrement des inscriptions qui touche leurs filières universitaires est extrapolable à toutes les filières scientifiques, mais la croisade contre cette prétendue « crise des vocations » est beaucoup plus générale puisqu’elle est reprise dans nos trois rapports et plans officiels. Certes, un amalgame sémantique (volontaire ou non) entre « désaffection des sciences » et « désaffection des filières scientifiques » peut aussi se faire. Certes, il peut s’agir d’une volonté de lobbying par un appel à l’enthousiasme des étudiants : comme si on leur reprochait de ne pas faire pression pour que les gouvernants n’oublient pas d’investir dans la recherche [19].
Mais, ces effets sont minoritaires. De fait, ces discours semblent surtout inspirés par la crainte de deux phénomènes qui se combineraient dans les années à venir [20] et crairaient alors la grande pénurie de candidats chercheurs.
Le premier phénomène sera les départs à la retraite dus au vieillissement (comme dans la plupart des secteurs professionnels) et l’autre serait la relance des créations de postes dans la recherche que tous appellent de leurs voeux, car ils n’en doutent pas, on aura compris alors qu’il faut investir plus dans la recherche et on va passer de 2.2.% du PIB pour la recherche à 3%, investir dans les pôles de compétitivité, créer des postes... Exemple typique de ce discours optimiste : "La décennie (horizon 2010) qui s'amorce est cruciale : la France, comme l'ensemble des autres pays occidentaux devra recruter un très grand nombre de cadres (enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs) et techniciens tant dans le domaine public que privé. C'est la conséquence des créations "normales" d'emploi liées à l'innovation technologique (20% des créations) mais surtout des départs à la retraite (80% des créations). [..] De toute façon, nous ne pourrons mobiliser l'énergie des étudiants que si cet effort est récompensé par une insertion professionnelle en adéquation avec leur formation universitaire... ». Voir à ce propos le point de vue exprimé dans l’encadré 2ter « la recherche refuse l'euthanasie ».
Encadré 2ter, La recherche refuse l'euthanasie
Extrait de LIBERATION du 10 03 05
Publié par http://www.ecosysteme-croissance.com/presse/
La recherche refuse l'euthanasie par Henri Audier, administrateur du CNRS, membre du Collectif national de Sauvons la recherche.
Pénurie de chercheurs, manque de moyens et de crédits, l'avenir scientifique est en danger.
Aggraver la pénurie de scientifiques qui se profile, c'est programmer le suicide d'une nation. Cela ne sera pourtant pas faute de l'avoir dit et redit : la France et l'Europe vont manquer cruellement d'ici à quelques petites années de scientifiques, d'ingénieurs, d'universitaires, de chercheurs du secteur public ou privé. Depuis cinq ans, nombreux sont ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme, individuellement ou collectivement, de l'Académie des sciences aux syndicats. Cette catastrophe programmée est confirmée avec éclat par deux rapports de l'Inspection générale de l'Education nationale et de la recherche (Igenr), qui viennent d'être publiés à la Documentation française. La Commission européenne ne dit pas autre chose quand elle constate, qu'au regard des Etats-Unis et du Japon, il manque 700 000 scientifiques en Europe et donc de l'ordre de 100 000 en France. Or, c'est en ce début de siècle que se joue la qualité de notre recherche et de notre enseignement supérieur pour les trente ans qui viennent. Près de la moitié des scientifiques va devoir être remplacée en dix ans, du fait des départs en retraite. Passer de 2 % à 3 % du PIB pour la recherche implique d'accroître fortement le potentiel humain public et privé. Il faudra faire son deuil d'une politique de l'innovation ou du développement d'industries à forte valeur ajoutée, si on ne possède pas, pour ce faire, les gens formés par la recherche. .../... Considérant cette situation catastrophique, les états généraux de la recherche ont proposé une panoplie de mesures complémentaires à la fois pour que la recherche irrigue l'ensemble des activités sociales et pour attirer plus d'étudiants vers le doctorat et la recherche. Au moment où se prépare une loi d'orientation et de programmation de la recherche, le gouvernement doit faire de ce problème la priorité des priorités.
Ainsi, donc ces discours sont pour le moins imprécis quand ils s’alarment à propos d’une actuelle « désaffection des filières scientifiques», car nous l’avons vu la baisse des DEUG est compensée par le développement des filières. Précisément, ce qui est alarmant c’est l’absence d’anticipation des besoins en 2010.
En employant une formulation inadaptée et décalée, ils font courir deux risques. Le premier est celui du discrédit de ces discours en général, puisque de fait tout le monde peut constater dans les chiffres qu’il n’y a pas de désaffection (encadré 2 et 2bis). Le second risque, c’est de laisser croire aux jeunes et aux professionnels de l’orientation qu’il y aura avec certitude de l’embauche alors que rien ne prouve que la relance de la recherche aura forcément lieu et que force est de constater que dans beaucoup de secteur on ne renouvelle pas les départs à la retraite (les putatives cohortes d’informaticiens à créer pour le bug de l’an 2000 ou le passage à l’euro ont échaudé les professionnels de l’insertion),
Sortir de ce brouillage, (cf encadré 2 bis) signifierait accepter de dire qu’en fait il s’agit là d’une profession de foi fondée d’une part sur une prévision de gestion prévisionnelle des ressources humaines transversale à de nombreux secteurs (vieillissement de la société) et d’autre part sur le pari de la relance effective des embauches dans la Recherche ; or en plein discours sur l’importance de l’enseignement des sciences, on vient de constater entre 2003 et 2004 une diminution de –21% du nombres de postes ouverts au CAPES scientifiques, et –15% à pour les agrégations.
N’oublions pas que nous analysons des rapports et plans officiels, qui sont réputés éclairer la situation et les prises de décisions et non pas des actes de foi susceptibles d’obscurcir la lecture de la situation !
A.4.
Une action culturelle aux objectifs paradoxaux
Face à ce double désintérêt tant pour l’analyse du passé que pour l’objectivation du présent, on est conduit à s’interroger sur la nature de la volonté des politiques en matière d’action culture scientifique. N’accorderaient-ils pas plus d’importance à la production des discours eux-mêmes et à l’affichage d’intentions, qu’aux effets sociaux qu’ils prétendent souhaiter ? Répondre à cette question renvoie de fait à celle des objectifs concrets de l’action culturelle scientifique et technique. Quels objectifs pragmatiques et observables lui sont-ils fixés ?
A.4.1 Des ambiguïtés sur la nature même des publics et objectifs
Force est de constater qu’en matière d’action culturelle scientifique et technique, si l'on analyse l’ensemble des discours et programmes, on est en effet vite confronté à deux dimensions ambiguës de ces objectifs.
D'une part, une première ambiguïté porte sur la nature des acquisitions souhaitées : certains prétendent permettre l'appropriation de méthodes d'investigation et le développement de l'esprit critique, comme les centres de vacances scientifiques du réseau « Planète sciences » , tandis que d'autres agissent pour favoriser la plus large consommation des fruits du progrès technique, comme la galerie des innovations de la Cité des sciences et de l’industrie, avec des expositions du type « tout capter » en partenariat avec l’opérateur téléphonique Orange. Pour être bien clair dans la description du spectre d’objectifs, il faut préciser qu’à ce stade, se trouvent agrégés du coté de « développer l’esprit critique » à la fois les acteurs qui revendiquent cet objectif pour le plus grand nombre (la généralisation de la « main à la pâte » dans toutes les écoles primaires) et ceux qui cherchent à développer des « ateliers délibératifs » ayant pour objectif l’instauration de débats publics [21] et qui ont besoin de mettre en place des jurys populaires pour juger de la pertinence de telle ou telle décision technoscientifique. Objectif louable dans des sociétés comme les nôtres qui se revendiquent comme démocratie scientifique [22], mais qui revient –comme lors de la constitution de jurys populaires- à extraire quelques citoyens cobayes pour en faire des témoins de l’acceptabilité ou non de telle ou telle décision.
D'autre part, une seconde ambiguïté concerne le spectre de public visé : certains fixent pour objectif de contribuer à la formation d’un sous-groupe social spécifique, le plus souvent l'élite technoscientifique indispensable dans nos sociétés technologiques tandis que d'autres prônent une action touchant le plus grand nombre.
Tant que l’on en reste à l’échelle d’une action locale ponctuelle, cette double ambiguïté n’a rien d’alarmant. Il résulte de cette diversité d’effets souhaités une aussi grande diversité des modes d’action. Le vocable « culture scientifique et technique » peut ainsi être appliqué à des pratiques aussi socialement différentes qu’un atelier relais de découverte astronomique pour jeunes en difficulté, la remise d’un prix du jeune chercheur à un thésard, en passant par une visite de centrale EDF, un atelier de sensibilisation aux addictions « bar-tabac » de la Ligue contre le Cancer ou un concours de robot pour écoles d’ingénieur.
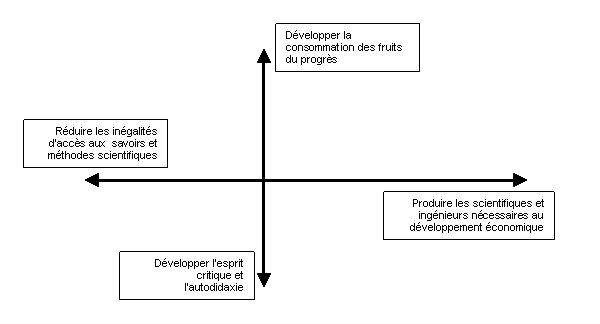
Figure 3 -1 : deux dimensions ambiguës des objectifs des acteurs
axe 1 partage/élite et axe 2 consommation/critique
Il en va autrement lorsqu’on change d’échelle. Les rapports que nous citons ici sont réputés s’intéressés aux politiques nationales et parlent de la « cohésion sociale » de l’ensemble de la nation. A une échelle macroscopique, de ces ambiguïtés découle bien évidement un manque de lisibilité du rôle social des grands événements ou équipements polyvalents. Qui est par exemple capable de formuler de manière observable l’utilité sociale (hors rôle de ressource vis à vis de l’éducation nationale) de la fête de la science, des établissement polyvalents comme les CCSTI à large spectre d’objectif ou de la Cité des sciences et de l’industrie [23] ?
Il peut aussi résulter de ces ambiguïtés un manque de vigilance par rapport aux effets réels des actions : Les exemples sont légions où, par des effets d’aubaine, de facilité ou d’habitus des publics, on ne touche que les personnes déjà intéressés, déjà nantis culturellement, renforçant donc les inégalités culturelles ou d’intérêt au lieu de les réduire, comme on s’en fixe l’objectif. Les spectres de publics des principales manifestations et équipements en témoignent [24]. Si les enjeux sociaux étaient perçus comme cruciaux, de telles dérives seraient repérées et l’on s’emploierait à les corriger : si l’objectif est la réduction des inégalités, pourquoi peut-on se satisfaire de constater qu’en fait on les renforce [25] ?
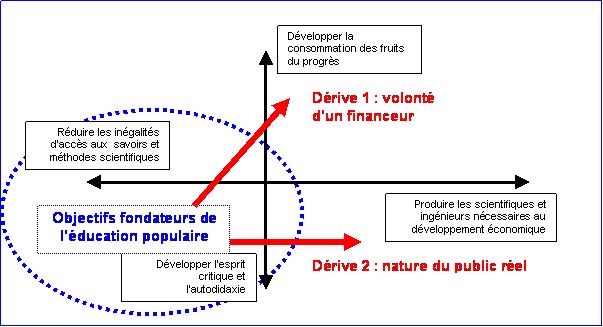
Figure 3 - 2 : dérives d’objectifs pour des
actions d’éducation populaire :
la volonté d’un sponsor peut entraîner la dérive 1.
La sociologie de la clientèle naturelle d’une offre peut avoir pour effet la
dérive 2.
A.4.2 Un grand écart entre éducation populaire et formation des élites
Plus fondamentalement, on ne peut éluder la question de savoir si ces ambiguïtés d’objectifs ne généreraient pas de multiples effets contradictoires rendant velléitaires les tentatives de mise en "culture populaire" des sciences. N'y aurait-il pas en réalité au moins deux courants culturels aux objectifs différents, paradoxaux voire antagonistes ? L'un, proche des valeurs de l'éducation populaire [26], et qui s'attacherait surtout à l'émancipation socioculturelle (l’ « empowerment », pour reprendre l’expression nord-américaine en passe de se généraliser dans le monde de la santé) du plus grand nombre via l'appropriation de méthodes de résolution de problèmes et d'autoformation, tandis que l'autre viserait principalement à améliorer la production du progrès technique par une élite de chercheurs et d'ingénieurs et sa consommation (oserait-on ajouter la plus compulsive possible) par les citoyens.
Voilà qui est effectivement bien paradoxal. D'un point de vue social, un club de construction de fusées expérimentales dans une école d'ingénieurs ne produit pas le même type d'effet qu'une séance de fabrication de fusées à eau dans un centre de loisir municipal installé dans un quartier sensible. Un stand publicitaire pour Wanadoo haut débit ne vise pas le même but qu'un atelier de découverte de l'Internet dans une bibliothèque de quartier. De même d'un point de vue pédagogique, un long métrage TV mettant en scène de manière dogmatique la représentation de l'origine de l'espèce humaine ne produit pas les mêmes acquisitions qu'une séance de fouilles associant des adolescents du quartier dans un chantier d'archéologie préventive.
A.4.3 Une étonnante absence d'interrogation sur les paradoxes
En fait, la plupart des acteurs et décideurs ne semblent pas accorder beaucoup d'intérêt à ces différences, voire divergences d'objectifs [27] : les actions sont-elles antagonistes au sens qu'elles s'annulent ou peuvent elles cohabiter sans danger pour leur efficacités respectives ? Dans une même mise en scène de la fête de la science, que produit la juxtaposition des unes transpirant combien la science ne peut intéresser que l'élite tandis que les autres essayent de prouver le contraire ? Là encore, personne ne semble se poser la question : Ainsi, le rapport Renar – Blandin affirme : « La diffusion de la culture scientifique et technique relève, en France, d'une grande multiplicité d'acteurs. Elle ne prendra toute son efficacité que si ces acteurs arrivent à unir et fédérer leurs efforts », sans pour autant envisager qu’ils puissent poursuivre des objectifs antagonistes : sous-entendu derrière cette multiplicité d’acteurs, la « diffusion de la culture » ne peut-être que consensuelle.
A.4.4 Des acteurs culturels englués dans un consensus mou
Mais s'ils nuisent à l'efficacité ou inhibent l'action collective à l’échelle macroscopique, pourquoi de tels paradoxes ne sont-ils pas levés ou au moins dénoncés par les professionnels de l'action culturelle [28]? Une des premières hypothèses consiste à dire que nous sommes enfermés dans un réflexe corporatiste. Tout se passe comme s'il s'était constitué un consensus mou, mis en place et protégé par des effets d'aubaine. Au fur et à mesure de l'institutionnalisation, les professionnels de l'action culturelle scientifique ont appris à chercher les financements : « on est plus fort si l'on parait uni devant les financeurs... alors, on a tout intérêt à s’abstenir de critiquer tel ou tel objectif ».
Il est frappant que bien peu nombreux sont ceux qui ont osé s'interroger sur les valeurs réellement véhiculées par certains aspects de la Fête de la science, par le vedettariat des émissions des Nuits des Etoiles... Quant on dépend de financeurs "large spectre", il est sans doute économiquement parlant plus sûr de prôner tout simplement "la diffusion de la culture scientifique et technique" amalgame camouflant ou déniant ces paradoxes d'objectifs.
Il se peut aussi que certains de ces acteurs ne soient tout simplement pas conscients de ces paradoxes d'objectifs, par exemple parce qu'ils privilégient un travail de proximité. Ainsi l'action de centres de vacances ou de clubs développant des projets de pratiques scientifiques pour quelques jeunes permet réellement l'appropriation de méthodes, mais touche un spectre socialement déséquilibré vers les classes aisées. Ce type d'action se positionne socialement comme un auxiliaire du système de formation initiale, en renforçant marginalement l'efficacité et le caractère sélectif. Aucun problème social tant qu’il reste marginal [29] ; il produit des effets individuels, mais pas d'effet global.
Si en revanche, comme affirment les souhaiter les politiques, ce type d’action était massivement développé sans pour autant arriver à changer de spectre de public, il multiplierait alors les outils performants pour les déjà nantis culturellement et risquerait de contribuer par voie de conséquence à renforcer les inégalités d'accès aux savoirs et méthodes scientifiques. Il en va de même de toutes les politiques qui renforcent des écarts sociaux. Les grands musées et centres de sciences n'échappent d'ailleurs pas à cette contradiction. Nous sommes là face à la question cruciale de la crédibilité du modèle de la dissémination : peut-on sérieusement prétendre arriver à une inversion (du volume de population) des « sachants » ?
A.4.5 Une instrumentalisation de l'action culturelle scientifique
Ce caractère ambigu fait courir le risque de voir les actions culturelles scientifiques dépendantes de différents groupes d'intérêt à la recherche de bénéfices qui leur seraient particuliers. Derrière la simplification pour ne pas dire le déni de ce débat sur l'antagonisme ou non des pratiques, tout se passe d'ailleurs comme si plusieurs lobbies instrumentalisaient les acteurs culturels dans le domaine scientifique : Certains pour lutter contre la (réelle ou supposée, voir plus haut) "désaffection des jeunes pour les études scientifiques", pour éviter "la fuite des cerveaux vers les USA", d’autres pour vendre un maximum d'Internet à haut débit, de téléphones 3ième génération ou autres liposomes, Cialis, Actimel et ESP... ou pour rendre plus acceptables les conséquences économique ou environnementales du progrès technique. Des groupes de pressions pour la plupart très respectables, mus par des enjeux socio-économiques indéniables parmi lesquels on trouve l’inspection générale de l'éducation nationale, des organisations de chercheurs, d'industriels dont la plupart sont à cent lieux de penser « brouiller la lisibilité des actions culturelles » ou « transformer en instrument » les acteurs culturels.
A.5.
Un coup d’œil velléitaire sur les failles du système
éducatif
Pour la plus grande majorité d’entre nous, la principale confrontation avec les sciences (il n’est question là que des sciences et non des techniques) a lieu lors de la formation initiale et ce qui se passera après ne sera que marginal. Ainsi, les représentations développées par les collèges et les lycées sont déterminantes. D’ailleurs, si l’on cherche à chiffrer le poids relatif des actions culturelles scientifiques et techniques par rapport au poids de l’enseignement scolaire des sciences, on peut estimer que l’enseignement formel l’emporte d’au moins un rapport 80 (voir l’encadré 7, où on l’estime à 1,5 milliard d’heures x personnes versus 360 millions).
Encadré : 7 l’action culturelle scientifique et technique représente un volume de médiation marginal par rapport à celui des l’éducation scientifique formelle en France.
Combien pèse en France l’action culturelle par rapport à l’enseignement formel des sciences ?
Pour répondre à cette question, il faut :
trouver des chiffres comparables pour les actions informelles et non formelles,
se fixer sur des contours de la catégorie SetT (y nous choisissons la sommes des deux catégories sciences et techno sciences (y compris « santé », mais sans pratiques techniques profanes, histoires et langues).
se fixer sur la façon de traiter la « disponibilité en réception » . Ici nous considérons seulement le volume horaire total, même si en classe ou devant la TV par exemple, on peut se douter que certains ne sont 100% attentifs.
|
Volume d’enseignement scientifique fourni par l’éducation nationale |
Ens Primaire |
5000 |
2 |
30 |
300000 |
|
|
Ens Secondaire (<1°) |
5000 |
5 |
30 |
750000 |
|
|
|
Ens 1° et Term |
480 |
10 |
30 |
144000 |
|
|
|
Ens Supérieur |
400 |
30 |
30 |
360000 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 554 000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Volume d’action culturelle développé par l’action culturelle et l’éducation informelle |
CSI, CCSTI et musées |
5000 |
4 |
1 |
20000 |
|
|
Télé |
6000 |
30 |
1 |
180000 |
|
|
|
activités socio culturelles |
2000 |
20 |
1 |
40000 |
|
|
|
presse et lecture |
2000 |
2 |
30 |
120000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
360 000 |
|
|
|
Milliers de personnes |
Horaire hebdo |
Nbre de semaine |
|
Milliers d’heures x personnes |
Attention tout de même à ce que l’on fait dire à ces chiffres : d’une part il s’agit d’une première estimation très à la louche et d’autre part, ils sont sommés pour toute la France. Localement, très exceptionnellement, un ou une ado dans un club peut faire plus de sciences dans l’extra ou péri-scolaire qu’en classe.
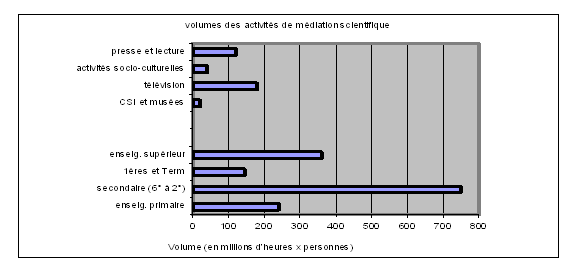
A.5.2 Un enseignement qui mériterait d’être rénové et rendu plus attractif
Or, force est de constater un large consensus, partagé par les pédagogues, les autorités scientifiques et les enseignants pour déplorer l’organisation et le contenu de l’enseignement des sciences. Comme il est dit dans le rapport de G. Ourisson [30] « Tout indique que les enseignements scientifiques et techniques dans les Collèges et les Lycées mériteraient d'être rénovés et rendus plus attrayants. La formation scientifique de base des élèves et étudiants, même de ceux qui ne se spécialiseront pas en science ou en technologie, est notoirement mal adaptée à leur vie future dans une civilisation largement technologique, et tout simplement à leur compréhension du monde dans lequel ils vivent. Ces études, malgré des réformes répétées et toujours dites "définitives" mais en fait temporaires, restent trop souvent un pensum pour les élèves ». Cette vision est loin d’être uniquement franco-française, citons simplement l’américain Seymour Papert[31] affirmant quand à lui que « Pour la plupart de nos contemporains, les mathématiques sont administrées et ingurgitées comme un médicament. » (in « Le jaillissement de l’esprit », trad R-M Vassallo-Villaneau) et dans « The children’s machine » « La géométrie n'est pas faite pour être apprise, elle est faite pour être utilisée ».
En ce qui concerne le secondaire, les critiques pleuvent [32], mettant en cause à la fois l’organisation des enseignements qui formatent et saucissonnent les sciences en "disciplines" et les programmes jugés trop dogmatiques. Pour un peu on y décèlerait un déni du phénoménologique et une volonté d'infantilisation : selon de nombreux auteurs de tous horizons, ils font la part belle à des mathématiques marquées encore aujourd’hui par le fait d’avoir été promues au rang de d'épreuve reine des jeux olympiques de la sélection sociale. Comme autre preuve, on peut aussi évoquer le concentré d’émotions que déclenche, chez les nombreux (car majoritaires) ex-mauvais élèves en maths, la lecture des corrigés d’exercices décryptés par Stella Baruk dans ses ouvrages [33].
A.5.3 Donner le goût des sciences à l’école, on sait faire !
La situation est donc tragique. Prenons simplement l’exemple du primaire pour commencer : il suffit de lire Stella Baruk qui justement en dit en 2004 dans « si 7=0, quelles mathématiques pour l’école ? » [34] (p16, première éd.) : « On prétend mettre l’élève au centre du système éducatif. En fait, il n’est au centre que du système explicatif de l’échec d’un enseignement de masse. A la moindre « alerte », se fondant sur des évaluations à petite ou grande échelle, l’institution détecte dès le CP, voire la grande section de maternelle des élèves en difficulté, difficulté qui n’a plus qu’à croître et embellir jusqu’à produire ce que l’on peut voir au collège ». « Mais peut-être faut-il aussi se demander, sans que soient mises en accusation des personnes quels sont les vices d’un système qui fait que cette situation perdure » (idem, p 69).
Bref, ça va très mal et le rapport Renar-Blandin, reprenant celui de R. Jantzen (2001) semble clair et impératif dans ses intentions : « Il paraît donc indispensable, dans ces conditions, de s'attacher à améliorer la présentation des sciences à l'école, de façon à réfuter le sentiment suivant lequel ces matières seraient à la fois arides et difficiles, et à promouvoir la conviction que, si ces études requièrent effectivement une grande constance dans l'effort, elles débouchent sur une véritable joie de connaître et de comprendre ». «
Alors, comment va-t-on s’y prendre ? Et bien justement, Il y a une solution, maintenant très largement connue de ceux qui s’intéressent à la question : Celle des pédagogies actives, comme celles défendues par les tenants de « la main à la pâte ». Pas d’hésitation, vu l’enjeu… D’ailleurs, comme l’évoque le rapport Renar Blandin. « L'inspection générale de l'éducation nationale a conclu en 1999 sans hésitation à l'excellence de la méthodologie » issue de [la main à la pâte]. Son rapporteur, M. Jean-Pierre Sarmant, indique que de nombreux maîtres estiment que cette démarche rejaillit sur l'ensemble de leur enseignement, et relève que les effets de cette pédagogie sont très positifs dans le domaine du comportement social et moral, de l'expression dans la langue maternelle, et de la formation générale de l'esprit. L'inspection souligne en outre le caractère positif de cet enseignement pour les enfants en difficulté scolaire, et dans les classes difficiles ».
A.5.4 Mais, on ne pourra pas… C’est dommage mais c’est comme ça
Et la suite bascule dans le velléitaire. « Elle n'a toutefois pas jugé possible à court ou moyen terme la généralisation de cette pédagogie, qui ne touchait, en 1999, que 2 % des classes maternelles, et qui requiert à la fois un engagement volontaire des maîtres, et une forte implication des chercheurs partenaires de l'opération. »
En bref, c’est désarmant : on a une école qui ne marche pas (qui n’arrive pas à donner le goût des maths et des sciences) … On a trouvé un moyen de l’améliorer qui est jugé « très positif » ; Et au lieu de décréter la mobilisation générale pour son application… on renonce… Bon, dont acte. Qu’en déduire ? Comment croire que malgré tout la question de la dimension scientifique de la culture est une priorité nationale ? La réponse est claire. C’est NON ! Cela dit, on fait quand même quelque chose : le rapport Blandin note (un rien ironique dans le ton ?) L’IGEN … « s'est toutefois inspirée de sa méthodologie dans la préparation d'un plan de rénovation de l'enseignement des sciences, qui a bénéficié d'une enveloppe de 11 millions de francs de crédits pédagogiques et d'une dotation de 10 millions de francs pour la formation des maîtres ».
A.5.5 De toute façon c’est comme ça.
Et c’est là où la boucle se boucle. Pas un mot, dans ce rapport officiel d’une mission sénatoriale, sur ce choix –paradoxal pour une priorité nationale- de ne pas investir dans la généralisation de la main à la pâte… Ca s’argumente non ? Y compris si c’est une affaire de faisabilité ! Et pire en encore pas un mot sur de ce plan et cette dotation à 21 millions. C’est quoi, ce plan ? C’est bien ? C’est mal ? C’est déjà ça ? Et il vise quoi comment on va l’évaluer ? A croire que la mission parlementaire s’en désintéresse… Cela dit, c’est pire dans les deux autres rapports… Notons juste que la démonstration qui vient d’être faite concernait le primaire : le désintérêt est encore plus flagrant pour l’enseignement au collège[35] et au lycée. Il suffit de regarder les atermoiements autour des itinéraires de découverte, et surtout des TPE pour s’en convaincre.
Force est donc de constater que les politiques qui parlent de culture scientifique ne font que survoler la question de l’instruction publique. Pourquoi traiter comme une question secondaire ce média scolaire pourtant 80 fois plus présent dans la transmission scientifique que tous les autres médias réunis ?
Et de fait, c’est indéniable : En effet, les rapports servant ici de référence déplorent certes les défauts du système éducatif, mais concentrent essentiellement leurs préconisations sur l’éducation informelle[36]. En ce sens, la conclusion du rapport Renar-Blandin (p 65 à 69, § « la conjonction nécessaire des efforts ») est typique : on y dit certes que « les organismes qui ont pour vocation première la diffusion de la culture scientifique, qu’ils soient de dimension nationale, régionale ou locale, doivent rechercher d’avantage qu’aujourd’hui, à développer les coopérations et les partenariats. » Mais, la suite ne concerne que l’action culturelle « informelle » ou non formelle et en rien l’enseignement « normal » des sciences qui est complètement omis de cette partie conclusive. Au contraire, on y parle explicitement du rôle du service public de l’enseignement, mais en s’intéressant exclusivement au fait qu’il « apporte une contribution précieuse à la diffusion de la culture scientifique, en dehors du cadre strictement scolaire ». Certes, la réforme de l’enseignement des sciences n’est pas absente des préoccupations de ce rapport : en quatrième priorité, on y lit d’ailleurs la proposition de « favoriser l’enseignement des sciences et son ouverture sur le monde et les métiers de la recherche », mais nous voilà revenu à la prétendue pénurie de futurs travailleurs de la science.
Voilà qui conduit à se poser deux questions parallèles :
D’une part, celle de savoir pourquoi ceux (personnifiés par nos trois rapports officiels) qui prétendent se préoccuper du niveau culturel scientifique du plus grand nombre s’intéressent-ils au système marginal des acteurs de l’éducation informelle au lieu de se focaliser sur le système éducatif lui-même?
D’autre part, celle de savoir pourquoi nous ne modifions pas notre système d’instruction publique pour le rendre plus efficace et moins infantilisant. Cette seconde question étant bien sûr la question de fond, contrairement à la première qui elle est surtout intéressante d’un point de vue d’analyse institutionnelle.
A.5.6 Pourquoi ces parlementaires devaient-ils éluder la question scolaire ?
Commençons par reformuler la première question. Qu’est ce qui peut bien expliquer que des parlementaires s’interrogeant sur l’insuffisance de « la culture scientifique et technique pour tous, une priorité nationale» ne regardent que marginalement la question de l’efficacité du principal responsable de la représentation des sciences ?
Trois raisons sont assez faciles à imaginer : d’une part, ils peuvent considérer que là n’est pas le centre du problème qui leur est posé (ils ne sont pas mandatés pour réformer l’instruction publique), d’autre part ils peuvent juger qu’une transformation massive du système scolaire ne peut être à l’ordre du jour (d’ailleurs personne ne s’y risquerait aujourd’hui), et enfin, ils se peut qu’ils regardent le problème dans une échelle de temps trop courte pour qu’une transformation du système scolaire est vraiment un effet (de toute façon quoi que l’on change dans l’instruction publique, cela n’aura d’effets que bien trop tard).
Trois raisons qui sans doute se cumulent pour produire ce choix d’orienter l’essentiel de leurs préconisations vers le monde pourtant « marginal » en volume, de l’extra-scolaire. Mais d’ailleurs, pour être moins naïf, ne faudrait-il pas aussi postuler tout simplement que la commande qui leur était implicitement faite consistait plus à voir comment aider pragmatiquement la « corporation des acteurs de la culture scientifique et technique » telle qu’elle s’est instituée dans les dernières décennies, sans trop chercher midi à quatorze heures…, Trop vouloir étendre le problème risquait de le noyer dans le marais du système éducatif, des multiples tentatives avortées de réformes Allegre, Ferry et autres Fillon ou des rapports Joutard ou Thélot. Quant à trop creuser la relation entre « culture scientifique » et réforme d’ensemble du système éducatif et des programmes, voilà qui aurait pu fragiliser le consensus et voire casser le capital de sympathie inspiré par la belle « culture scientifique, enjeux de la croissance et de la démocratie ».
Comme ici dans ce texte nous pouvons nous payer le luxe de nous affranchir (au moins par la pensée) de ces considérations socio-institutionnelles et même penser à long terme, revenons malgré tout à la question de fond, celle du rôle que pourrait vraiment ou devrait vraiment remplir le système éducatif central en matière de développement de la dimension scientifique de la culture générale du plus grand nombre.
A.5.7 Donner le goût et des mauvaises notes aux mêmes élèves
L'enseignement des sciences dans l'instruction publique se trouve à devoir répondre à une juxtaposition d'objectifs, surtout à partir du secondaire. Il doit à la fois permettre l'identification et la distillation des futurs scientifiques et technoscientifiques et donner une formation générale en sciences à tous.
Qu'en est-il de la hiérarchie entre ces deux objectifs ?
Socio-économiquement, il est sans doute resté implicitement admis que la priorité est la formation des scientifiques. Mais cela dit, on lit de plus en plus de texte qui plaident pour que les deux objectifs soient être atteint simultanément (cf encadré 8)
Encadré 8 : Introduction aux nouveaux programmes de sciences des classes de seconde générale (paru au B.O.E.N. du …) :
« L'enseignement des sciences au lycée est d'abord conçu pour faire aimer la science aux élèves, en leur faisant comprendre la démarche intellectuelle, l'évolution des idées, la construction progressive du corpus de connaissances scientifiques.
L'aspect culturel doit donc être privilégié. Naturellement, il est impossible
d'apprécier une discipline, sans avoir un certain nombre de connaissances de
base. L'enseignement conduira donc à faire acquérir à l'élève une culture
scientifique élémentaire. Il incitera certains élèves à s'orienter vers les
filières à dominante scientifique et à choisir plus tard des métiers liés aux
sciences et aux technologies. Mais pour ceux qui choisiront une autre voie, cet
enseignement devra les amener à continuer à s'intéresser aux sciences, à ne pas
en avoir peur, à pouvoir aborder ultérieurement la lecture des revues
scientifiques de vulgarisation sans appréhension, enfin, à participer à des
choix citoyens sur des problèmes où la science est impliquée.
[…]
L'expérimentation est une
démarche essentielle des sciences. Elle consiste à imaginer, à inventer des
situations reproductibles permettant d'établir la réalité d'un phénomène ou
d'en mesurer les paramètres. Cette démarche qui appartient à toutes les
sciences envahit aujourd'hui du fait de l'ordinateur, les mathématiques. Il
faut enseigner à l'élève cette démarche, en acceptant les tâtonnements, les
erreurs, les approximations. Pour ce faire, il vaut mieux faire réaliser
quelques expériences, en petit nombre mais bien choisies et bien comprises,
plutôt que de multiplier les expériences rapides.
La science n'est pas faite de certitudes, elle est faite de questionnements et
de réponses qui évoluent et se modifient avec le temps. Tout ceci montre qu'il
faut privilégier avant tout l'enseignement de la démarche scientifique incluant
l'apprentissage de l'observation et de l'expérience.
Il faut également éliminer l'idée que la difficulté doit croître de la seconde
à la terminale. Au contraire, un esprit de quinze ans est stimulé par une
réflexion sur un sujet difficile autant qu'un esprit de dix-huit ans. Mais le
mot difficulté n'est pas synonyme de degré de mathématisation. La structure de
l'ADN est difficile à bien comprendre, la notion d'inertie en physique est
subtile à assimiler.
Enfin, et ce n'est pas la moindre difficulté de l'enseignement scientifique, il
faut pousser l'élève à se poser des questions et éviter de donner des réponses
avant qu'il ait formulé les questions. L'élève bien sûr ne va pas poser à lui
seul les "bonnes questions" - il ne faut pas être naïf - mais on peut
petit à petit amener la classe dans son ensemble si ce n'est à toujours énoncer
les questions pertinentes tout au moins à comprendre le mécanisme du
questionnement. Dans bien des cas, rien ne peut remplacer l'exposé historique.
Celui-ci a un côté culturel irremplaçable, qui situe la découverte scientifique
dans son contexte temporel mais aussi montre comment les découvertes
scientifiques ont influencé le cours de l'histoire. L'exposé historique permet
de mesurer la difficulté que l'humanité a rencontrée pour résoudre des
problèmes qui peuvent aujourd'hui sembler élémentaires (2000 ans pour que l'on
comprenne que la chute des corps dans le vide est identique pour tous les
corps, quels que soient leur volume ou leur masse).
Les mathématiques sont aujourd'hui dans une situation particulière. Science des
formes et des nombres, la mathématique est amenée à sortir de son style et de
ses pratiques traditionnelles grâce au développement et à la généralisation de
l'ordinateur. Elle se rapproche des sciences expérimentales, grâce à
l'expérimentation numérique, à la simulation, et à ce que l'on peut appeler la
démonstration empirique. En même temps, libérées du poids des calculs,
notamment en analyse, les mathématiques peuvent mieux se concentrer sur la
manipulation de nouveaux concepts, sur le développement de nouvelles
applications comme celles requises justement par l'informatique. Ici encore le
récit des développements et des débats historiques, des approches variées de
l'efficacité nouvelle des mathématiques appliquées doivent faire partie
intégrante de l'enseignement. La notion de fonction est centrale au lycée et
son étude donne l'occasion d'aborder des phénomènes non linéaires dans diverses
disciplines.
Alors même que nous développons l'usage des technologies de l'information et de
la communication au lycée (95 % des lycées sont connectés sur Internet), on ne
comprendrait pas que l'enseignement scientifique ne soit pas en priorité engagé
dans cette utilisation. Tous les programmes seront donc réalisés en faisant
appel à ces techniques.
… extrait de http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde1.htm
Voilà en effet un contexte clairement décrit et une conjugaison d’objectifs parfaitement exposée. On est frappé par l’effet d’écho entre la première déclaration de cet extrait « l’enseignement des sciences au lycée est d'abord conçu pour faire aimer la science aux élèves » qui répond directement à l’appréciation dubitative portée en général actuellement par les acteurs et bénéficiaires du système lui-même. Immanquablement, on se prend à rêver : et si c’était possible ? Somme toute la juxtaposition d’objectifs entre s’occuper des bons, mais aussi de tous les autres, pourrait ne pas être trop gênante, comme une situation de "classe unique" où l'on poursuivrait plusieurs objectifs en parallèle. Pourquoi d’ailleurs, ne pas imaginer un système où les plus doués pourraient aider les autres... Et qui donnerait ainsi à chacun la dimension scientifique qui manque à sa culture « générale ».
Mais en fait, cette juxtaposition se trouve transformée en concurrence, parce qu'il n'y en fait qu'un seul système d'évaluation et que ce système est fondé sur le tri des meilleurs et le classement des élèves en "plus ou moins bon en maths". Quand on dit qu’il s’agit de « faire aimer les sciences à tous », cela sous entend que le à la fois donner le goût et les mauvaises notes aux mêmes élèves :
Et de fait, se plonger dans le contenu détaillé des items du programme fait déchanter… On mesure facilement le grand écart entre ces louables intentions et le caractère patchwork pointilliste des contenus[37] à enseigner en regardant : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs2/physique-chimie.pdf où sont listés les objectifs détaillés introduits par le texte de l’encadré XX. [38]
Donc, soit on est reconnu « bon » parce qu'on a des bonnes dispositions et des bonnes notes, soit on est exfiltré, évacué du monde scolaire et universitaire scientifique vers d’autres horizons (L, B ou autre). Et force est de constater que cette évacuation - éviction ne se fait pas en douceur. Elle est décidée et marquée par le sceau de l'échec dans les disciplines scientifiques. Double échec sémantiquement symbolisé par la répétition des « erreurs » de calcul et des « mauvaises » notes. Du genre « dommage, tu n’est pas au niveau pour continuer dans une filière scientifique. »
On devine le risque de dégât – dégoût qui peut résulter individuellement de cette décision et de ce constat et de multiples auteurs s’y attachent dans le même esprit que Stella Baruk, André Giordan ou Seymour Papert.
A.5.8 La majorité garderait-elle forcément un mauvais goût ?
Comment espérer que le système soit assez bivalent pour pouvoir faire comprendre aussi que l’on pourrait garder « goût et intérêt » pour les sciences, malgré cela ? De fait, on trouve quelques exceptions de personnes qui restent avec « encore un peu de goût pour un peu de sciences », malgré un échec dans les disciplines scientifiques dans sa scolarité, mais elles ne sont pas légions. Et bien sûr, facile à deviner, elle garderont ou développeront un goût pour des activités peu scolaires (non sanctionnées et non sanctionnantes) , comme l’astronomie, les jeux de réflexions ou la météorologie… En revanche, il y a peu d’amateurs physiciens ou mathématiciens et encore moins qui ne soient pas bons en sciences en classe.
A cela s’ajoute quelquefois un commentaire du genre : « tu ne peux pas continuer dans les matières scientifiques. Ce n’est d’ailleurs pas forcément grave, tu pourras réussir dans d’autres matières… », commentaire sans doute destiné à prédisposer au deuil définitif des sciences d’autant que le malheureux 5/20 en trigonométrie ou le 4,5/20 en physique qui eurent finalement définitivement raison de vos dernières velléités de comprendre les exercices favoris du prof fut malgré tout obtenu au prix de terribles (mais vaines) souffrances et migraines les dimanches soirs… Mais c’est aussi un commentaire dont on peut penser qu’il puise des racines dans la vielle guerre des deux cultures chère à C.P. Snow [39] : allez, ils t’ont éliminé, rejoins nous dans l’autre camp, celui des « vrais » intellectuels. Maintenant tu pourras comme nous les mépriser cordialement…
Aussi il n'est pas surprenant que les deux objectifs (donner le goût à tous ou filtrer et préparer les meilleurs) se fassent clairement la guerre et que bien peu de professeurs, coincés de plus par les effectifs, les programmes et les horaires sachent favoriser le goût des sciences pour ceux que l'on va mal noter puisqu’ils ne sont pas naturellement attirés et bons en maths ou en sciences....
Et voilà, le système est ainsi fait qu’il procède par l’élimination par l’échec et les mauvaises notes. Tout au long de la progression scolaire, chaque année sont progressivement éliminés ceux qui ne peuvent suivre en math. Et l’on voit bien comment les mass-médias et autres « collèges invisibles » soulignent l’importance qui doit accordée à la question de la sélection des meilleurs, nourrissant des craintes –à la limite du rationnel- de désaffection des filières, voire de fuite massive des cerveaux… Bref, à n’en pas nier, le jeu semble en valoir la chandelle : pour raffiner les meilleurs, on est bien obliger d’accepter de prendre le risque de ne pas donner le goût des sciences (voire de dégoûter) à la plupart des autres.
Et donc, à force de n’enseigner que pour trier et préparer ceux qui vont continuer, n’est-il pas normal que la majeure partie de nos concitoyens n’ait plus envie de sciences ? Quelle image ont ceux qui ne font pas partie des 22% des élèves qui obtiendront un bac sciences (STI ou STL) ? ou des seuls 9% qui deviendront les professionnels des techno sciences ? Car bien sûr, les évincés du goût de la science sont bien loin d’être la minorité.
A.6. L’action culturelle pour rattraper tous ces dégoûtés
A.6.1 l’exception c’est le goût des sciences, et la norme le dégoût
Le graphique suivant donne les « niveaux scientifiques » de sortie d’une classe d’âge en France. La grande raffinerie qu’est le système éducatif exfiltre [40] chaque année les 150 milles qui n’auront que le Brevet ou moins. Un peu plus de 330 000 termineront leurs études scientifiques avec un niveau en « sciences » inférieur à celui des Bac S ou STI/L. Au total, 2 élèves sur 3 (près d’un demi million) n’auront pas de Bac scientifiques ou technoscientifique (STI-STL). Moins d’un sur dix atteindra finalement le niveau Bac+5 en sciences.
Figure 2 : variété des objectifs dévolus à l’enseignement des sciences selon l’âge
|
Finalités des enseignements scientifiques en France |
Ecole élémentaire |
Collège |
Lycée d’enseignement général (hors S ou STI et L) |
Premier cycle supérieur scientifique ou assimilé |
2° et 3° cycles des études supérieures scientifiques ou techno scientifiques |
|
Effectif moyen annuel estimé |
|
800 000, |
268 000 (G) dont 137 S 143 000 (T) 91 500 (Pro) |
65% du Bac S : 100 000 |
33 000 (Licences) Et 100 000 ingé (dont 1/3 de doubles inscriptions) |
|
Ceux qui continueront au-delà d’un Bac+2 dans un domaine scientifique |
Donner des repères et des outils de résolution de problèmes et de calcul,
Eveiller la curiosité et l’esprit critique |
Inculquer les bases des corpus disciplinaires à tous et préparer le tri des plus efficaces
Et peut-être prétendre au développement de l’esprit scientifique |
Préparer, pré -former et trier ceux qui continueront vers les techno sciences
Et peut-être prétendre au développement de l’esprit scientifique |
Inculquer les savoirs utiles aux enseignants ou cadres des techno sciences |
Adapter à leurs rôles les cadres supérieurs des techno sciences |
|
Ceux qui s’arrêteront à un Bac+2 dans un domaine scientifique |
Sorties : |
||||
|
Ceux qui s’arrêteront en sciences à un Bac S ou STI/L |
|
|
|
35% des Bacs S ou STI/L = 40 à 50 000 |
|
|
Ceux qui s’arrêteront à un Bac non scientifique |
|
|
|
Sorties sauf Bac S ou STI/L : 330 000 |
|
|
Ceux qui n’entreront pas dans un lycée d’enseignement général |
|
|
Sorties : 150 000 (brevet et moins) |
||
Loin de l’utopie, nous voilà de retour du côté obscur : loin de la « science pour tous », on le tableau quantitatif est sans appel : dès le collège, les disciplines scientifiques trient et préparent les fondamentaux de la future élite, laissant pour compte une large majorité, condamnée à des représentations résiduelles nourries de souvenirs d’échecs et d’inadaptation à des bachotages puérils. Vu sous cet angle, la désaffection d’un grand nombre pour les sciences n’est autre qu’un simple dommage collatéral de cette priorité trop fortement assumée.
A.6.2 L’école de la réussite pour tous, une impasse socio-économique
En tous cas, force est de constater que les actions de médiation culturelle scientifique se trouvent en parallèle avec un système éducatif (40 fois plus volumineux) qui s'est approprié les "matières scientifiques" comme principal moyen de sélection socio-économique et qui produit un effet dominant et contraire à toute tentative visant à donner l'envie et les moyens du partage du savoir pour le plus grand nombre.
Force est de constater que si la société avait vraiment besoin consensuellement d'une école de la réussite pour tous, elle ne serait pas si difficile que cela à mettre en œuvre, Il suffirait, comme le montre l’encadré 8, de dépasser ces matières et ces programmes qui ne font que répondre à des questions que l’on ne se pose pas, alors que l’on sait bien qu’il n’y a pas d’apprentissage s’il n’y a pas de résolution de problème appartenant à l’apprenant.
Encadré 8 : donner l’envie et les moyens de pratiquer une démarche expérimentale
Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que les pédagogies de la réussite sont possibles. L’échec scolaire n’est pas une fatalité. Sans doute, dirait même Bernard Charlot, n’existe-t-il même pas : « ce qui existe, ce sont des élèves en échec » [41] . Les pratiques de multiples associations d’éducation populaire (cf les expo sciences) et d’enseignants militants des pédagogies actives montrent qu’il est tout à fait possible de construire des situations pédagogiques où se manifestent et se développent la curiosité et l’intérêt des jeunes pour des activités scientifiques.
En France, le programme " la main à la pâte " est souvent cité. Loin d’être unique, cette expérience s’inscrit dans un ensemble d’actions expérimentées par de multiples acteurs de l’éducation populaire depuis plusieurs décennies. Ainsi, des associations spécialisées, comme l’Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, devenue depuis 2002 le réseau « Planète Sciences », les associations des « Petits Débrouillards », -voire disciplinaires comme l’Association Française d’Astronomie,- et des mouvements d’éducation populaire plus généralistes, comme les Francas, les Cemea, les Eclaireurs de France, la Fédération Française des MJC et la confédération des MJC ou encore la Fédérations Nationale des Foyers ruraux, la Ligue de l’enseignement ou encore la Fédération Léo Lagrange développent des pratiques de découverte scientifique par les jeunes et moins jeunes dans des ateliers, des clubs ou des centres de loisirs ou de vacances. De multiples programmes, inspirés par des pédagogies « nouvelles », c'est-à-dire constructivistes, ont ainsi vu le jour et s’institutionnalisent d’année en année, comme par exemple « collèges et lycées de nuit… », « un ballon pour l'école », ateliers Petits débrouillards, @teliers Ciel et espace. La grande majorité de ces associations se sont regroupés depuis 1985 au sein d’un collectif, le Cirasti (http://www.cirasti.org), Collectif Inter associatif pour la Réalisation d’activités scientifiques et techniques internationales. Comme le précise son plan stratégique 2005-2007, « Il se définit comme collectif français des associations d'éducation populaire oeuvrant pour le développement d'une culture scientifique et technique pour tous. Il n'a pas pour ambition de distinguer et faire progresser une élite de jeunes scientifiques, mais plutôt de contribuer à assurer au plus grand nombre les moyens de construire un savoir et des savoir-faire rationnels qui les aideront dans tous les actes de la vie ».
Sous l’impulsion de ce
collectif, et sur modèle d’inspiration québécoise ces activités de découverte
sont mises en valeur dans le cadre des "expo sciences" locales,
régionales ou nationales qui depuis une quinzaine d’années permettent à des centaines
de groupes de jeunes chaque année d’exposer leurs réalisations : « Imaginez ... un
lieu dans lequel de nombreux groupes de jeunes de 5 à 25 ans s’affaireraient à
vous présenter leur projet. Les thèmes ? Ils exploreraient tous les
domaines des sciences et techniques : l’espace, l’univers intriguant des
insectes, les bateaux et les vents, etc. Tout serait prétexte à piquer votre
curiosité !!! Vous y trouveriez un programme riche en animation :
manipulations, spectacles, expositions, conférences. Imaginez ... l’enthousiasme
de ces jeunes, le développement de leur curiosité, de leur esprit créatif et
critique, de leurs capacités à résoudre des problèmes. Imaginez ... ce lieu
ouvert à tous et visité par des milliers de personnes, familles, jeunes,
adultes, groupe scolaire ou de centre de loisirs.
Imaginer ? Pourquoi imaginer ? Il y a juste à regarder car ce lieu existe et est universellement connu sous le nom ... d’Exposcience. Vous voulez participer, tester votre dextérité, mettre à l’épreuve votre esprit critique alors laissé vous guider par les jeunes qui vous feront manipuler les expériences qu’ils ont réalisés…. » (Extrait du dossier de presse des 20 ans du Cirasti).
Une organisation Internationale, le Milset ( http://www.milset.org ) « Mouvement International pour le Loisir scientifique » coordonne d’ailleurs de nombreux réseaux du même type, -quoique que souvent plus spécialisés- dans la plupart des régions du monde et organise des expo sciences continentales et internationales, comme celle de Moscou en 2003 et celle de Santiago du Chili en 2005 (http://www.esi.org)
C'est en partant de ses propres observations, en cherchant à résoudre un problème qu'on identifie clairement que l'on découvrira le plus facilement l'intérêt et la pertinence des méthodes scientifiques. Chacune de ces actions montrent que, pourvu que les conditions de faisabilité soient remplies (pédagogie active, petit groupe, encadrement suffisant, formation des éducateurs, matériel ad hoc et réglementation adaptée) il est possible de donner l’envie et les moyens aux jeunes en âge de fréquenter l’école primaire, le collège ou le lycée de pratiquer de manière très profitable des activités de découverte et d’exploration scientifique : un constat connu depuis au moins deux décennies de tous ceux qui s’intéressent aux recherches pédagogiques et aux activités dites d’éveil. Alors, puisque de telles pratiques prouvent la possibilité d’intéresser les jeunes aux sciences, comment ce regard négatif des jeunes pour les études de sciences peut-il s'interpréter ?
Sans doute la réponse est-elle que ces pratiques si formatrices, si motivantes restent très marginales. Ainsi, la main à la pâte ne touche-t-elle qu'un élève du primaire sur quatre. Quant aux activités d'éveil et à la pédagogie active au collège, leur impact quantitatif est aujourd'hui extrêmement limité. Voilà un constat certes préoccupant, mais qui permet de définir une ligne d'action : la démultiplication massive de ces pratiques doit être la priorité de chacun. C'est d'ailleurs ce qui est affirmé avec force par la plupart des autorités et acteurs impliqués dans l'action culturelle scientifique. Or, là force est de constater que de telles activités d'éveil progressent assez sensiblement au primaire, mais que leur démultiplication stagne au collège.
Certes, les directives ministérielles prévoient la mise en place d'"itinéraires de découvertes" qui permettent d'offrir aux collégiens l'occasion d'une découverte active des sciences, en relations avec leurs centres d'intérêts, mais malheureusement pour la plupart d'entre eux, la rencontre avec l'univers scientifique est surtout marqué par la confrontation avec 4 heures hebdomadaires de mathématiques abstraites, voire arides et souvent vécues comme déconnectées des réalités et intérêts quotidiens. Ils sont bien peu nombreux ceux qui auraient dans ces conditions la chance de faire le lien entre leurs pratiques techniques, artistiques, sportives, de loisirs et la démarche scientifique.
Donc c’est faisable… Alors, comme au paragraphe précédent, nous revoilà confronté à la question de savoir pourquoi on ne généralise pas ces méthodes ? Et si la réponse était toute simple, évidente si l’on tente un raisonnement par l’absurde : imaginons une seconde que nos systèmes éducatifs atteignent la qualité totale et que l’instruction publique se mette à ne produire que des réussites pédagogiques. Que pourrait-on bien faire des sept cent cinquante mille Enarques et Polytechniciens qui arriveraient sur le marché du travail par an ? Et du manque cruel qui sévirait alors d'employés pour fournir les biens et services qui doivent développer concrètement les germes de richesses. Halte à l’utopie : par construction, le système éducatif ne peut produite un spectre de diplômés trop éloigné de la pyramide des emplois disponibles.
A.6.3 Conserver la hiérarchie sociale, et plus tard, minimiser les dégoûts
Voilà qui conduit à penser qu’il est loin d’être prioritaire de réussir à déconnecter à court ou moyen terme « mauvaises notes en sciences » de « dé-goût » et découragement. Rien d’autre à faire que de pester régulièrement contre cette situation, tester des « innovations pédagogiques » « très encourageantes » et constater combien il est difficile de les généraliser. Certes, peu nombreux sont ceux qui font remarquer que l’on bégaie et tourne en rond, mais c’est pourtant le cas.
Malgré tout, un univers dominé par la techno science comme le notre, ne peut fonctionner si une large majorité des citoyens craignent ou rejettent en bloc questions ou produits scientifiques : Le bon fonctionnement de l’économie et de la machine démocratique impose a contrario un minimum d’intérêt ou d’appétence de chacun. Sinon, qui achèterait la nouvelle génération des téléphones portables, qui respecterait le savoir médical ou qui accepterait de s’intéresser au tri sélectif ou aux dérèglements climatiques ? La société, dans toute sa diversité socio-politique a besoin d’un bon niveau d’acceptation du progrès techno-scientifique.
Aussi, si l’on ne peut éviter le dé-goût scolaire de la majorité, alors il faut trouver au moins un moyen de le compenser ensuite : Pour cela, il faut inventer un système de réparation (voire un système palliatif) qui limitera les dégâts collatéraux de l’effet « dégoûtant » de l’enseignement classique des sciences dans le secondaire et le supérieur. C’est par cette invention d’une « action culturelle scientifique et technique réparatrice » que nos sociétés agissent pour réparer et redonne ce goût et cette appétence. Voir plus loin à ce sujet l’encadré qui tente de démontrer que c’est précisément pour cette raison de « réparation » des consommateurs de techno sciences que s’est institutionnalisée en free lance de l’école l’action cultuelle de la culture scientifique et technique.
A.6.4 Et si on imaginait la fin des « deux cultures » ?
A contrario, nous faisons l’hypothèse qu’en fait un bon moyen de permettre le meilleur « développement de la culture scientifique pour tous » si tel est bien l’objectif serait justement de renoncer à la séparation artificielle et « post moderne » entre filières scientifique et filière humanité. Nous pensons qu’en fait c’est cette coupure artificielle conjuguée avec un enseignement dogmatique et abstrait des sciences et particulièrement des mathématiques qui est responsable du déficit culturel scientifique de nos contemporains. Nous pensons d’ailleurs que cette coupure a été inventée à l’époque moderne pour favoriser la production par le système d’instruction publique de nos pays du bon nombre de dociles et fertiles ingénieurs et scientifiques peu formés à la remise en cause méthodologique.
Questions à ce propos : nombreux sont ceux qui, suivant la voie de C.P. Snow, critiquent cette dichotomie ; mais qui oserait aujourd’hui construire une utopie sans cette séparation ? Au mieux, trouve-t-on quelques défenseurs d’une hypothétique troisième culture… bref encore plus de fragmentation. Pourquoi ne trouve-t-on personne pour oser regarder si l’hypothèse d’une fusion des premières et terminales S et L afin d’avoir une vraie formation générale, serait crédible ?
On imagine bien la réponse, a priori imparable : le volume de connaissance à acquérir ne le permet pas. Trop de choses à savoir pour que quiconque se risque à penser un tronc commun trop long. Jusqu’au Bacc ? Vous n’y pensez pas ! Les études sont déjà si courtes que les jeunes futurs scientifiques n’ont même pas le temps de savoir ce qui est utile dans leur domaine. Il faut au contraire spécialiser, si l’on veut qu’ils soient un minimum productifs. Or, le paradoxe de ce discours est évident. Selon la plupart des auteurs, [42], le volume de savoirs croit de manière exponentielle et semble doubler tous les quinze ou vingt ans. Or la durée de la scolarisation des élites ne progresse absolument pas dans la même progression. Bien sûr, il peut y avoir un peu de tassement… et une « méta morphisation » du savoir de base qui se compactifie et donc s’apprend plus vite. Mais force est de constater que l’instruction publique à renoncer à se vouloir exhaustive, puisque la durée de l’enseignement et a fortiori son augmentation n’est plus lié au volume de connaissances (voir encadré). Ce n’est donc pas cela qui s’oppose à ce que l’on refusionne L et S.
Encadré à écrire : la scientométrie montre que l’instruction publique ne peut être « cumulative »
Derek Price, dans « Little science, bIg science », définit un« coefficient d’immédiateté » de l’activité scientifique (ratio des scientifiques vivants et actifs par rapport à la totalité des savants ayant jamais existés sur Terre) qu’il évalue entre 81% et 96%. Cela signifie que cette fraction là de la science est actuellement en train de se faire. et que la construction des programmes « utiles » ne peut plus se concevoir par rapport à une vision statique des connaissances à l’instant t, faute de construire des futurs scientifiques déjà obsolètes avant leur première année de recherche.
Toujours selon Derek Price, la connaissance scientifique estimée grossièrement par le volume de publications (et aussi le volume de publications de résumés) est multiplié par deux tous les 10 à 15 ans.
Si l’on poussait l’utopie d’un bacs unique « culture générale »… on imagine bien la réponse : bon, ok… avec plus encore de tronc commun, vous pourriez certes donner le goût des sciences – a supposer que les méthodes pédagogiques soient à la hauteur- à bien plus d’élèves et donc de futurs citoyens… Don acte. Mais cela serait forcément au détriment des autres et cela nuirait donc à la qualité de la future élite scientifique… En quoi ? Parce qu’ils prendraient encore un peu plus de retard sur l’actualité scientifique des dernières années ?
Mais, de fait, il est facile de comprendre que le contraire se produirait et que les futurs scientifiques – a contrario – bénéficieraient aussi de cette réforme.
A.6.5 ….. qui soutiennent aussi la scolastique permettant la production de « science normale »
Si les lycées formaient des chercheurs non seulement ingénieurs mais aussi épistémologues, peut être seraient ils moins aptes à être productifs, c'est-à-dire à se maintenir dans un contexte de « science normale », au sens de T. Kuhn, sans risque de le déstabiliser par une critique trop précoce des bons paradigmes encore fertiles pour secréter des produits de techno science fort rentables économiquement.
En effet, en ce qui concerne la formation des futures élites scientifiques, l’analyse qu’en fait T.S. Kuhn dans « la structure des révolutions scientifiques » (même si ce texte date de 1960 ou de 1969 pour sa postface) reste particulièrement éclairante. Selon lui, l’enseignement supérieur scientifique ne vise à former que des bons élèves destinés à faire produire ce qu’il définit comme la « science normale » et se trouve ainsi volontairement filtré de la plus grande partie de ce qui pourrait permettre aux étudiants de comprendre (et donc de s’inscrire dans) l’histoire des idées : les bases de l’histoire des sciences y sont volontairement omises, voire transformées. « Pour remplir leur objectif, il n’est pas nécessaire que [les manuels universitaires et scolaires] retracent avec exactitude la manière dont ces bases ont été reconnues, puis adoptées par les membres de la profession. Dans le cas des manuels, tout au moins, il y a même de bonnes raisons pour que, sur ces questions, ils induisent systématiquement leurs lecteurs en erreur. »[43] Moralité : la question de l'infantilisation des élèves et des enseignants est incontournable.
A.6.6 Le Kids’ Power comme sortie de la crise éducative
Alors, n’y aurait-il donc plus d’espoir pour l’école ? Serions nous définitivement condamnés à l’infantilisation et non à l’empowment ? Seymour Papert, lui croit que la solution viendra de l’extérieur, de la maison (le monde réel ?) :lorsqu’on des enseignants lui demandent «Pourquoi pensez-vous que les ordinateurs apporteront autant de transformations alors que beaucoup d'autres innovations technologiques ont eu peu d'effet sur l'école ? [Il répond..] L'effet "Kid Power" ... je vous ai bousculé—mes collègues—pour que vous passiez à l'action. Plusieurs d'entre vous relèveront le défi. Beaucoup le font déjà. Mais la "vraie armée", celle qui amènera le système à changer est composée de "jeunes soldats". Les idées que j'ai exprimées s'épancheront goutte à goutte vers les jeunes—ou, plus probable, seront réinventées par eux. Les enfants qui auront grandi avec des ordinateurs à la maison seront de moins en moins enclins à se laisser influencer par des parents et des enseignants "aux discours creux" et aux "idées dépassées". Ils seront de moins en moins portés à adhérer à un système scolaire où l'occasion d'apprendre est inférieure à ce qu'elle est à l'extérieure de l'école ! Il y a une centaine d'années, John Dewey a critiqué l'école davantage que nous le faisons aujourd'hui. Il a obtenu un effet marginal parce que les arguments philosophiques n'ont jamais fait bouger un système social "figé". En tout cas, pas sans une armée. Les enfants agiront telle une "armée" pour notre cause.»
(Rédigé par Papert lui-même dans TECHNOS QUARTERLY Winter 1998 Vol. 7 No. 4 et rapporté par http://cyberportfolio.st-joseph.qc.ca/mario/archives/004580.html ).
L’autre espoir, ce serait la validation des acquis de l’expérience….
_____________ encadré à écrire...__l'enseignement scientifique ne sait pas être culturel !________________________
Pourrait-on se donner pas les moyens de mettre en place un système pédagogique différentié (ce que l’on arrive à construire dans des classes uniques par exemple) qui permettrait de remplir simultanément les deux familles d’objectifs ? Un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale intitulé « Place de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre dans l’acquisition d’une culture scientifique par les élèves des 1ères L et ES disponible sur :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/rapport_svt.pdf
indique que l'enseignement en première L et ES qui est pourtant clairement orienté sur la "culture scientifique", n'arrive pas à se détacher d'un conception dogmatique classique de l'enseignement des sciences". Quelques morceaux choisis :
« Contrairement aux intentions affichées dans
les réponses des enseignants, et en désaccord avec l’analyse
de l’intérêt de la spécificité des programmes on
constate que :
- l’acquisition de connaissances (cours dictés, notions surtout) est
privilégié ;
- la pratique d’un raisonnement scientifique ne se fait pas
de façon optimale et active
(utilisation du livre, de polycopiés, transparents), avec une exigence
certaine de rigueur ;
- l’ouverture sur les problèmes de société associés
apparaît à un moment ou à un autre (25
% des cas) mais plus d’une façon appendiculaire qu’au coeur d’un débat.
L’ordre des priorités indiqué dans les programmes se retrouve
inversé. Il est triste de constater qu’à partir d’une excellente
analyse théorique des intentions, on
puisse arriver à un résultat aussi frustrant pour tous : professeurs,
élèves, institution.
L’origine de ce détournement est probablement double :
- le poids des habitudes ainsi qu’en attestent les références
multiples à l’enseignement des filières scientifiques pris comme
modèle et le manque de diversification pédagogique dès
la formation initiale;
- la pression du baccalauréat. Celle-ci amène les professeurs
à chercher à « couvrir » le plus de notions possibles
pour ne pas être pris en défaut. Les contrôles se font
sous forme d’exercices correspondant à des formulations proches du
baccalauréat et ressemblent plus à une préparation exclusive
de l’examen qu’à des pratiques d’évaluation d’une formation
» (p15)
(…)
Il est donc clair qu’à l’heure actuelle, avec les habitudes
de fonctionnement qui sont celles de l’éducation nationale, l’indication
dans les programmes de références croisées entre
disciplines ne suffit pas à leur mise en pratique. Les élèves
ne construisent ni l’unité de l’enseignement scientifique, ni la culture
du complexe. Devant l’échec de cet objectif pourtant fondamental, il
s’impose de réfléchir à l’utilisation d’autres leviers.
(p16)
(…)
Quelle place cet enseignement occupe-t-il dans l’acquisition d’une culture
scientifique par les élèves des classes de 1ères L et
ES ? D’un point de vue qualitatif, force est de reconnaître qu’il s’inscrit
trop dans la continuité de l’enseignement général de
SVT dans un cadre indifférencié pour porter l’originalité
et la spécificités inscrites dans les programmes. Le poids des
habitudes, la pression du baccalauréat peuvent-ils être contrebalancés
par d’autres influences, susceptibles de déclencher des réactions
salutaires et d’aboutir à une mise en oeuvre adéquate de ces
programmes aux intentions remarquables ? Quels sont les facteurs
susceptibles d’agir, et quelles évolutions envisager ? (p18)
(…)
… il faudrait pourtant que les enseignants prennent conscience que l’on peut
prendre plus de temps pour la formation, la culture, le débat sans
mettre en danger le résultat des épreuves. Au contraire, l’exercice
de la réflexion permet une maturation plus efficace pour les élèves
que cette recherche angoissée d’un exhaustivité qui prend comme
référence idéale les contenus de la filière scientifique.
(p20) Mais c’est probablement en amont, dans les habitudes prises, qu’il faut
rechercher et traiter
les causes de cet échec : on n’assouplit pas d’un coup de baguette
magique, dans une section spécifique, des regards qui mènent
à confondre rigueur et rigidité, et à mépriser
la science qui s’applique. La diversification pédagogique doit être
mieux préparée en formation initiale. Cet enseignement montre
aussi la difficulté qu’éprouve le système à mettre
en oeuvre des objectifs dépassant l’élaboration de savoirs et
de savoir-faire exclusivement disciplinaires. Ces classes ne sont d’ailleurs
pas les seules concernées : plus largement, on peut se demander si
les intentions culturelles explicites dans les programmes de première
et de terminale sont prises en compte dans la formation, dans la mesure où
elles ne passent pas au premier plan dans le cadre de l’évaluation.
(p22)
Alors, nous voilà ainsi prisonnier de notre système et voilà pourquoi pourquoi des générations entière sont-elles à au moins au deux tiers [44] dégoûtées des sciences ? L'on en vient à se demander si la volonté de donner l'envie et les moyens à tous les jeunes de s'intéresser aux sciences est véritablement consensuelle. Ne subsisterait-il pas là des vestiges d'une conception de la pédagogie d'un autre âge, développée avant tout pour les besoins de la sélection ?
Serait-ce à cause d’un choix d’objectif ? Aujourd’hui, derrière ces cours de sciences infantilisants, on perçoit d’abord une incohérence d'objectif, responsable là encore d’un cahier des charges paradoxal, obstacles à la persévérance de enseignants, responsables d'actions velléitaires. En effet, en interrogeant les différents acteurs (et prescripteurs) du système éducatif, il est aisé de vérifier qu’au moins quatre points de vue se croisent en matière de missions dévolues à l’enseignement des sciences : alphabétisation « abécédaire » scientifique au sens de connaissance des quelques outils, comme le calcul numérique, notions et faits jugés comme indispensables, formation de l’esprit scientifique, formation des futurs producteurs de la science et de la techno science (chercheurs, ingénieurs…), sans oublier bien sûr la mission « canonique » de sélection « rationnelle » (c'est-à-dire au mérite intellectuel plus que par héritage social) des élites.
B.1. Science, culture et technique, trois ambiguïtés imbriquées…
Ces ambiguïtés d’objectifs renvoient bien entendu à la polysémie du terme « culture » dans l’expression « culture scientifique et technique ». Mais ce consensus mou se nourrit aussi de l'ambiguïté des représentations de la qualification de « scientifique » (a fortiori de la culture scientifique) ainsi que d’un amalgame implicitement et étrangement validé entre « scientifique et technique » [45].
Voilà donc un imbroglio sémantique à examiner en gardant en tête ce qui nous conduit à vouloir clarifier ces ambiguïtés. D’un côté, on a du mal à imaginer de déclarer prioritaire le développement d’une « culture scientifique et technique » que l’on ne saurait préciser ; de l’autre nous voyons bien l’impossibilité dans laquelle nous serions d’en trouver une définition unique. Sans doute devrions nous concentrer nos efforts sur trois questions pragmatiques. D’abord, est-il possible de trouver une représentation consensuelle de ce qui est désigné comme « scientifique » par les acteurs et les politiques et si, oui laquelle ? Ensuite, quels peuvent être le sens et les conséquences d’un amalgame du « scientifique et technique » ? Enfin, est-il possible de préciser sous quel angle est en l’occurrence employé le terme de « culture » ?
Commençons par la qualification de « scientifique ». Au vu des ambiguïtés relevées plus haut sur les objectifs des acteurs, on est tenter de se demander si le même type de consensus mou ne serait pas installé en ce qui concerne la représentation du champ qualifiable de « scientifique » et s’il ne résulterait pas de cet état de fait un amalgame de programmes d’actions à nouveau paradoxaux, cette fois au regard de ce nouveau critère. Et de fait, c’est ce que nous allons tenter d’établir.
Bien sûr, cette question a d’autant plus de légitimité que le caractère scientifique est en lui-même ambigu : au-delà des efforts de multiples écoles de philosophie et d’épistémologie, de Platon, à Popper complété par Lakatos en passant par Bachelard, le signifiant « scientifique » reste vigoureusement polysémique : il n’existe pas à ce jour de définition unanimement reconnue de la ou les sciences et encore moins du caractère « scientifique » [46] ; le fait même de vouloir en établir une est d’ailleurs en soi source de débat [47].
Or (voir encadré n°3) nos trois rapports ne cherchent pas à préciser ce qu’ils entendent par « scientifique ». D’où une interrogation : Comment interpréter un appel à une « culture scientifique » qui n’éprouve pas le besoin de définir le « scientifique » en question ?
Encadré 3 : les trois rapports ne donnent pas de définition du caractère « scientifique » de la culture qu’ils veulent promouvoir.
Comme cela a été signalé plus haut, les rapports politiques parlent surtout du « statut » et de la représentation de la science par l’opinion publique, principalement pour constater qu’elle serait aujourd’hui perçue de manière plus ambiguë qu’avant. Ainsi, le rapport Renar-Blandin précise que « … le statut des sciences et des techniques et la façon dont elles sont perçues par l'opinion ont considérablement changé depuis une trentaine d'années. Tout d'abord, la science elle-même est en pleine mutation. L'extension du champ des connaissances a encore accentué la spécialisation des chercheurs […]. Simultanément, la recherche s'attache en outre à des objets de plus en plus complexes et aboutit au terme de cheminements abstraits faisant une place croissante à la modélisation, à des assertions parfois déroutantes pour le sens commun et l'intuition sensible. En même temps, le nombre d'entreprises innovantes qui, à partir de recherches fondamentales ou appliquées, lancent de nouveau produits sur le marché, s'accroît. Le raccourcissement des délais de mise sur le marché de produits nouveaux, à partir d'innovations, est caractéristique des dernières décennies. Les jeunes s'en réjouissent et, souvent, les moins jeunes le déplorent. Enfin, la recherche scientifique touche à des domaines qui intéressent de plus en plus directement le destin des individus et l'avenir de l'espèce humaine. Les effets de l'industrie et certaines applications […] inquiètent parfois à juste titre. Et l'on confond la science et l'usage immodéré des techniques et des produits : automobiles, transports... Il en résulte un glissement dans la vision que nos contemporains ont de la science : celle-ci n'est plus assimilée au progrès dans une vision positive qui avait largement cours il y a trente ans, mais relève d'une perception plus ambiguë. Les enquêtes d'opinion confirment ces impressions. » Ainsi, on parle là de l’évolution récente du statut, de l’image publique de la science, on effleure la question de la confusion entre activité scientifique et usage immodéré de ses dérivés, on précise que la recherche est abstraite, complexe, déroutante pour le sens commun, mais on ne fournit finalement pas de cadre de référence précis au caractère « scientifique ».
C’est aussi la défiance du public vis-à-vis d’une « science se fourvoyant » [48], qui fait l’objet de l’introduction du rapport Hamelin. Y est aussi proposé un « un extrait de l’excellente intervention de Monsieur Etienne-Emile BAULIEU, Président de l’Académie des Sciences, intervention qu’il a prononcée lors de la séance solennelle de rentrée des cinq Académies, sur le thème : « Changements de la science, progrès pour l’Homme ? ». Ce texte qui est donné dans son intégralité en annexe est plus un plaidoyer pro domo qu’une définition du caractère « scientifique ». On y lit : « L’Homme domine le monde vivant, grâce à la science. Celle-ci progresse sans nul doute, mais soudain une question surgit : ses changements contemporains seraient-ils devenus contre-productifs ? Comment cette science plus féconde que jamais, si spécifique de notre espèce, peut-elle être mise en examen au tribunal du progrès humain ? L'humanité est-elle devenue hypocondriaque pour douter à ce point de sa santé collective ! Le sentiment de progrès est un sentiment de confiance ; aujourd'hui le doute a remplacé la confiance. […] La science a libéré l’homme de ses peurs, de ses superstitions d’une nature enchantée car la science donne à voir la nature comme indifférente. C’est en quelque sorte un libre arbitre conquis par rapport à la nature. Mais désormais l’homme s'interroge : saura-t-il protéger la nature de lui-même et de ses excès ?
[… La] découverte théorique de la maîtrise des gènes inquiète : en suscitant une alternative à la sélection darwinienne, la science fait accéder l'homme à un niveau jusque-là réservé à l'obscur dessein de l'évolution, si ce n'est à une puissance divine plus ou moins redoutée. [..] A-t-elle la tentation du pouvoir ? Les hommes de science d'aujourd'hui ne sont pas, contrairement à l’image du positivisme d’Auguste Comte, les adeptes du «tout-scientifique », pas plus que d’un quelconque « tout-économique ». Ils savent que ce sont les croyances, les valeurs morales, politiques, culturelles
et affectives d’une époque qui déterminent le bon ou le mauvais usage des découvertes. […] On pourrait aujourd'hui avoir la tentation de s'en tenir aux acquis d'une humanité qui dispose déjà de tant de moyens pour mieux vivre, et choisir de mieux les partager. Je comprends ce sentiment, cette intuition qu'il faudrait marquer une pause. Mais il ne faut pas compter sur un palier de l'évolution scientifique, sur un moratoire du changement : c'est une hypothèse totalement irréaliste – et bien des conservateurs tranquilles, qui ne me sont pas antipathiques pour autant, vont le regretter. L'homme invente, veut savoir toujours plus, qu'il s'agisse du climat, des planètes alentour, des possibilités de vie prolongée en bonne santé et pleine lucidité. C’est irrépressible. Aux hommes et aux femmes, à leurs représentants, à leurs civilisations, d’en faire des bonheurs, d’accompagner ces percées, et d’inventer les règles de vie qui en feront des progrès pour le genre humain ».
Voilà donc, en lieu et place d’une définition introductive, un acte de foi pour une science « irrépressible » ayant libéré l’homme de ses peurs, de ses superstitions d’une nature enchantée, un libre arbitre conquis par rapport à la nature ; dont on indique cependant qu’elle ne résout pas tout contrairement à celle d’une « image communément admise » du positivisme d’Auguste Compte.
Même type d’introduction, sans définition précise du « scientifique » dans le texte du plan Aillagon : l’introduction (dont le texte intégral est aussi en annexe) est également focalisée sur la question de l’évolution de l’image de la science et de la technologie. « La Science et la Technologie sont trop souvent présentées dans les médias comme étant essentiellement sources de problèmes : on ne parle que rarement de la première pour montrer que son rôle est toujours nécessaire pour révéler et comprendre ces problèmes, ni de la seconde pour dire qu’elle peut apporter des solutions, lesquelles sont ensuite mises en oeuvre, ou ne le sont pas. On oublie qu’Internet ou le téléphone portable sont des conséquences du travail de physiciens, et les immenses succès de la science finissent par créer une sorte de saturation de l’émerveillement, tout en laissant subsister l’inquiétude. Au Québec, on essaye d’attirer des enseignants étrangers afin de les recruter dans les Universités, grâce à une dispense de tout impôt sur le revenu pendant cinq ans. »
Plus loin, le texte développe la dimension paradoxale d’un intérêt et un désenchantement simultané vis-à-vis de cette science « Il en va des Français comme des autres Européens, dont la moitié déclarent un intérêt pour la science et la technologie. Dans le même temps les manifestations du progrès scientifique suscitent un certain scepticisme, voire de la méfiance. Les Européens portent un regard désenchanté sur les sciences. Les risques nouveaux associés aux avancées technologiques sont aussi présents à leur esprit que les progrès liés à l'innovation. Face à l'évolution très rapide des techniques et des sciences, les citoyens manquent de repères pour comprendre le monde qui les entoure… En poursuivant, à l’occasion d’un surprenant commentaire sur les dangers de la superficialité des loisirs scientifiques, le texte suggère que la démarche scientifique est une activité « aride et stricte », dont la définition est toujours considérée comme allant de soi : « L'ambition économique de la France nécessite de plus en plus l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. Or les vocations scientifiques reculent. Les inscriptions dans les filières de sciences de la matière diminuent par exemple de 4 % par an. S'interroger, s'intéresser aux sciences est une chose. Affronter la matière aride de la science, accepter les règles strictes de la démarche scientifique en est une autre. Le découplage entre l'intérêt ludique pour les sciences et l'engagement dans un métier scientifique n'est cependant pas une fatalité. Par exemple, l'organisation par l'Allemagne en 2000 d'une « Année de la physique » a réussi à inverser la tendance [..].
En bref, quelque soit le texte fondateur, à une référence près à l’obsolescence du « positivisme d’Auguste Compte », le caractère « scientifique » semble une évidence implicite. La science est omniprésente, en étroite interaction avec la ou les technologies et concerne tout le monde. Doit donc exister une action culturelle « scientifique et technique » dont la nécessité pour tous est évidente, sans qu’il soit utile de clarifier sur quelle représentation de la ou les sciences elle doit s’appuyer… sans doute faut-il juste trop éviter d’être « ludique » et de prôner le « tout scientifique ».
Nous voilà donc face à un caractère « scientifique » qui n’est qu’implicitement défini ; la comparaison avec d’autres catégories culturelle est tentante. Prenons par exemple la culture « musicale » : pour en parler, voire même pour agir « en sa faveur », est-il vraiment nécessaire de définir une démarcation précise de ce qui est musical ou ne le serait pas ? Pas vraiment… il suffit de regarder comment fonctionnent la fête de la musique, mais aussi celle du patrimoine. Certes, les tenants de la pédagogie du Karaoké ont des appréciations fort différentes de celles des professeurs de solfège traditionnel, de hip hop, de musique concrète ou des producteurs de la « Nouvelle star ».
Toujours est-il qu’en première approximation, pour définir la Fête de la musique, on pourrait dire que la musique, c’est ce qui semble harmonieux aux oreilles d’un nombre significatif de nos congénères … à moins que ce ne soit ce qui s’achète et se vend dans des magasins de disques…ou alors ce qui s’enseigne dans des « cours de musique ». Trois définitions, donc l’une par le « marché », la deuxième par « les pratiques scolaires et/ou culturelles officielles» et la dernière par une démarcation fondée sur des critères de contenu. De fait, les promoteurs de la Fête de la musique ne choisissent pas et agissent juste dans l’implicite d’autant que et de toute façon, dans la musique, se fait une régulation par la demande des publics.
« Scientifique » est bien entendu moins signifiant pour tous que « musical » et la régulation par les publics moins évidente. Malgré cela, nos promoteurs de la culture scientifique se comportent comme ceux de la Fête de la musique. Ils ne choisissent pas, ni forme de définition, ni un quelconque critère de démarcation. Sans vouloir ici épiloguer sur la cause de cette absence de choix, notons simplement qu’il en résulte beaucoup de flou aussi bien en terme de qualification et d’évaluation de l’offre (en quoi l’émission « Rayons X » citée dans le plan Aillagon comme exemple de la contribution de France Télévision est elle une émission scientifique ?) qu’en terme de limites disciplinaires (jusqu’où les sciences humaines rentrent elles dans le champ de la culture scientifique : sciences de la communication, sociologue, ethnologie ?).
B.2.1 Y a t’il un commun dénominateur implicite et consensuel ?
Pour retrouver un terrain solide dans un tel flou, focalisons nous sur deux questions concrètes et claires. De fait, ce qui serait pertinent serait de voir si les différents acteurs et décideurs ont des définitions implicites (ou explicites) semblables ou différentes, compatibles ou incompatibles.
Première question, le plus grand commun dénominateur : y a t il une définition implicite du « scientifique » qui satisferait nos promoteurs ?
Qu’est ce qui serait implicitement « scientifique » ? A minima, ce qui s’oppose à l’« irrationnel », ce qui peut renvoyer à une définition très ouverte, comme celle donnée dans le livre V de la République de Platon qui regarde la « science » comme synonyme de « connaissance stable » par opposition aux autres formes de persuasion, que sont celles de l’opinion qui elle est changeante et s’appuie sur la foi, la superstition, l’autorité d’un auteur ou d’un texte sacré. Avec un cran de plus de sélectivité ou de démarcation [49], peut-être pourrions nous évacuer notre problème : considérer que les tenants officiels de la culture scientifique s’appuient implicitement sur une définition de la science, comme étant une production qui peut s’étayer par l’expérience ; à ce sens, l’activité scientifique s’oppose aux arguments d’autorité ; elle est le domaine de la preuve empirique, fondée sur l’études des « phénomènes » et de leurs régularités ou irrégularités.
Bien sûr cette question du niveau de rigueur face à cet hypothétique « irrationnel » rejoint aussi la question des disciplines : sciences « phénoménologique » de la nature, sciences transcendantales des mathématiques, sciences humaines…et même peut-être sciences au sens de « construction de tous savoirs étayés». Grand silence la dessus de nos trois promoteurs…. Dans l’esprit, on ratisse large. en se rattachant par exemple à la démarcation plus fine de Karl Popper [50] entre ce qui serait scientifique et ne le serait pas. « Etayable » pour Platon, « vérifiable » si l’on est Claude Bernard ou « falsifiable » pour Popper [51]. Bien sûr cela
Seconde question : la consensualité. Au-delà de cette très large définition de la « scientificité » en forme de plus grand commun dénominateur peuvent subsister de multiples divergences de regard sur les sciences, leurs périmètres et leurs places, historiques, sociales économiques, formatives. En effet la « scientificité » et à la question mono dimensionnelle de sa démarcation plus ou moins rigoureuse, n’est qu’un premier niveau d’encadrement de la science comme le montre l’encadré 4.
Encadré 4 : un débat loin de se réduire à la seule question de la démarcation de la scientificité
Bien sûr, les différences entre les différentes définitions de « scientifique » ne s’ordonnent pas simplement selon leur degré d’ouverture ou d’exclusion, le long d’un axe unique allant de Platon à Popper en passant par Descartes et Claude Bernard. Elles ne diffèrent pas seulement selon leur caractère laxiste ou restrictif. D’autres variables interviennent, non des moindres et non sans effets [52].
Premier exemple d’autre variable, l’univers de référence considéré : on peut parler du caractère scientifique d’une expérience isolée, comme Claude Bernard aussi bien que celui d’un programme entier de recherche (la vie extra-terrestre, les rayons X ou N, l’échec scolaire), ou d’un paradigme (le phlogistique, le géocentrisme, le big bang) comme Thomas Kuhn, voire même d’un corpus de savoir, disciplinaire ou non (la mécanique des fluides, la topologie, la sociologie, la psychanalyse et pourquoi pas le marxisme).
Deuxième exemple, le rapport à la nature et aux observables. Science est elle synonyme d’étude de la régularité des phénomènes, voire de phénoménologie ? Cela renvoie bien entendu aux débats sur les énoncés synthétiques ou analytiques, à la place des mathématiques et à la célèbre phénoménologie transcendantale d’Husserl.
Troisième exemple, le caractère unitaire ou disciplinaire : parler de la Science n’est pas parler de disciplines scientifiques désunies. Dans le « rationalisme appliqué [53]», Bachelard affirme qu’il ne faut pas hésiter à « fragmenter le rationalisme pour bien l’associer à la matière qu’il informe aux phénomènes qu’il règle, à la phénoménotechnique qu’il fonde ». Peut-il y avoir malgré cela, une seule culture scientifique transdisciplinaire ? Si, oui est elle compatible avec l’épistémologie Bachelardienne ? Et au fait quelle est la place de la culture des sciences sociales dans la CST ?
Un projet culturel au dessus de la mêlée sémantique
Certains pourraient penser que nous sommes reparti à couper les cheveux en quatre, mais malheureusement, les ambiguïtés générées par l’absence d’une définition unique de la science influent sur la nature des projets et effets culturels. Deux questions exemples illustreront aisément que le projet culturel ne peut pas si facilement être affirmé comme indifférent à la représentation de la science.
Première question : culture d’une science libératrice ou aliénante ?
Le projet d’une action « culturelle scientifique et technique » citoyenne s’appuyant sur la représentation de la science d’Auguste Compte pourrait-il être le même que celui qu’il s’appuierait sur la représentation de Herbert Marcuse dont le célèbre jugement « la puissance libératrice de la technologie –l’instrumentalisation des choses- se convertit en obstacle à la libération, elle tourne à l’instrumentalisation de l’homme » a constitué le point de départ du recueil « la technique et la science comme idéologie » de Jürgen Habermas. ? Quelle place ce projet culturel « scientifique et technique » peut-il laisser à ceux qui s'interrogent comme Paul Feyerabend, pour qui la science « n’est essentiellement supérieure qu’aux yeux de ceux qui ont opté pour une certaine idéologie, ou qui l’ont acceptée sans avoir jamais étudié ses avantages et ses limites » [54].
Deuxième question : culture de la croissance universitaire de la science ou de la croissance technoscientifique ?
Dans sa préface de « Repenser la science », Jean-Jacques Salomon, résume la récente vision développée par les auteurs d’un conflit entre deux systèmes actuels de croissance de la science : « Nous vivons sur une idée reçue de la science et de la pratique de la recherche : il y a désormais deux modes de production du savoir, l’un prolongeant et étendant l’autre, mais chacun correspondant à des acteurs, des références disciplinaires, des institutions et surtout des demandes très différentes. Le mode 1 traditionnel, qui s’appuie sur l’apprentissage de la recherche lié à l’option d’une discipline spécialisée, demeure le propre de la recherche universitaire, alors que le mode 2, multidisciplinaire, se développe en dehors du strict cadre des universités, dans les laboratoires privés et publics, à finalité industrielle, sur la base d’enjeux commerciaux, mais aussi d’enjeux de société et de finalités collectives exprimées par la sphère publique […] Le mode 1 nourrit le progrès des sciences de ses réponses à ses propres demandes, le mode 2 tend à créer de nouveaux besoins sociaux tout autant qu’il répond aux demandes de la société.» Alors CST du mode 1, du 2 ou des deux ?
Si l’on poursuit plus loin, on pourrait sans difficulté ajouter d’autres interrogations plus philosophiques, comme celle de la matérialité des objets scientifiques :
Peut-on prétendre savoir ce que désigne « science » et surtout « culture scientifique » en éludant une simple question comme celle de savoir si des théories scientifiques (logique ou mathématique, par exemple) peuvent exister dans l’absolu où ne peuvent qu’être subordonnées à nos tentatives de descriptions de nos perceptions des phénomènes ? Pour prendre un exemple historique célèbre, peut-on ignorer la question de réalité des atomes et refuser de se demander s’ils sont des objets matériels ou des outils de facilitation de la conception intellectuelle ? Nous sommes là loin d’une ambiguïté anodine ; comme le disait Ernst Mach « Une personne qui ne connaîtrait le monde que par le théâtre, si on l’amenait dans les cintres et qu’on lui permettait de voir les mécanismes employés pour la pièce, pourrait peut-être croire que le monde réel en a également besoin, et que si on parvenait à les explorer à fond une fois pour toutes on saurait tout ce qu’il y a à savoir. De même, il ne faudrait pas de nous prenions pour les fondements du monde réel, la machinerie intellectuelle que nous utilisons pour la représentation du monde sur la scène de notre pensée ».
B.3. Des divergences sur le périmètre socioculturel des processus scientifiques
Il en va d’ailleurs de même pour les acteurs et les actions concrètes : ce n’est pas tant sur la définition de la scientificité que se différentient les pratiques, les acteurs n’éprouvant en général aucun besoin de se référer à une quelconque démarcation scientifique - non scientifique à l’instar de nos trois rapports fondateurs [55] : Planète sciences, les Petits Débrouillards, l’Afa, l’Asts ne sont pas plus Platoniciens que fils de Lakatos et tel ou tel CCSTI n’est pas plus explicitement Comptien ou phénoménologiste qu’un autre. Tout au plus incluent-ils plus ou moins de technologies (robotiques, fusées, modélisme et autres travaux publics sont largement présents dans les stands des expo sciences)…et de sciences non dites exactes. C’est donc bien au-delà de cette question de la démarcation que les divergences liées à aux écarts de représentations des sciences apparaissent surtout : quelques lectures à citer ici suffisent pour percevoir que les diverses organisations ne parlent pas de la même façon de l’activité techno scientifique, sans pour autant chercher vraiment à formaliser les unes par rapport aux autres leur spécificités sur ce point.
Nous formulons ici l’hypothèse qu’il existe en France actuellement trois perspectives selon lesquelles les techno sciences sont regardées : Nous les qualifions respectivement d’« encyclopédiques », de « méthodologiques » et de « socio-économiques ». Tout se passe en effet comme si on était face à trois visions divergentes du champ de la science, fondées sur des perspectives différentes selon lesquelles les acteurs regardent le périmètre de la « fonction scientifique » qu’ils se proposent de mettre en culture ;
Ce point de vue conduit en première approximation à distinguer :
- une première catégorie d’acteurs, (comme l’inspection générale de l’éducation nationale) favorise une représentation des sciences comme des corpus de connaissances, décrivant le monde environnant et permettant la prédiction des phénomènes,
- une deuxième (par exemple les formateurs « expérimentalistes » de l’éducation populaire spécialisée, comme ceux de planète sciences) celle d’une système d’étayement des savoirs (la pensée scientifique vue comme un contrepoids des pensées magiques) utile à tous, pouvant permettre l’émancipation des individus,
- une troisième catégorie (celle des acteurs qui se revendiquent du courant « science et société », comme ceux qui produisent des cafés philosophiques) enfin s’intéresse plus à la mise en culture des sciences [56] vues comme des mécanismes socio-économiques et culturels, nécessaire au fonctionnement d’une bonne démocratie technoscientifique.
B.3.1 Abécédaire, construction des savoir ou intelligence d’un process social ?
Nous voilà donc face à trois finalités différentes à l’action culturelle scientifique : maîtriser un corpus de notions et concepts (en portant le regard 1), favoriser la maîtrise de méthodes d’étayement de ses savoirs (en portant le regard 2) ou alors mettre en culture les processus socio-économique de la production techno scientifique (en portant le regard 3). Trois exemples de programme pédagogique éclaireront cette typologie de « regards » : celui d’un cours d’initiation à l’astronomie du type Palais de la Découverte ou Université de tous les savoirs, celui d’un centre de vacances 14-18 ans à dominante astronomie de Planete-sciences ou enfin celui d’un cycle de café des sciences organisé sur le thème « exploration ou colonisation spatiale ?».
Certes ces trois regards ne sont pas complètement détachées de la question de la définition du caractère « scientifique », et l’on pourrait défendre l’idée que les premiers, sont plutôt Bachelardiens, les deuxièmes plutôt Claude Bernardien et que les troisièmes peuvent être dits Kuhniens ou Latouriens, selon qu’ils défendent plus une analyse sociologique des mécanismes interne au monde scientifique ou externe.
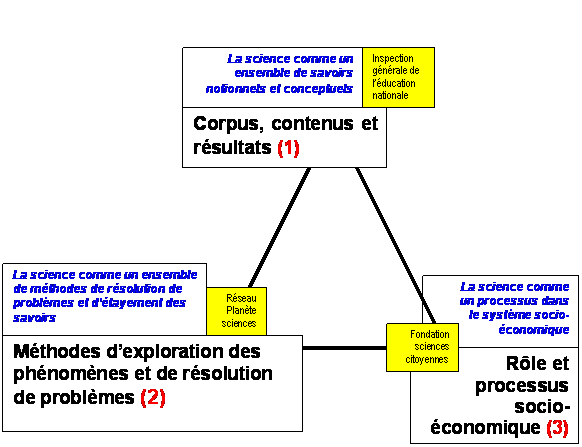
Figure 4 - 1 : Représentation des trois regards sur la science portés et véhiculés par différentes familles d’acteurs (des exemples d’acteurs étant donnés en jaune)
B.3.2 Un tripôle dont chacun ne voit que « son » dipôle
Attention, cette distinction en trois regards ou perspectives sur les activités scientifiques est loin d’aller de soi parmi les acteurs de médiations technoscientifiques. De fait, on constate que la plupart des acteurs d’entre eux font plus référence à l’opposition de deux perspectives : celle des corpus d’une part et la leur propre.
Ainsi, on trouve dans la période 1970-2000 chez les acteurs historiques de l’animation scientifique (ANSTJ devenue depuis Planète sciences, les Francas, les Cemea –au sein de leurs groupes ADST en particulier) une opposition en deux pôles, l’un étant celui des « résultats », recouvrant à peu près la vision de notre regard (1) et l’autre celui des « méthodes de découverte scientifique » globalement proche de notre regard (2). C’est d’ailleurs cette opposition qui construit le projet pédagogique de l’ANSTJ, fondé sur le tâtonnement expérimental associé à des formes de pédagogie du projet puisant leurs racines à la fois dans les travaux de l’INRP et dans les méthodes de projets spatiaux balbutiantes dans les clubs fusées puis astronomie. Cette figure de la science est celle que vont découvrir des adolescents dans des centres de vacances scientifiques, comme par exemple les camps « projets », décrits dans « la camp d’astronomie de La Courtine, OLV 1975 ou « de l’astronomie pratique », OLV, 1977. Ce regard va être le regard central des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire de loisir scientifique (Anstj et Petits débrouillards) mais aussi des généralistes (Cemea, Franca…). C’est autour de lui que ce structurera en 1985 le mouvement français des exposciences et le Cirasti canal historique.
Or, la troisième perspective « socio-économique » sur les technosciences est déjà présente dans une autre forme d’action militante dés la fin des années soixante. C’est celle des courants aujourd’hui intitulés « sciences techniques société » marqués en France par les opérations « pop physique (Aix, Poitiers) développées à l’occasion des congrès de la Société Française de Physique et objets d’ouvrages de référence comme « Le partage du savoir » de Philippe Roqueplo puis, quelques années plus tard, de « l’esprit de sel » de JMLL. Le regard qui y est porté considère la science comme partie prenante des systèmes socio-économique, en particulier dans une filiation suite aux travaux des écoles de sociologie des sciences comme celle de B. Latour, illustrés dans des ouvrages de référence comme « la science en action » ; Ce dernier ouvrage est d’ailleurs très éclairant. A l’instar du point de vue dipôlaire de l’Anstj, il présente une opposition récurrente entre « la science toute faite » d’une part et la « science en train de se faire » et pour accompagner cette métaphore d’une science que l’on peut voir sous deux angles opposés, B. Latour présente la tête double d’un Janus regardant dans ces deux directions opposées.
Ainsi, la période 1970-2000 est marquée par la juxtaposition de points de vue très clairement distincts sur la « science en train de se faire », l’un socialisé, l’autre pas. Et de fait, il y aura peu d’interaction entre ces deux courants critiques et ce n’est finalement que plus récemment que l’on les voit se juxtaposer, voire converger au sein d’un certain nombre de mouvements d’éducation populaire généralistes, comme la FNFR ou les confédérations de MJC.
Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés à des flous artistiques qui amalgament des perspectives sans clairement les avoir énoncées. Se pose ainsi une question corollaire : les tenants du 2 (planète sciences par exemple) et ceux du 3 (Fondation sciences et société) s’intéressent t-il à l’autre « science en train de se faire » (respectivement la 3 et la 2) et si oui, l’amalgament-ils à la leur, ou la place-t-il plutôt à l’autre extrémité du dipôle ? Le plus logique au vu de la terminologie opposant le regard 1 des corpus de la « science toute faite, prêt-à-porter » au regard « la science en train de se faire » pour reprendre les expressions de Bruno Latour dans «la science en action » serait de penser que le courant STS fusionne regard 2 et regard 3, qui finalement ne sont que deux échelles différentes du « en train de se faire ». Mais, est-ce si sûr ?
Citons par exemple [57], ce que souligne E. Knain (2001, p. 320) dans « Ideologies in school science textbooks », paru dans l’International Journal of Science Education, 23 (3), 319-329, qui lui ne distingue que deux pôles, « Le pôle A représente les controverses comme des produits scientifiques inachevés, donc en marge des sciences, alors que le pôle B les représente comme partie intégrante du travail scientifique. » L’auteur étudie les manuels scolaires pour les regarder du point de vue deux représentations des controverses et de la production d es sciences. Si l’on considère que les sciences sont essentiellement une affaire de faits établis (pôle A), les controverses seront présentées comme des problèmes temporaires qu’une collecte de données plus rigoureuse, plus exhaustive ou plus objective règlera éventuellement. Il est également possible que les controverses ne soient pas mentionnées du tout, et que les auteurs préfèrent s’en tenir exclusivement aux connaissances les plus stables et généralement admises. Le discours axé sur les processus implique quant à lui de présenter les controverses en tant que partie prenante du travail scientifique. Un discours favorisant cette perspective pourra, par exemple, traiter de controverses récentes ou actuelles ou, encore, de problèmes passés en s’attardant à leur résolution située (par l’argumentation, par les réseaux mobilisés, en tenant compte du contexte, etc.), plutôt que représenter les sciences en tant que procession héroïque vers la Vérité, comme certains manuels peuvent parfois le laisser croire ».
Bref, Knain voit simplement une opposition entre le regard 1 (son pôle A) et le regard 3 (son pôle B). Pour lui le 2 n’existe tout simplement pas en tant que tel…
Quant à l’éducation populaire elle-même, elle semble s’y perdre aujourd’hui et ne pas clairement différentier ces deux regards 2 et 3 qui se veulent tous les deux émancipateurs, mais pas par rapport à la même oppression.
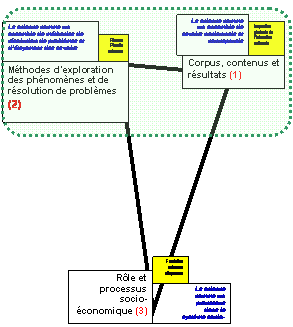
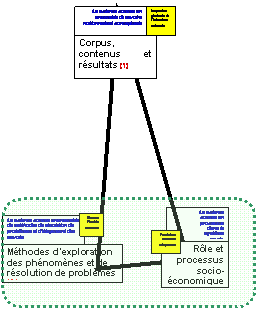
B.4. Comment interpréter l’amalgame « scientifique et technique » ?
L'amalgame "culture scientifique et technique" n’est pas non plus sans poser question.
Fusionnant "culture scientifique" et "culture technique", cette expression qui s’est progressivement imposée semble au premier regard assimiler la question des pratiques « techniques » qui sont très répandues dans la plupart des catégories sociales (mêmes si elles diffèrent en nature selon le sexe, l’âge et les CSP) avec celle de la culture scientifique, qui renvoie pour sa part à des pratiques liées à l’expérimentation et à la formalisation a contrario très peu partagées.
Trois interprétations peuvent être données sur une telle association :
Selon un premier point de vue, s’inscrivant dans la logique du consensus mou, on peut penser qu’il s’agit simplement d'une volonté de "ratisser large" pour accroître la base du consensus mou des acteurs culturels ?
Allant plus loin sur cette lancée, certains commencent à l’interpréter comme une confiscation des pratiques techniques des profanes, sous prétexte d'un anoblissement par l'invention des "techno sciences". En effet, si l’on s’intéresse à la représentation sociale, on ne peut s’empêcher de s’interroger : la soi disant « culture scientifique et technique » pourrait être perçue comme un moyen de placer sous la houlette du savoir scientifique les pratiques techniques autrefois partagées par tous. S’agirait-il d’en dessaisir ceux qui autrefois, sans pour autant être « scientifiques » les partageaient, voire en furent les inventeurs et détenteurs ? de l'appropriation des cultures techniques comme un sous-produit de la culture scientifique, déniant tout intérêt aux multiples pratiques techniques profanes de Monsieur et Madame tout le monde alors que celles-ci pourraient au contraire constituer de bons points de départ à une appropriation de méthodes scientifiques ? Voilà qui serait grandement dommageable, d'autant qu'en réalité, les pratiques techniques dont se préoccupent les CCSTI sont loin d'englober les pratiques techniques "profanes" (bricolage, MP3 et DIVX, jardinage, réparation automobile, pèche à la mouche...).
Mais, dans un troisième point de vue, en se plaçant dans un regard historique, il semble bien qu’il ne s’agissait voici deux à trois décennies (disons en 1985, en prenant le jalon du rapport Maitte [58], pour aller vite) que de rendre compte par cet agglomérat d’une évolution historique –constatée par tous-, qui a rendu sciences et technologies indissociables, irrémédiablement fondues dans des « techno sciences » devenues composantes indissociables d’une pratique socio-économique unique. Et comme « techno sciences » n’est pas entré dans le vocabulaire commun, cette idée s’est traduite par la formulation d’une catégorie culturelle « scientifique et technologique, vite simplifiée en scientifique et technique ». Dans ce sens, on lui trouve même directement accolé « et industrielle », pour renforcer le constat de l’instrumentalisation de la recherche scientifique. On se trouve alors dans la perspective développée en particulier par Bernard Stiegler [59]. Cette soi-disant « culture scientifique et technique » vise à nous imposer le désir (et le mal être, soit dit en passant) du progrès technique, auquel nous devons sacrifier en consommant compulsivement tous les produits technologiques que les industries culturelles nous agitent sous le nez.
De fait, l’origine est sans doute liée à cette troisième interprétation, mais peut bien entendu induire les deux premiers effets, à savoir d’une part accentuer la mollesse du consensus et d’autre part confisquer et disqualifier les pratiques profanes. Aussi, dans ce texte, lorsque nous voulons rendre compte du couplage entre « activité scientifique » d’une part et « production socio-économique de la technologie » d’autre part, nous préférons utiliser la terminologie « technosciences » ou techno-scientifique pour éviter l’induire l’effet de confiscation des pratiques techniques profanes, comme le jardinage, l’amélioration par tel ou tel individu d’un bâtiment ou d’un cyclomoteur.
B.5. Mettre la science en quelle culture ?
B.5.1 La culture scientifique, une exception franco-portugaise ?
Symétriquement à notre interrogation sur la scientificité, il serait rassurant de pouvoir cerner les ambiguïtés du signifiant « culture », tout en évitant de nous noyer dans son extrême polysémie. Là encore, la question est la même que pour la « science ». Faut-il couper les cheveux en quatre en ergotant sur l’invention de l'expression et donc de la catégorie [60] "culture scientifique" ou se contenter de constater que tous visent au final à changer la représentation de la science et la posture par rapport à la science ?
En amont de cette discussion, une remarque s’impose : l’usage de l’expression « culture scientifique et technique » est une quasi-spécificité francophone (France, Belgique et Quebec) et portugaise[61]. Ailleurs, comme le rappelle les extraits du rapport final du programme OPUS placés dans l’encadré 6, on parle plus de « public understanding of science », de « public awarness » ou encore de « scientific litteracy ».
Encadré 6 : la « culture scientifique » est-elle une exception francophone ?
Extraits du “final rapport of the OPUS (Optimising Public Understanding of Science and technology)”, by Ulrike Felt et al., june 2003, Contract No HPRP-CT-1999-00012
[About the choice of the project title “Optimising public understanding of science and technology in Europe”…] Why use the British notion Public Understanding of Science (PUS) and not for example the French notion of “scientific and technological culture”? Why not follow the rhetoric move on the European level to new notions such as “Raising Public Awareness of Science and Technology”, or to “dialogue between science and society”? And why speak about “optimizing”, which implicitly alludes to the existence of one “best practice” in organising this interaction between sciences and publics ?
In order to be able to answer the first question a few observations should be made. To start with, the notion of PUS, introduced in the mid-80ies in the British context, stands for a shift in the attention of policy makers and analysts from the production side of public representations of science to the public up-take of science. This was an extremely important change, which brought a lot of movement into the debates around the relations between science and society. Yet one should not overlook that it did not fundamentally question the role and position of “the public”: The latter was still supposed to understand science and not the sciences had to aim at a better comprehension of the social worlds the act and encounter publics in. In that sense the
PUS movement could be interpreted, at least in those parts that followed the argumentative logics of the Royal Society Report on PUS published in 1985, as a farreaching enlightenment programme, with the aim of making people admire, appreciate and support science. The subsequent shift from Public Understanding of Science to Public Awareness of Science and Technology on the European policy level hints at the idea that people should – if they are not really able to understand – at least realise the wide ranging positive consequences of science and technology, get a feeling for the potential behind these developments, accept the explanatory authority of science and in a certain way subscribe to the idea of social and economic progress through scientific and technological advances. Although a more active role was now attributed to the public, the power relationships embedded in this new notion had not been altered fundamentally as compared to the initial PUS idea: it is still the public that should raise its awareness of science and technology whereas the scientists are not expected to increase their awareness of public expectations and agendas. The introduction of the notions dialogue and participation, which have become more prominent recently, in a certain sense signalize change. However the realisation of such dialogue-oriented settings – as will be seen in the empirical parts of this report – still remains rather episodic.
Having made these observations, it was decided to keep the term Public Understanding of Science in the title of our project, as the focus of our interest was on the relational settings in which communication of science and technology takes place as well as on reflecting the ideas, expectations and power structures that are behind them. Taking PUS as a point of departure, we will try to account for the consecutive shifts, to describe and analyse the relation between the accompanying rhetoric and the realisations of concrete science-society interactions. Further, using the PUS notion accounts for the fact that in a number of national contexts, which have largely been inspired by the “British model”, this notion is still in use at least as a point of reference.
[…] We will use terms like popularising or communicating science and technology, we will speak about PUS-activities and -initiatives, in France and Portugal we will meet the term “scientific culture” – although with different meanings – and in Belgium “Raising awareness for science and technology”. We understand the interaction between science, technology and publics as a process in which many layers of communication and experience-making overlap and criss-cross to form a variety of attitudes and images of science in the public space in the end. It is an open-ended process whose outcome is impossible to control. In that sense we understand the different initiatives to be investigated as being situated in a broad spectrum of concepts of how and where people encounter science and what they can learn about science.
[…]
The concept of "culture scientifique et technique" (CST) developed within a French tradition, in contrast with the "two cultures" Anglo-Saxon tradition so forcefully expressed by C.P. Snow T in the late 1950s as a lamentable separation between science and mainstream culture.
- One meaning of CST is that science should be a part of the general culture, embedded within a holistic expression of national creative identity. The idea of "putting science into culture" goes further by promoting the notion that science should not be considered a separate element of culture, but articulated with respect to other dimensions of cultural expression. The paradigm underpinning CST is that science is not an isolated activity but relates intimately to other social developments. One consequence of this conceptualisation is the idea that publics should know more about science. In this respect, CST implies democratising scientific knowledge, and – ideally – the existence of a democracy which can effect the sharing of scientific knowledge.
- A second meaning of CST is to assign to science the same status as other artistic activities. In this context, scientists are regarded as artists producing marvellous knowledge and artefacts that could be admired as such.
- A third meaning of CST is that science should occupy a particular place in culture because of its practical usefulness. In that sense, it is considered as superior to art.
The Public Understanding of Science movement in the UK arose in the 1980s from a perceived need in the scientific community to increase public knowledge of science in order both to improve the basic competence of the citizenry and to promote public support for government R&D expenditure. By the beginning of the 21st P century, PUS movement activities in the UK amounted to a national industry, with science promotionalism utilising various educational, literary and cultural forms of expression. Nevertheless, the "two cultures" tradition of separating science from mainstream culture is so deeply embedded in the national psyche that behind the veneer of democratisation, dominant social structures persist in separating the business of science from its presentation to the public.
The differing Anglo-Saxon and French conceptualisations of science and culture are among the main sources of difference in the national environments for science-society interfaces, a factor which will be reflected in the comparative analysis of PUS in the six OPUS countries.
The concepts and goals underlying the policies
Just like each painter possesses a favourite and distinctive palette of colours, by which he can be recognised, each culture has, in a particular moment in time, favourite words for describing and constructing its social reality. These words carry a history with them, and their meaning is a product of social negotiation. It also happens that for issues socially recognised as relevant, most of our words come in oppositional pairs, and each term of the pair can be used in different discourses. As a consequence, different cultures use different words, different opposition pairs of words, different expressions and thus different discourses.
Under the label of “scientific literacy”, “scientific culture” or the “public understanding of science”, in all the countries analysed both the governments and the scientific communities now share a common concern with the awareness and knowledge of science by the general public. As the relationship between science and society became politicised, a tendency developed to broaden the scope of the concepts used.
TP
PT Differences of degree between these two countries should, however, be acknowledged: whereas in
Austria R&D industrial expenditures account today for 40% of the total R&D expenditures, in Portugal they account for just 25%; and whereas, in Austria, public investment in R&D amounts to 1,8% of GDP, it only amounts to 0, 65% in Portugal. However, the contexts in which such concern was born and developed, and the underlying philosophies vary to a great extent: whereas in some cases, civic and cultural considerations have prevailed, in others, economic and industrial purposes predominate.
The United Kingdom is regarded as a pioneering and innovative country in both the theory and the practice of Public Understanding of Science (PUS), understood as a new field of public and political interest and of social research. In this country, the objective of the initiatives put forward in this field from the 1980s onwards was twofold: improving people’s capabilities as active professionals and informed citizens in an increasingly technological society, and of securing the public’s support for the State’s investments in R&D. It was not a coincidence that the Royal Society of London’s influential report on “The Public Understanding of Science” (the “Bodmer report”) was elaborated and published at the time of Mrs. Thatcher’s conservative government with its constraints on public funding and the corresponding pressures for public accountability of research.
In contemporary France, efforts to carry out an explicit policy designed to further the penetration of science in society may be said to have been pro-active, rather than reactive: they followed the options made by the socialist government which came to power in 1981. One of the outcomes of this policy was the establishment throughout the country of “centres de culture scientifique, technique et industrielle”.
In Sweden, the relationships between culture and science have been credited as being of prime importance in the last two decades. The Council for Planning and Coordination of Research, established in 1979, has been the foremost actor to stimulate and support efforts to popularise science. The actual political relevance of the “public understanding of science” in both Sweden and France appears to be a result of the recognition by law, as early as 1977, in Sweden, and 1981, in France, of a clear assignment (the “third assignment” besides teaching and research) for scientists and academics to become actively involved in the dissemination of the outputs of their work towards the general public.
Similarly, the emergence of universities as a leading actor in this field in Belgium can be related to the implementation of their statutory mission to provide services to the community. In Sweden, the third assignment was ultimately reoriented towards more practical ends: applied research, industrial R&D, commercial utility and competencies-building have gained momentum in the directions of policies for scientific institutions. The decisive role played by Belgian regional and local authorities in the promotion of awareness about science can be related to a somewhat similar aim: that of encouraging an innovative and industrial culture among students and entrepreneurs. Emphasis has been placed on the building up of a scientifically and technologically competent workforce, combined with initiatives to raise awareness about science among the general public. It should be recalled in this connection that in this country business expenditure amount to 72% of total R&D expenditure. Besides, the ratio of researchers’ vis-à-vis the active population is one of the highest in Europe.
A nexus can therefore be recognised between the levels of industrial development and industrial investment in research and development, and the emphasis of public policies on technical or technological, besides scientific culture.
This hypothesis is reinforced if one considers the Portuguese case. In Portugal, industrial expenditure in R&D amount to only 20% of total expenditure. The explicit “policy for scientific culture”, led by the Portuguese Ministry of Science and Technology, was guided by an ideological frame of reference inherited, one might say, from the philosophy of “Les Lumières” according to which science is essentially the search for the laws of nature and of things, based on logic and deduction. The same ideology espouses the values of liberty and of democracy and takes them as intrinsic elements of scientific practice. The “Ciência Viva” (Science alive) programme, the major initiative launched in this context, lies on the notion of scientific practice as the understanding and manipulation of nature and of scientific instruments. One of its main underlying goals is to counter the traditional theoretically based teaching of sciences, by a methodology of teaching based on experimentation. Technological and industrial development provides, at the most, indirect or implicit goals of this policy.
It was also in the 1990s that the Austrian government (firstly through the Ministry of Science and Transport and since 2001 through the Ministry of Education, Science and Culture) acknowledged the need to invest in this new policy area. During these years, an increasing interest for science and technology was also perceivable in the Austrian media. Pressure for problem-oriented research combined with the decrease of public funding, and the intense public debate about science-issues such as GMOs and related scepticism and distrust towards science (triggered by applications by national and international research institutes to release GMOs in Austria) were at the origin of the recognition of the need to work out new forms of communication of science to the public. Their central objectives have been to attract young people to scientific professions, and to secure public acceptance of science and technology.
As it comes out from this brief sketch of the economic and social contexts, and the goals of national policies in this field, highly industrialised countries, namely France and Belgium, have actively promoted the dissemination of science and technology in society as part of broader public policies, at the central or regional levels, aimed at furthering the synergy between science and technology, industrial growth and competition, on the one hand, and at raising awareness about science and bringing science into culture, on the other hand. These options account for the fact that the concept commonly used in political and social discourse be “scientific, technological and industrial culture”.
In Sweden, a combination of the civic tradition that relates science to democracy, and a more practical, economically oriented tradition of industrial exploitation of science can be observed as well. The democratic argument has played a major role in policies for the university and the public understanding of science: as early as the beginning of the 20th century, public university professors were seen as civil servants close to the people and undertook popularisation activities. The social and political culture that characterises this Nordic country underlies the positive receptivity of the general public to initiatives undertaken in this area.
A somewhat different path seems to have been pursued by the United Kingdom. Against the background of an old tradition of popularisation of science, recent efforts in this area, and the new language used to frame it (the “public understanding of science”), have been strongly motivated by the need to counter the retreat of the State from research funding. Here, public acceptance became a chief preoccupation of policy-makers and scientists. In contrast, in Portugal, a country at an intermediate state of development, the new policy in this field “was born out of a decisive debate against Portuguese scientific backwardness”, to use the words of the Science Minister. This policy found its origin in the recognition of the need to struggle for the “general appropriation of scientific culture by the Portuguese population”. Popularisation is seen, in this context, as both a responsibility of the national scientific community, and a “collective responsibility”. The concept most commonly used has been that of “scientific culture”. This reflects both a cultural and a civic, but not so much a technological approach to the public understanding of science.
Despite the actual dilution of the left/right divide, one may wonder whether there is any link between the ideological or political beliefs of particular governments and their orientations in the field of the public understanding of science. At first sight, social democrats (in Sweden, for example) and socialist governments (in particular France and Portugal) attached more credence to this policy area than conservative governments did. This hypothesis needs a more in-depth inquiry in order to be tested. One would need to assess, in particular, whether the less active role of some governments is part of a more general political will to reduce the scope of public intervention or a genuine devaluation of the importance of specific policies for scientific culture as compared to education and training ones.
Seconde remarque liminaire : si l’on souhaite le développement de la culture scientifique ou, selon la formulation devenue emblématique de J.-M. Levy - Leblond, « mettre la science en culture », cela signifie que la science n’est pas ou n’est plus dans la culture. Alors, au fait, depuis quand et pourquoi la science n’est-elle pas ou plus dans la culture ? Pour la France, JM Levy Leblond, dans un paragraphe de référence de « l’esprit de sel », situe la séparation au XIXème siècle[62] : « Au fur et à mesure qu’elle s’est affirmée comme référence majeure du discours social , la science a perdu contact avec la culture […une ] rupture en quatre phases : intégration […] lorsque naît la science moderne, comme composante majeure du vaste mouvement culturel qui accomplit la Renaissance […], alliance ensuite, au XVIIIème siècle pendant l’âge des Lumières […] éloignement progressif au cours du XIX eme siècle ou l’idéologie du progrès se structure sur le scientisme devenu son noyau dur, cependant qu’en opposition absolue s’étend le Romantisme […] aliénation, enfin en notre temps où le mouvement culturel, qu’il soit artistique, littéraire, philosophique, marque à l’égard de la science une indifférence rancunière, ponctuée d’épisodiques et dérisoires gestes de réconciliation. Et ces tentatives de récupération tournent vite à l’exploitation maladroite de la caution qu’offre l’inattaquable scientificité formelle à tout discours de justification. Mais le hiatus est profond. »
B.5.2 La « remise en la culture générale» de la science ne peut se décréter
Ainsi, le fait est qu’aujourd’hui en France la plupart des acteurs reconnaissent la légitimité de mettre (ou remettre ?) « la science en culture ». Pourtant, « mettre en culture » au sens de re incorporer savoirs, méthodes, interrogations scientifiques dans la culture commune, ne va pas sans poser de lourdes questions. Si l’on s’en tient à la définition la plus admise actuellement de la « culture » (au singulier, par oppositions aux cultures au pluriel de tels ou tels groupes sociaux ou ethniques), définition de E. B. Tylor (1871), la culture est l’ « ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société ». Se fixer comme objectif d’y réintégrer de manière volontariste une composante scientifique que les pratiques sociales ont exclue ? Il s’agit forcément d’une déclaration d’intention, un slogan pour des jours meilleurs où l’on aura à nouveau « mis la science en culture »[63].
Comment décrire précisément la situation actuelle ? Deux points de vue s’affrontent – aujourd’hui implicitement.
- Le premier est issu de C P Snow (1959), les deux cultures[64], la référence en la matière, qui affirme que deux cultures différentes, voire disjointes co-existent aujourd’hui, culture classique, dont toute composante scientifique aurait quasiment disparue d’une part et culture moderne, scientifique et technique d’autre part.
- Le second, celui de JMLL dans l’esprit de sel[65], considère que « en son propre sein déjà la science ne fonctionne pas comme une culture. […] la science donc n’est plus dans la culture. Encore moins est-elle devenue une autre culture. […] et l’on voit la seconde raison du hiatus entre science et culture – ou la première : il n’y a pas pour la science de rôle culturel, de tradition à partager. »
B.5.3 Mais alors, d’où sort l’invention de la « Culture scientifique » ?
On peut faire l’hypothèse qu’un malheureux petit glissement sémantique, un flou artistique ont conduit du slogan du monde meilleur où la science aurait enfin été « remise en culture » a une formulation à l’emporte pièce : développer la « culture scientifique », ou pire, développer la « culture scientifique et technique », ce qui nous place alors en plein dans des sables mouvants ethno-sémantiques. A éviter ! Dire plutôt : favoriser le repeuplement de la culture commune par des composantes liées aux savoirs, méthodes, pratiques et interrogations scientifiques…
B.5.4 Commencer pragmatiquement une « mise en culture » ?
Cela n’empêche que des acteurs « font » ou prétendent faire au quotidien de la « culture scientifique » et qu’ils se démènent pragmatiquement, actionnant des leviers… Force est de constater que plusieurs acceptions de cette « culture » se juxtaposent (voir encadré). On peut en particulier traduire la volonté de « mise en culture » soit comme une exhortation au développement de l’offre culturelle scientifique (mise en action culturelle), soit comme l’affirmation volontariste d’un effet que l’on attend sur les individus d’autre part, qui se concrétisera par une société où la science aura enfin été mise en culture (mise dans la culture partagée). A priori, l’on peut penser que cette apparente duplicité de la terminologie reflète simplement le classique découpage entre les moyens d’actions et le résultat attendu.
Développer la culture des individus ou l’action culturelle ?
Etant passée dans le domaine commun, la formulation « mettre la science en culture » a généré trois types d'acceptions qui se juxtaposent aujourd’hui, selon que ceux qui l’utilisent voient cette mise en culture comme une exhortation au développement de l’offre, comme l’affirmation volontariste d’un résultat anthropologique attendu ou même simplement comme une revendication catégorielle. Les deux premières visions renvoient à la classique opposition entre moyens et résultats.
Dans le premier cas, si l'on entend la culture au sens de l'action culturelle, au sens marchandisé de "l'offre", « mettre en culture » signifie développer l'action culturelle en créant de nouvelles offres, de nouvelles programmations, comme des "expositions de vulgarisation scientifique", des conférences, des clubs, des émissions, des collections, des sites web, des centres, des événements…
Dans le second cas, si l'on entend la culture au sens des acquis d'un ou des individus, voire d’une société, renvoyant ainsi à une définition ethnologique de la culture comme résultant de multiples processus sociaux, la « mise en culture » ne passe alors pas forcément par de nouvelles « offres culturelles » mais pourrait par exemple passer par une transformation du système d'instruction initiale et des programmes, en renonçant à la coupure des disciplines scientifiques opposées aux disciplines dites « littéraires » et en faisant de leur réconciliation une des priorités de l’enseignement secondaire.
De fait, cette duplicité de la « mise en culture » peut ne pas sembler gênante, au moins pas dans un premier temps. Certes, nous pouvons évaluer nos politiques selon ces deux dimensions, celle du résultat à savoir la place de la techno science dans la culture des français (dans leurs pratiques et leurs représentations communes), d’autre part le volume de l’action culturelle techno scientifique. Mais, pragmatiquement, on a tendance à penser que concrètement nous sommes limiter à développer le second volet et mettre « de la science » dans l’action culturelle, au sens de ne pas limiter les interventions des acteurs culturels traditionnels (désignons par exemple ceux qui relèvent du territoire des Ministres de la Culture) aux catégories habituelles qui sont les beaux arts (ceux des Muses moins Uranie, transfuge égarée de l’astronomie), à la lecture et au patrimoine.
On rejoint alors ainsi la troisième acception de cette « mise en culture ». Entendant la culture comme une catégorie (administrative et ouvrant droit à des subventions), il s’agit alors d'arriver à une reconnaissance, un rattachement catégoriel. Les politiques et las acteurs affirment alors que la science fait partie de la culture, « au même titre que … la musique, la sculpture », bref, Uranie est bien une muse et Hippocrate devrait en être une aussi.
Voilà d’ailleurs qui conduit à des idées d’hybridation, comme le « théâtre scientifique » et voilà qui soudainement renvoie à l’idée d’œuvre et d’artiste. S’agit t’il de mettre de la science dans les activités culturelles, en les considérant comme média ou de développer de nouvelles pratiques culturelles ?
Et là, force est de constater que nous arrivons à un nouveau niveau d’ambiguïté, à l’intérieur même de « l’action culturelle ». Derrière cette « action » culturelle, parle-t-on de diffusion culturelle, au sens de la diffusion et présentation des œuvres jugées comme « majeures » de l’humanité ou d’action culturelle au sens de la mise en place d’un processus d’émancipation ou de transformation des représentations ou des pratiques des individus ? Cette présentation un peu caricaturale renvoie à l’opposition classique et un peu manichéenne entre le socioculturel (traditionnellement rattaché à l’éducation populaire depuis Malraux et l’institutionnalisation du Ministère de la culture) et l’action culturelle « légitime ».
Mais, la question centrale, ne serait-elle pas tout simplement d’arriver à mettre des pratiques scientifiques dans les pratiques cultivantes (la forme intéressante des pratiques culturelles) de Mr et Mme Toutlemonde ? Et si oui, alors comment les définir, les distinguer, voire les encourager ?
Ce raccourci tentant entre moyens et résultats occulterait un problème clef. Peut-on affirmer que ce serait par une « mise en action culturelle » au sens traditionnel des politiques de diffusion [66] culturelles instituées que l’on va réussir l’inclusion du « scientifique » dans la culture de tous ? Or, force est de constater que nos politiques culturelles instituées ont été inventées pour favoriser la découverte et la connaissance des beaux arts et du patrimoine et même plus précisément la découverte des œuvres légitimées par des Artistes sacralisé produisant des chefs d’œuvre de l’humanité : sur ces Artistes et ces Art légitimes vivent musées, télévisions, classements patrimoniaux et autres scènes nationales.
Les sciences n’étant pas vraiment des Arts institués, les travailleurs des sciences ne sont pas des artistes [67] et les produits de la recherche ne sont pas des « œuvres » directement exposables dans des musées, mais des méthodes, des paradigmes et autres controverses.
A contrario, si les objets « scientifiques » appartenaient à ces catégories dont la mise en culture des sciences passe par… la vie quotidienne, les interlocutions, la pratique sociale…. Il En France, la culture culinaire par exemple ne fonctionne pas autrement. Alors pourquoi serions nous si sûr que la culture scientifique et technique doivent se développer par de l’action culturelle instituée ? de fait, la culture technique des français est un ensemble de cultures populaires, reconnu marginalement aux ATP ou dans quelques éco-musées. ? Et au fait pourquoi mettre la science en culture, plutôt que les sciences en pratique, voire même plutôt que "mettre les pratiques en sciences" ?
B.5.6 Que seraient les « pratiques culturelles » scientifique et techniques ?
Et de fait, la question est bien de savoir ce que l’on souhaite développer chez les individus : comment devrait se manifester le fait qu’ils seront plus « cultivés » en sciences ? Pas facile de répondre… Cette question de la culture « scientifique » qui se réfère à un champ de savoir transversal (peut-être est-ce comparable à la culture « historique ») et non à une catégorie habituellement référencée, comme le sport ou la musique oblige à revisiter les schémas sociologiques classiques. Ainsi, même les écoles transversales, comme celle de Bernard Lahire par exemple ne permettent pas d’analyses simples de la dimension scientifique de la culture des individus[68].
Alors, pour répondre posons nous une question toute simple : Si les sciences étaient revenues « en culture générale », en quoi cela se verrait-il ? A prioiri, à question simple, réponse simple : Les gens auraient des pratiques scientifiques !
Et quelles seraient ces pratiques scientifiques ? En première réponse, un tantinet tautologique, on pense bien sûr à des pratiques « culturelles » scientifiques (au sens des sociologues du Ministère de la culture, c'est-à-dire des lectures, des sorties cinéma, théatre, musée... et quelques pratiques culturelles plus populaires, genre TV, voire pratiques amateurs du type photo….). D’ailleurs, il y a déjà des « amateurs » en astronomie, en entomologie, en météorologie (dans les sciences classiques, diront certains…ou dans celles que l’on enseigne pas à l’école, ce qui les protège du dégoût populaire…) ; il y a même des collectionneurs de cailloux…
Mais bien sur, on aurait le droit de penser plus loin… de les envisager autrement que sous des formes très simplistes de consommation de produits culturels ou d’activités, comme la visite d’une exposition, ou la lecture d’un livre ou alors des « pratiques amateurs » ou autodidactes. Si la science était vraiment dans la culture, cela pourrait aussi vouloir dire discuter sciences au bistrot, mais aussi tout simplement bricoler scientifiquement (choisir le meilleur isolant pour son grenier, peaufiner son vélo et changer les pignons du dérailleur, améliorer sa guitare, acoustique ou électronique, se débrouiller d’un thermo syphon), créer des œuvres scientifiquement (en jouant sur la profondeur de champ, sur la vitesse d’obturation… en mélangeant des couleurs, en synthétisant des rythmes, des accords nouveaux), jouer scientifiquement (au rubik’s cube ou au casino et même en faisant des réussites, des mots fléchés avec son dictionnaire), se préoccuper du temps qu’il va faire scientifiquement (identifier les nuages, suivre le baromètre), s’auto médicamenter scientifiquement, faire du sport scientifiquement (en suivant ses pulsations, en adaptant un entraînement fractionné), se mettre au régime scientifiquement (en suivant des ratio protéines/glucides…), essayer de discuter médecine (et pronostic ?) avec son médecins ou celui de sa grand-mère, jardiner… et construire un nichoir à oiseau, un cerf-volant, un pendule pour le plafond de la chambre du petit… Des dizaines d’heures de pratiques « cultivantes » en perspectives. Et la prochaine grande marée pour aller aux crabes ? Et la prochaine pleine Lune ? Et le début du Ramadan ?
La liste sera encore bien plus longue, si on ajoute un ordinateur et quelques périphériques dans le paysage. Il suffit d’aller faire un tour sur les forums des techno-bricoleurs ou des scientifiques amateurs pour en être submergé. Au fait, depuis combien de temps n’avez-vous pas visité d’expo science ?
Bref, bref. Bien sûr ces pratiques sont à la frontière de la scientificité. Rien que de la technique profane ? A partir du moment où il y a modélisation, induction, déduction, observation, métrologie…. Ne s’agit il pas d’un symptôme de pratiques scientifiques ? Comment va se déterminer l’homologation ? Aucun de nos trois rapports de références n’ont la moindre considération sur cette question. Saluons malgré tout leur mention par R. Jantzen dans son rapport de 2001[69].
Et pourtant si mettre les sciences en culture commençait par regarder ces pratiques avec bienveillance et à aider les pratiquants à renforcer la dimension scientifique de leurs méthodes de résolutions de problèmes ?
Or, n’y aurait-il pas des raccourcis à faire entre pratiques culturelles scientifiques et techniques et « pratiques techniques » tout court ? Ecrire des programmes informatiques, développer un bout de site en Flash, un blogue… Certaines pratiques techniques de nos concitoyens, celles qui confrontent à observer, modéliser, tirer des conclusions, ne pourraient-elles pas être considérées comme ces introuvables pratiques culturelles scientifiques (profanes ou amateurs)…
B.6. Et si les sciences redevenaient anthropologiquement partie prenante de la culture ?
B.6.1 De multiples pratiques scientifiques au quotidien
B.6.2 Le libre choix du (gai) savoir
Et la modernité a inventé le temps libre pour tous, c'est-à-dire el droit à exister et à ne plus être que des esclaves, asservis à la fonction de rentabilité au service de celui qui vous possède.
Et depuis, la question est plus celle des rapports de ce « temps libre » avec la possibilité de résolution de problème et d’émancipation que représente les méthodes scientifiques. Certes, je est une unité hollistique, mais dans ce « je » prend place un sous-ensemble de temps des pratiques culturelles : pour comprendre les constructions et expressions individuelles (voire intra-individuelles), il vaudrait mieux séparer temps subi et temps choisi… Et a l’intérieur du temps choisi, se déploie celui de l’auto construction de l’individu, qui lui m^me est bien sûr omnivore, pluri référentiel, à la fois en terme de dialogue intérieur (forme avancé de la PNL) et en terme de « pratiques culturelles », cf Bernard Lahire, La culture des individus…,
Et la question est aussi celle, sémantique, de la nouvelle représentation de la « culture » qui se généralise au sens de « l’action culturelle », visant à développer des pratiques culturelles non seulement cultivantes, mais aussi formatées dans les standards de la consommation culturelle, pour rendre le temps libre inventé par les congés payés et le front populaire rentable en terme de bénéfices culturels, tant pour des individus qui en profiteront pour accroître leur niveau culturel que pour des acteurs nadarts
Nous sommes alors, dans ce second cas, dans une démarche éducative, fondée sur l’idée que tous nous avons à gagner à nous doter d’une catégorie particulière de culture qui est la « culture scientifique ».
B.7. Synthèse des ambiguités :
Cette question de la définition de « culture scientifique » ouvre un problème clef : Parler à la fois de manière indifférenciée de la « culture scientifique des français » et de l’action culturelle relevant du « temps choisi » des français nous installe en porte à faux. Malheureusement, l’un n’est pas solution de l’autre : Vouloir changer massivement le niveau culturel et les représentations de tous les français implique forcément le système d’instruction publique obligatoire ; alors que les actions relevant des « temps choisis » ne seront socialement que marginales.
Changer significativement la place de la science dans la culture générale de nos congénères implique de modifier le système global d’instruction publique…
Le reste n’est qu’un correctif au second ordre…
Partie C :
Décryptage de l’institutionnalisation
C.1. Voir qu’il s’agit de faire avaler par le plus grand nombre les fruits du progrès
Si l’objectif des politiques et des chantres de l’enseignement scientifique (Inspection générale, par exemple) est la juste fabrication de l’élite nécessaire à la production de la science et technoscience « normale » au sens de Kuhn, (au rythme d’environ 8% par classe d’âge), pourquoi tout n'est-il pas bien dans le meilleur des mondes ? Pourquoi certains déclarent tout de même ne pas se contenter de l'ignorance populaire (des 92% pourcents restant) en matière de science ?
C'est sans doute parce que les innovations techniques et conceptuelles apparaissent plus vite que le renouvellement et la formation des générations que le système d'instruction publique ne suffit pas à la consommation du progrès... Voilà qui rejoint la question de savoir pourquoi l’action culturelle s'est elle tant développée et institutionnalisée ici et maintenant ? En quoi l’époque actuelle est-elle particulière en terme d’avancées scientifiques ou techniques ? Dans quelle évolution socio-historique des systèmes éducatifs s’inscrit l’institutionnalisation de la MST ? Là encore, pour clarifier, on pourrait ajouter qu’il s’agit de savoir pourquoi c’est sur la période 1970-2000 qu’ont été réunies les conditions d'une telle institutionnalisation. Est-ce intrinsèque à l’évolution du « progrès technique et scientifique » et à son accélération ? A-t on franchi un seuil ? si oui lequel ?
Nous formulons ici l’hypothèse que l’après seconde guerre mondiale a effectivement été marqué par le dépassement d’une limite sociale, celle de la consommation spontanée du progrès. Aujourd'hui, les conséquences des innovations pénètrent dans nos vies à un rythme largement plus rapide que celui du renouvellement des générations. Nos environnements quotidiens se remplissent année après année d’objets nouveaux qui, quels que soient les efforts des ergonomes, sont loin d’être spontanément maîtrisables, car ils gèrent de plus en plus des processus abstraits et sont de plus en plus opaques. Non seulement cela concerne des objets matériels totalement nouveaux, (comme les GPS et autres GSM), mais cela concerne aussi la métamorphose d’objets plus classiques (comme les appareils photos numériques ou les DVD par exemple), de matériaux (tissus synthétiques, Kevlar, matériaux à mémoire de forme, poly phosphates), de composants industrialisés (comment pouvait-on vivre sans ABS ou airbags latéraux ?) ou de produits (DHEA, acides de fruits, lessives à l’ultron ou aux mégaperls). On ne sait d’ailleurs même plus bien faire la différence entre un nom de marque déposée (Rétinol), une découverte de laboratoire (gluon) ou un hybride des deux. Les leçons de choses de l’école initiale ou un stage toutes les quelques années ne peuvent prétendre suffire à donner les moyens de vivre en tant que citoyen autonome et responsable dans une société de consommation démocratique dont le commerce de ce type de production du progrès scientifique et technique semble une des mamelles essentielles.
De fait, cette confrontation avec ces fruits du progrès a lieu de plusieurs manières complémentaires :
la consommation des objets et produits nouveaux ou métamorphosés (internet, téléphones 3° génération, GPS, Actimel, prozac, expresso, micro-ondes), l’acceptation des choix technologiques et de leurs contreparties économiques et environnementale.
Ainsi donc, l’institutionnalisation de l’action culturelle est-elle tombée à point pour faire face à cette nécessité générale d’une nécessaire « familiarisation » permanente de tous avec les conséquences quotidiennes des évolutions scientifiques et techniques qu’est née la MST. Mais au fait, la question de savoir qui organise cette fatalité de consommation ne peut être éludée. Voilà qui renvoie à de multiples travaux, dont ceux de Bernard Stiegler par exemple [70].
L’accélération du progrès technique a d’ailleurs toujours entraîné, avec plus ou moins de retard et de douleur, l’évolution des systèmes formatifs, comme dans une sorte d’évolutionnisme sociétal à la Darwin : on avait déjà dû inventer l’instruction initiale obligatoire de Jules Ferry lorsqu’il a été évident que l’imprégnation familiale ou tribale “ spontanée ” ne suffisait plus à gérer les premiers outils et concepts de la démocratie industrielle ; on avait déjà dû lui greffer une obligation de formation professionnelle continue avec la loi Delors de 1972.
Mais, attention aussi au danger de la « catégorie culturelle » à part, segmentée du reste… Sciences versus littéraire ou versus humanités d’où peut bien sortir une telle coupure et pourquoi se maintient-elle ? Avec quels bénéfices pour qui ?
Nous faisons l’hypothèse qu’en fait un bon moyen de permettre le meilleur « développement de la culture scientifique pour tous » si tel est bien l’objectif serait justement de renoncer à la séparation artificielle (invention post moderne) entre filières scientifique et filière humanité. Nous pensons qu’en fait c’est cette coupure artificielle conjuguée avec un enseignement dogmatique et abstrait des sciences et particulièrement des mathématiques qui est responsable du déficit culturel scientifique de nos contemporains. Nous pensons d’ailleurs que cette coupure a été inventée à l’époque moderne pour favoriser la production par le système d’instruction publique de nos pays du bon nombre de dociles et fertiles ingénieurs et scientifiques peu formés à la remise en cause méthodologique. Si les lycées formaient des chercheurs non seulement ingénieurs mais aussi épistémologues, peut être seraient ils moins aptes à être productifs, c'est-à-dire à se maintenir dans un contexte de science normale, au sens de T. Kuhn, sans risque de le déstabiliser par une critique trop précoce des bons paradigmes encore fertiles pour secréter des produits de technoscience fort rentables économiquement.
Et donc nous voici donc sur un terrain particulièrement glissant et propice aux tautologies, aux préjugés de tous ordres et bien sûr aux vœux pieux. Sachant bien sûr, qu’il ne s’agit pas encore là d’envisager d’une quelque manière que ce soit de réformer réellement en ce sens le système éducatif ! Il est bien trop traditionnaliste. Il ne s’agit là que d’un simple exercice d’utopie (comme diraient les littéraires) ou d’une gedankenexperiment, (comme diraient les scientifiques).
Comment définir ce terrain et baliser ces sables mouvants ? En repartant des choses simples :
si l’on cherche à développer la dimension scientifique dans la culture générale il faut l’y faire rentrer.
le système d’instruction publique est un des dispositifs qui contribue le plus à la construction de la culture générale ;
ce système construit l’image d’une nécessaire spécialisation, séparant les savoirs scientifiques des autres familles de savoirs, à la fois pour des raisons de « prédispositions » au sens d’intérêts, voire d’appétences et de facultés individuelles ;
4 tautologiquement, on peut faire l’hypothèse que, tautologiquement, cet éloignement de la science par rapport à la culture générale provient de cette organisation du système d’instruction publique
5 Les défenseurs du collège unique, voire ceux (en existe-t-il d’ailleurs vraiment) d’un lycée unique, réconciliant matières scientifiques et autres matières fondamentales se heurtent à principalement à l’opposition des volumes horaires : il ne serait pas pensable d’envisager des filières mixtes qui permettraient la « double culture », ou plutôt, pour reprendre l’expression de CP Snow, le développement de la troisième culture, tout simplement parce que le volume de savoir serait disproportionné au temps disponible.
Les réponses :
Sur le 3 : bien sûr, on enseignerait les sciences de manière passionnante pour tous…
Sur le 5 : le volume de savoir nécessaire à toute activité, même ultra spécialisée croit de manière exponentielle. Comment déjà y faire face, même sans se lancer dans cette utopie prétentieuse de « fusion des matières ».
Première solution : au contraire fragmenter, spécialiser les filières ! Pas forcément, voir l’encadré ci-dessous :
Source : http://www.prepas.org/renseignementselevessecondaire/ClassesPreparatoiresBL.htm
Élève de terminale à la recherche d’une classe préparatoire qui convienne à vos aptitudes et à vos préférences, vous ne souhaitez pas vous spécialiser trop tôt afin de préserver votre liberté de choix.. vous avez envie de continuer à approfondir vos connaissances dans de nombreuses disciplines et ’en découvrir de nouvelles.. vous avez du goût pour la réflexion, la rigueur intellectuelle et la culture... vous vous intéressez aux enjeux du monde contemporain, vous vous posez des questions sur l’économie, la société.. Alors les B/L ont été créées pour vous. Ces classes préparatoires se distinguent en effet par une très grande ouverture pluridisciplinaire :
dont témoigne d’abord la diversité des enseignements. Le tronc commun comprend : Sciences sociales ( 4h), Mathématiques (6h30), Histoire (4h), Philosophie (4 h), Français ( 4h), Langue vivante (2h) ; s’ajoutent à cela deux options, l’une écrite, l’autre orale, au choix : Géographie (2h écrit, 2 h oral), Langue vivante (4 h), Langue ancienne (3 h), Sciences sociales (2h).
et que confirment leur niveau d’exigence dans chacune de ces disciplines (en particulier en mathématiques) et l’égalité de traitement entre elles : il n’y a pas de hiérarchie, les coefficients sont identiques.
De ce fait, les trois cultures qui forment les humanités de notre temps se trouvent représentées : la culture littéraire, la culture scientifique, la « troisième culture »(les sciences humaines, économiques et sociales). C’est la raison pour laquelle la filière B/L est ouverte aux meilleurs élèves des trois séries de l’enseignement général : L, ES, S.
Les professeurs de ces classes tiennent beaucoup à cette diversité et à cet équilibre : ils sont les gages d’une formation intellectuelle d’excellence, parfaitement adaptée au monde contemporain.
L’étendue des débouchés des classes préparatoires B/L confirme l’ouverture de cette formation :
en tout premier lieu, les Ecoles Normales Supérieures : Ulm (concours B/L), Cachan (concours D3, « Sciences sociales »), Lyon (concours « Sciences économiques et sociales »)
l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE, concours économique), qui est l’une des Ecoles d‘application de Polytechnique et forme des cadres de l’administration et des grandes entreprises
l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI).
les Grandes Ecoles de commerce, telles que HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon notamment (concours littéraire avec option Mathématiques ou Sciences sociales).
L’IEP de Paris (aux niveaux bac +1 et surtout bac +3 ou cycle du diplôme) et les autres IEP (Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,Rennes, Strasbourg, Toulouse), chaque IEP ayant ses propres modalités de recrutement.
les meilleurs cursus universitaires dans chacune des disciplines (très souvent dans le cadre des magistères)
Les anciens élèves de B/L réussissent par conséquent dans de nombreux domaines : l’enseignement (Agrégés de Sciences sociales, Economie, Philosophie, Histoire, Lettres, Langues vivantes, Géographie..), la recherche (chercheurs dans toutes les disciplines citées, en France et à l’étranger), la haute fonction publique (via sciences-po et l’ENA), les grandes organisations internationales, l’édition, le journalisme, la vie politique, etc.. Quelle que soit la spécialisation choisie ultérieurement, la culture générale acquise au cours de ces deux années post-bac s’avère décisive. Il faut ajouter à cela que cette polyvalence permet aux étudiants issus de cette filière de poursuivre leurs études dans les cursus étrangers les plus exigeants.
Pour toutes ces raisons, cette filière est particulièrement attractive. En B/L les professeurs recherchent l’excellence dans toutes les disciplines, condition d’un enrichissement mutuel entre elles. Ces classes offrent à l’étudiant l’occasion de découvrir Kant et l’algèbre linéaire, Weber et Stendhal, Keynes et Austen, la Troisième République et la poésie contemporaine, etc...non pour construire un vernis superficiel de « culture générale », mais pour fonder de manière définitive une culture pluridisciplinaire. Les candidats à une classe de BL doivent avoir à l’esprit qu’une véritable pluridisciplinarité est un idéal exigeant fondé sur un savoir solide. Par conséquent la charge de travail est lourde.
L’expérience prouve désormais que les étudiants qui ont accepté de donner le meilleur d’eux-mêmes dans cette filière ne le regrettent pas : la capacité de travail, les méthodes, la culture acquise, à cet âge décisif pour la formation intellectuelle, furent déterminants pour leurs études ultérieures..
Si vous voulez devenir un acteur dans la société, si le travail intellectuel ne vous fait pas peur, si vous êtes attiré(e) par cette pluridisciplinarité et désireux d’acquérir cette triple culture, n’hésitez pas à vous porter candidat(e) à une classe préparatoire B/L. Nous vous conseillons de rechercher des informations complémentaires sur les sites des lycées qui proposent cette formation.
Seconde solution : réorienter les priorités des programmes, passer de l’apprentissage centré uniquement sur des contenus à plus de formation aux méthodes, à la recherche d’information et aux catalogue de sources… S’appuyer sur des premières années d’expérience professionnelle « apprenantes », tutorées….
Et au fait, si la principale efficacité des politique actuelle de CST avait juste été de déculpabilisé les politiciens « littéraires » pour leur donner des moyens de prendre sans trop de scrupules des décisions concernant les politiques scientifiques ?
C.3. Divergences entre les trois périmètres de « la science pour tous »
C.3.1 Entre Bachelard, Freinet et Habermas
C.3.2 Abécédaires
C.3.3 Mini et Micro sciences
Le regard 2 est celui du discours traditionnel de l’éducation populaire sur la découverte scientifique dans les années 80 type Cemea, Franca ou ANSTJ. Inspiré en partie par les travaux de l’Inrp, cahiers pédagogiques 60, Host, Deunff post Freinet, voir l’astronomie pratique par OLV et son commentaire dans le DEA et l’article de GG dans Aster), il vise à permettre de la construction individuelle des savoirs. S’appuyant concrètement sur des pédagogies actives (dérivées des méthodes de C. Freinet développant des tâtonnements expérimentaux et des projets de découverte scientifique, que l’on peut qualifier de mini science avec toutes les limites que l’on peut leur opposer cf J. ellisalde op. cit. ). Les tenants de ce regard le positionnent comme un moyen d’émancipation et d’autodidaxie anti dogmatique. Il s’agit de permettre de savoir distinguer croyance, conviction et savoir étayés. Ils en font un moyen clef de la lutte contre toute forme d’obscurantisme.
C.3.4 Dialogues d’intérêts recherche - société
Le regard 3 est, quant à lui, centré sur la question de la critique de la production de la techno science et de sa gouvernance. Post Marcusien, fils d’Habermas et de Philippe Roqueplo, Pop physique à Poitiers et du GLACS, il est devenu récemment un axe important de l’éducation populaire via la FNFR ou la Ligue de l’enseignement en suivant la critique des OGM ou même les dynamiques d’Attac ou de Greenpeace. Une question s’impose : sur quelles pédagogie peut-il s’appuyer pour ne pas être trop dogmatique ? Deux premières réponses : la mise en scène des controverses (via le théâtre scientifique par exemple, genre « procès de la puce » ou les ateliers délibératifs ou autres conférences de consensus… Mais là, c’est émancipateur pour la société, mais pas pour tous les individus : seuls sont vraiment acteurs ceux qui sont impliqués directement dans ces nouvelles formes de jury populaires. Troisième forme, les boutiques de sciences, qui elles visent à mettre des équipes de recherche, engagées de manière militante, au service des questions concrètes des partenaires sociaux ou encore certains « cafés scientifiques » ouvrant de nouveaux espaces de dialogues.
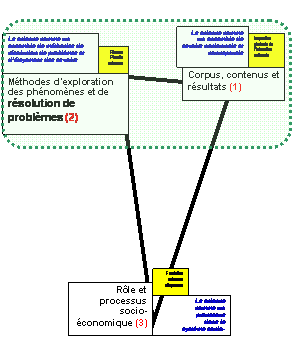
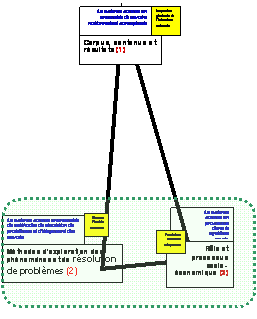
C.4. Empowerment individuel ou sociétal ?
Le regard 2 est celui du discours traditionnel de l’éducation populaire sur la découverte scientifique dans les années 80 type Cemea, Franca ou ANSTJ. Inspiré en partie par les travaux de l’Inrp, cahiers pédagogiques 60, Host, Deunff post Freinet, voir l’astronomie pratique par OLV et son commentaire dans le DEA et l’article de GG dans Aster), il vise à permettre de la construction individuelle des savoirs. S’appuyant concrètement sur des pédagogies actives (dérivées des méthodes de C. Freinet développant des tâtonnements expérimentaux et des projets de découverte scientifique, que l’on peut qualifier de mini science avec toutes les limites que l’on peut leur opposer cf J. ellisalde op. cit. ). Les tenants de ce regard le positionnent comme un moyen d’émancipation et d’autodidaxie anti dogmatique. Il s’agit de permettre de savoir distinguer croyance, conviction et savoir étayés. Ils en font un moyen clef de la lutte contre toute forme d’obscurantisme.
Le regard 3 est, quant à lui, centré sur la question de la critique de la production de la techno science et de sa gouvernance. Post Marcusien, fils d’Habermas et de Philippe Roqueplo, Pop physique à Poitiers et du GLACS, il est devenu récemment un axe important de l’éducation populaire via la FNFR ou la Ligue de l’enseignement en suivant la critique des OGM ou même les dynamiques d’Attac ou de Greenpeace. Une question s’impose : sur quelles pédagogie peut-il s’appuyer pour ne pas être trop dogmatique ? Deux premières réponses : la mise en scène des controverses (via le théâtre scientifique par exemple, genre « procès de la puce » ou les ateliers délibératifs ou autres conférences de consensus… Mais là, c’est émancipateur pour la société, mais pas pour tous les individus : seuls sont vraiment acteurs ceux qui sont impliqués directement dans ces nouvelles formes de jury populaires. Troisième forme, les boutiques de sciences, qui elles visent à mettre des équipes de recherche, engagées de manière militante, au service des questions concrètes des partenaires sociaux ou encore certains « cafés scientifiques » ouvrant de nouveaux espaces de dialogues.
C.4.1 Zigzaguer entre les différents regards
Est-ce grave de n’être que préoccupé du regard 3 et d’oublier le 2 ? Le principal reproche que l’on pourrait faire au tenant du 3 qui ne voient même plus le 2, c’est que soucieux de l’exercice collectif de la démocratie scientifique, ils n’en oublie les vertus de développement individuel anti-dogmatique et anti-obscurantisme du 2…
Et de fait, nous sommes face à deux représentations situées chacune à une échelle différente des enjeux de la formation scientifique du citoyen. La première se situe plutôt au niveau individuel : il s’agit de permettre à chacun de se doter des moyens de la construction critique de ses savoirs, de développer sa capacité d’autodidaxie, de résolution de problèmes. La seconde, quant à elle, se situe au niveau sociétal : il s’agit de permettre le fonction des démocraties techno scientifiques.
En vrac trois questions directement liées au rapport 3-2 :
Et si le 3 faisait que le 2 est renvoyé à l’école
les tenants du vrai 3 commencent peut-être à amalgamer 1 et 2 (graphique)
peut-on envisager le 3 sans le 2 ?
Et d’ailleurs où sont là dedans les sciences sociales ? et si la culture scientifique pouvait faire sortir les sciences du paradigme de la science instrumentalisée ? Et si l’éducation populaire pouvait faire se construire une appropriation des sciences moins instrumentalisée ? (à écrire…)
C.4.2 Indivus ou société ?
C.5. La vulgarisation mérite-t-elle son étymologie ?
C.5.1 Rejeter la posture étymologique, condescendante de la vulgarisation,
Ne plus définir le but de la médiation scientifique comme visant à "adapter les savoir pour les rendre accessibles" mais à "favoriser des pratiques autodidactes", rompre avec la condescendance de la vulgarisation, développer des pédagogies actives favorisant l'autodidaxie
Partie D :
Cliniques des pratiques
D.1.
Refuser l’instrumentalisation
D.1.1 Ne pas être dupe des rapports de pouvoir entre scientifiques, politiques et opinion publique
Multiples sont les lobbies qui sont face à la nécessité de prendre à témoin ou d'utiliser l'opinion publique [71] comme levier de pouvoir en matière de politique scientifique ou technologique. Au-delà des objectifs « individuels » que nous venons de décrire (développer soit sa consommation réflexe, soit a contrario son esprit critique), Il s’agit d’en faire un levier dans les rapports de forces entre décideurs et ainsi, au gré des circonstances et des modèles de décisions (cf Habermas) il peut s’agir de l’acculturer pour l'instruire (pour son bien ou pour le fonctionnement d'une certaine conception de la démocratie comme lors de pop physique...) ou l'instrumentaliser pour obtenir de nouveaux moyens, voire « sincèrement » de la considérer comme un interlocuteur adulte indispensable à l'élaboration d'une déontologie de la recherche (cf les ateliers participatifs de J.P. Natali)..
D.2.
S'imposer d'être persévérant par des médiations à contrôle
ascendant
D.2.1 Donner le pouvoir du contrôle à celui qui demande le savoir
La posture de la vulgarisation infantilisant celui qui reçoit le message, a contrario, nous nous intéressons aux stratégies de médiation scientifique ou technique dont la maîtrise est assurée par celui qui veut savoir, Le pilotage de l'acquisition devient indépendant du pouvoir du "sachant", devient autodidacte et interroge les concepts d’empowerment et de partage des savoirs. Le "profane" contrôle lui-même la démarche de médiation. Il s'agit d'une généralisation des idées appliquées les pédagogies actives.
Nous appelons “ médiation ascendante ” une médiation où la maîtrise de la méthode d’acquisition des connaissances est assurée par celui qui veut savoir et non par celui qui possède déjà la maîtrise des savoirs. La plus connue de ces situations est l’autodidaxie, où l’apprenant gère tout seul l’intégralité de son processus d’acquisition de connaissances. D’autres processus, comme les pédagogies dites du projet, se fondent sur la négociation avec le formateur d’un espace d’autonomie dans lequel, en règle générale, l’apprenant organise lui-même ses acquisitions, en fonction des besoins nécessités par la réalisation de son projet. Il apparaît vite souhaitable de préciser à quelle échelle on regarde le processus pédagogique. Souvent, de telles pratiques de “ médiations ascendantes ” s’appuient sur l’usage de ressources documentaires qui, elles, sont en grande majorité descendantes. Interviennent ainsi à l’intérieur de cette médiation ascendante des « granules » de situations dogmatiques Ainsi, l’utilisation spontanée d’une bibliothèque ou d’un centre de ressources est globalement une médiation ascendante, alors que les documents utilisés peuvent être de la vulgarisation “ descendante ”. En réalité, ce qui compte et fonde notre définition, c’est la possession de la maîtrise du processus d’acquisition et donc la faculté de pouvoir le contrôler. C'est pourquoi nous préférons utiliser l'expression "médiation à contrôle ascendant" (MCA). Concrètement, les situations de médiation à contrôle ascendant sont peu nombreuses. Plusieurs pistes de recherches sont néanmoins identifiées, outre l'autodidaxie classique.
D.2.2 Développer des pédagogies actives et pédagogies du projet
à écrire : sommaire indicatif
L’expérience de la pédagogie de projet développée à l'ANSTJ, telle qu’elle est exposée dans « de l'astronomie pratique, 1977 » et poursuivie avec les camps SAF de Chamaloc (1977-1981), mythes et limites.
La question de l’extraction d’une « expérience démonstrative » sans contexte paradigmatique (au sens de Kuhn) et sociologie (au sens de Latour, Habermas ou autres) et l’effet en terme de représentation du fonctionnement de la recherche scientifique. Mini et micro-sciences…. Sciences, techniques et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, expos-sciences et CIRASTI. Force est de constater les limites sociales de ces actions pour les jeunes (marginalité quantitative et qualitative). Avec un recul de quelques décennies, l'effet social se révèle presque nul, sans doute vu le poids écrasant du système scolaire, Au mieux, l'effet est-il limité à un tout petit correctif de la transmission héréditaire de la distinction. Les salles de découverte et autres artefacts interactifs en constituent d'ailleurs une forme sans doute dégradée, mais offrant un flux plus intéressant, comme si on était face à une loi économique sociale (flux de public*efficacité pédago= constante). A signaler aussi, pour chercher ce qui pourrait augmenter l'impact quantitatif, les pédagogies mettant en oeuvre des technologies de l'information sont fondées sur l'interactivité voire l'implication des apprenants. Force est de constater que cette interactivité est souvent limitée à une fonction de tourne page ou de génération de QCM ; malgré cela, le champ des technologies éducatives et de la e-formation est à observer comme potentiel générateur de MCA, même si, en la matière, les rares situations de MCA sont des granules englobés dans des situations dogmatiques ou, a contrario, des processus actifs englobant des séquences dogmatiques.
D.2.3 Gérer l'absence de demande réelle des citoyens, donc de feed-back
En fait, les usagers ou utilisateurs des MST sont difficile à rencontrer. On a beau invoquer un besoin social patent, on ne rencontre que bien rarement des utilisateurs ou des demandeurs. Dans n'importe quel autre système qui se préoccupe de qualité, on associe les bénéficiaires ; souvent même, ils s'associent tous seuls et font pression. Or dans le champ de la MST force est de constater que ces bénéficiaires n'apparaissent jamais dans les systèmes de gouvernance. Les médiateurs, les acteurs les prescripteurs agissent pour leur bien, formulant les questions et les réponses. Tout se passe comme si les acteurs communiquaient à sens unique vers des personnes dont ils espèrent qu'elles seront intéressées, alors que d'après leurs discours elles devraient se sentir mues par une impérieuse nécessité ! La logique de la qualité, c'est la contre réaction ; or nulle part dans la MST, n'existent de systèmes qui confrontent des demandeurs et les producteurs. La MST est en cela prisonnière de la vulgarisation descendante : elle tente de donner des savoirs à des gens qui devraient s'estimer heureux de recevoir ce que l'on veut bien leur donner. Pas d'usagers, pas de boucle de contre-réaction et donc pas de qualité.
Faute de clarification des objectifs, et de boucle de contre réaction, les acteurs s’enferment dans l’illusion de l’activisme. Une absence de cahiers des charges ou de contrôle social qui ne favorise pas la persévérance. Comment peut-on éviter de produire des actions velléitaires qui tournent au simulacre ? Sans doute en retournant la logique et en passant d'une vulgarisation descendante, voire condescendante à une logique de médiations ascendantes, partant des questions, préoccupations et pratiques de chacun, besoins, donnant le contrôle à ceux qui veulent savoir, visant l'empowerment des citoyens.
La question des médiations à contrôle ascendant (désignées dans la suite par MCA) renvoie donc directement à la question de la demande individuelle et sociale de savoirs scientifiques et techniques. Aujourd'hui en France, les situations ou systèmes de médiation technique ou scientifique sont pour la plus part descendants : les dispositifs ou situations où des représentants des "bénéficiaires" ou demandeurs sont décideurs, ou même simplement représentés ne sont pas fréquents [72].
à écrire : sommaire indicatif
faire face à l'absence de demande et aux difficultés de fonctionnement sans feed-back, éviter d'avoir à faire les questions et les réponses,
invention et mort des boutiques de sciences françaises, incapacité à se mettre en contact avec une demande individuelle ou même sociale. (cf AZF, ASTS...)
D.3.
Partir des préoccupations, laisser les gens faire les
questions, se limiter aux réponses
D.3.1 Les Cités de services et autres boutiques de sciences
Une piste pour les MCA est celle des cités des métiers et de la cité de la santé. Le demandeur de savoir y interroge des ressources (entretiens avec des experts, des médiateurs et usages de ressources multimédias) à propos d'une question qui le préoccupe (c'est à dire dont il sait consciemment avoir besoin). La Cité des métiers illustre bien cette volonté de service direct à l’individu. De conception très pragmatique, elle vise à fournir à chacun une écoute et une réponse actualisée, concrète et fiable sur des sujets aussi déterminants que l’évolution et l’insertion professionnelles. Ce type de système de MCA rappelle le concept historique des boutiques de sciences (appelées aussi Cabinet de Sciences) initiées historiquement à partir du concept plus ancien -1880- de boutiques de droit ) par John Stewart [73].
A ajouter ici : un paragraphe sur le projet initial des boutiques de sciences
Deux remarques s'imposent à ce propos : d'une part, le concept "boutique de sciences" s'intéressait plutôt à répondre à des besoins d'utilisateurs "collectifs", comme des syndicats et autres acteurs sociaux ; d'autre part l'intitulé "boutique de sciences a perduré en France notamment, mais les structures ainsi dénommées ne semblent plus aujourd'hui développer des pratiques spécifiques de MCA qui les différencieraient des autres CCSTI.
Un paragraphe sur le projet SCATE…
Concrètement, qu'est-ce que c'est que La Cité des Métiers et quelle a été son idée fondatrice ? Sa genèse est, somme toute, plutôt logique. A l'origine, la Cité des sciences, un établissement public français qui a pour vocation de " rendre accessible à tous les avancées des sciences, des techniques et du savoir faire industriel ". D'une telle définition de mission, découle un devoir d'information sur l'évolution des professions, des métiers, de la vie professionnelle. Lier culture, enseignement, formation, formation tout au long de la vie et orientation professionnelle, voilà qui n'a rien d'étonnant, si l’on songe par exemple au CNAM et à la mémoire de l'abbé Grégoire et de bien d'autres tenants de l'éducation permanente. Ce lien est d'ailleurs double : d'une part, les acteurs de la " culture scientifique et technique " affichant la volonté de réduire les inégalités sociales susceptibles de résulter de la non maîtrise des avancées scientifiques et techniques, les champs de la vie professionnelle, de l'évolution des métiers et de l'orientation les concernent au premier chef ; regardée sous cet angle, culture technique est de fait indissociable de culture professionnelle. D'autre part, lier action culturelle scientifique et technique et service pragmatique d'aide à l'orientation et à l'insertion à tout âge semble un moyen d’élargir grandement les publics susceptibles de se considérer comme concernés. Un musée des sciences "classique " ne proposant que des formes traditionnelles d'expositions court en effet un fort risque de n'être fréquenté que par des scolaires " captifs " et des adultes déjà passionnés par les expositions culturelles high tech. A contrario, en se proposant de se mettre concrètement au service de chacun en facilitant insertion et évolution professionnelle, le lieu culturel s'ouvre à d'autres publics et ce risque est moindre, de ne pas réduire les inégalités sociales, mais plutôt de les amplifier.
Ainsi, au départ, des acteurs au sein d’un établissement culturel se sentent le devoir de s'intéresser à l'insertion, l'orientation, l'évolution professionnelle ; évidemment, cela doit se faire avec ceux qui ont compétence dans ce domaine-là, et donc la première aventure de La Cité des Métiers a été de chercher à se marier avec les organismes concernés. Mais pour cela, il faut surtout construire des services aux publics. S’unir pour agir est plus pertinent si l’on sait décrire ce que l’on veut faire. Là encore, en matière d’offre de services, notre idée était très simple : essayer d'identifier les préoccupations des publics, en ayant en tête de créer un lieu complètement ouvert qui justement partira de ces interrogations et collera au mieux aux formulations des futurs utilisateurs. On voulait se placer dans une logique où ça allait être l'individu qui allait venir chercher de l'information, venir parler de ses préoccupations, donc dans un modèle où chacun serait considéré comme autonome ou potentiellement autonome, comme capable de formuler ou d'exprimer ses préoccupations et de chercher des réponses, des outils de l'écoute quelque chose. Notre idée était donc de proposer des intitulés de services faisant " miroir " des questions et inquiétudes de chacun.
On voulait se tenir à sa disposition, dans son propre temps à lui, et dans un processus dont lui-même maîtriserait les différentes étapes. Une Cité des Métiers serait donc un cadre différent de celui de l'orientation en milieu scolaire ou d'une classique agence locale pour l'emploi. Pour ce qui est des publics considérés comme très peu autonomes, pour qui les institutions, les barrières culturelles ou linguistiques empêchent de savoir ce qu'ils cherchent, il faudrait certainement créer des dispositifs spécifiques pour leur ouvrir des portes supplémentaires, ce que nous l’avons effectivement installé, avec en particulier des sessions accompagnées, intitulées « Clef d’accès ». Quoi qu’il en soit, également pour eux, le cœur de concept d'une Cité des Métiers devait être de les aider à être réellement aux commandes de leurs recherches.
Donc à l'origine [74] (1993) quatre, puis bientôt cinq pôles (depuis 1996) partant des préoccupations des publics, ont été mis en place, s’appuyant sur des affections d’équipes de conseillers :
" choisir son orientation ", qui fonctionne sur une alliance qui ne se dément pas avec le CIO Média-com,
" trouver un emploi ", s’appuyant évidemment sur une alliance avec l'ANPE,
" trouver une formation " qui a en charge la question de la formation professionnelle et qui fonctionne grâce à un regroupement de plusieurs partenaires. Historiquement, pour cette entrée, nous avions cherché un organisme unique qui aurait vocation d'informer le public final sur tous les aspects de la formation professionnelle continue et faute de l’avoir trouvé , nous avons fabriqué un consortium informel associant l'AFPA , les délégations académiques à la formation continue, le CNED, le CNAM, et d’autres organismes comme l’ANPE et le CLIP (Carrefour local pour l’insertion professionnelle) ,
quatrième aventure, le pôle " changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis ", aventure commencée avec le CIBC de Créteil auquel se sont ajoutés l'ANPE, le CESI qui est un organisme paritaire de formation et de bilan de compétences et qui vient d'être renforcée par le DAVA de Paris.
enfin, le cinquième pôle, ouvert en 1996, qui s'appelle " créer son activité " ; En 93, cette dimension existait, mais on la considérait comme un des volets de " trouver un emploi ". Trois ans plus tard, on l'a émancipé, individualisé, il est devenu pôle à part entière, animé par l'ANPE, la Boutique de gestion de Paris et le CIME, organisme associatif spécialisé dans la création d'emplois.
Avec toutes ces fonctions, accueillant depuis son ouverture en 1993 un millier d’utilisateurs quotidien, fonctionnant avec 60 conseillers (30 etp) venant de treize organismes complémentaires, la Cité des Métiers pourrait être qualifiée de « guichet unique », mais dans la mise en œuvre et dans la perception de nos publics elle se révèle bien différente : en fait, c'est bien un lieu unique de six cents mètres carrés visant à écouter et à répondre à toutes les préoccupations, mais pour ce faire, on a installé à l'intérieur non pas un guichet, mais cinq pôles séparés, pour nous tenir au plus proche de ces préoccupations. Et aujourd'hui, à la Cité des métiers, s'exercent bien - cinq métiers bien complémentaires : " Choisir son orientation ", " Trouver un emploi ", " Trouver une formation en formation continue ", " Changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis " et " Créer son activité ". Quant à la désignation de « guichet », nous lui préférons celle de « pôle », plus adaptée à un système comme celui de la Cité des Métiers, offrant l’usage d’un ensemble de ressources interconnectées, sans hygiaphone, ni contrôle social, ni file d'attente instituée.
La Cité des Métiers est un système vivant, en symbiose avec son environnement et les différents réseaux d’insertion, d’orientation et d’évolution professionnelle dont elle constitue une part. Rien n’y est figé de manière pluriannuelle, sauf la charte qui fixe qu’elle est ouverte et pensée pour tous, multisectorielle, anonyme, multimodale et multimédia et bien sûr centrée sur les besoin de ses usagers : elle est en fait entièrement dépendante de son public et des douze partenaires qui la constituent. Elle est donc par construction très adaptable et au bout de 10 ans, de multiples adaptations ou améliorations ont eu lieu. En revanche, le découpage en pôles est resté très stable : comme cela a été déjà signalé, nous avons vécu deux modifications seulement : l’individualisation de la fonction " créer son activité ", et l’élargissement en deux étapes du pôle consacré à l’évolution : " changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis " , seconde modification, il faut le préciser, conduite en résistant à une injonction forte des pouvoirs publics de créer un pôle séparé " valider ses acquis " comme s’il s’agissait d’une demande en soi alors que nous considérons que c'est un des moyens d'un ensemble au service de l'évolution professionnelle. On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que ce qui motivait ce souhait pressant n’était pas exempt d’enjeux institutionnels.
(voir sur ce site des articles concernant spécifiquement la cité des métiers)
En bref, la première des particularités essentielles de ce dispositif est qu'il est co-animé par des partenaires [75] qui ont mis là ensemble leurs ressources pour répondre à un besoin social commun : il s'agit d'une mutualisation de moyens au service d'une meilleure insertion et évolution professionnelle des individus. La seconde particularité de la cité des métiers est d'être centrée sur les besoins des usagers, pensée pour l’empowerment. L'espace et la signalétique sont organisés autant que faire se peut en suivant la hiérarchie des préoccupations des individus. Toute proposition (conseil, outil, événement) est conçue et présentée en liaison avec un objectif qu'elle permet d'atteindre. Ainsi, les conseillers des diverses institutions oeuvrent-ils sous des enseignes indiquant une préoccupation, comme "changer sa vie professionnelle" ou "créer son activité" par exemple et non des logos d'institutions ou des mesures administratives.. Cette plate-forme remplit de manière mutualisée trois fonctions nécessaires et complémentaires aux réseaux des services de l'emploi, de la formation et de l'orientation. En amont, elle est à la fois aiguillage et vitrine ; en aval, elle est "service consommateur" et n'assure pas de suivi individuel. C'est l'usager qui reste intégralement propriétaire de ces démarches. La cité des métiers complète donc les lieux habituels des réseaux, comme les CIO, les ALE, les missions locales, les centres de bilan et autres points "entreprendre en France" sans faire double emploi. Elle se différencie en cela radicalement du traditionnel concept de "guichet unique", qui lui réunit en un même lieu les services habituels des différents réseaux, dans une simple logique de regroupement géographique. Les institutions et les personnels qui la co-animent y développent d'ailleurs de nouvelles façons de travailler et de nouvelles compétences, qui transforment les métiers traditionnels des divers conseillers à la vie professionnelle [76].
D.3.3 Le développement du réseau en dehors de tout lien avec les réseaux de culture technique
Finalement, une Cité des métiers semble donc un outil pertinent comme moyen de favoiser des logiques de formation tout au long de la vie. Alors, pourquoi de tels équipements ne sont pas plus fréquents ? Ne devrait-il pas y avoir de multiples dispositifs de sensibilisation, d'information, voire d'élaboration de parcours professionnels en complément des réseaux et systèmes curatifs où l'on ne se rend hélas que sur prescription, et encore à reculons ? Les nouvelles médiathèques publiques qui ouvrent leurs portes dans les grandes métropoles ne devraient-elle pas, presque par construction, comprendre des espaces de service à la vie professionnelle ?
De fait, ce concept a suscité l'intérêt de plusieurs partenaires territoriaux qui souhaitent s'en inspirer pour créer des plates-formes respectant les mêmes principes. Une quinzaine d'équipes projets inter-institutionnelles se sont constituées et neuf d’entre elles ont déjà ouvert des plates-formes inspirées de celle de La Villette, dont quatre en France (Nîmes, Ploufragan, dans les côtes d'Armor, Belfort et Guadeloupe), trois en Italie (Milan, Gènes, Cagliari en Sardaigne), une au Bresil (Belo Horizonte dans l’état des Minas Geraïs), une en Espagne (Barcelone) et des préfigurations viennent de se mettre en place de celles du Tyrol en Autriche et de Tarente dans les pouilles italiennes.
Parallèlement, la CSI a formalisé le concept de cité des métiers en créant un label, correspondant au respect d'une charte et d'un cahier des charges, attribué par un comité de labellisation. Dans ces documents, une cité des Métiers se définit comme un lieu multi-publics, multi-partenaires, multi-usages (tous les modalités de consultations et d'information) et multi-thèmes (tous les aspects de la vie professionnelle, tous les secteurs). Ils précisent également qu'elle doit être centrée sur les usagers et en accès libre et gratuit. Plusieurs autres projets de plates-formes bénéficient également de ce label "cité des métiers en projet", dont celle de Porto.
Dans les autres Cités des Métiers ouvertes, on retrouve bien les mêmes types de pôles que dans celle de Paris, mais pas exactement les mêmes intitulés, ce qui peut être vu comme révélateur de différences de découpages ou de réalités sociales, voire de cadres ou de choix institutionnels, ainsi aller vers l'emploi, ou chercher un emploi peuvent se substituer à trouver un emploi , découvrir les métiers à choisir son orientation. Bien sûr les disparités nationales ou territoriales ont aussi créé des différences de positionnement : ainsi, les cités des métiers françaises ne produisent pas leur propres contenus, contrairement à la plupart des autres (Italie, Barcelone, Brésil) : en France, les documentalistes ont plutôt à faire face à une pléthore de sources alors qu’ailleurs il s’agit plutôt d’en créer. Mais, globalement, on peut dire aujourd’hui que notre système de labellisation a bien fonctionné et Les Cités des Métiers on bien respecté un concept qui, au-delà du guichet unique, consiste à mutualiser, hybrider dans un même lieu ouvert des fonctions complémentaires qui s'exercent avec des métiers différents.
Et ce qui est sûr, c’est que ces différences professionnelles survivent vivacement pour le plus grand bien des utilisateurs. D’ailleurs quand on regarde le quotidien d’une Cité des Métiers, quand on interroge les conseillers du pôle choisir son orientation qui sont des COP, ils disent que l'important c'est que les gens repartent avec des questions, quand on interroge nos collègues du pôle trouver un emploi ils disent évidemment l'important c'est que les gens repartent avec une réponse. J’ai d’ailleurs l'impression que si je demandais à nos amis de changer sa vie professionnelle, -surtout depuis la VAE- ils nous répondraient que l'important c'est qu'ils partent à la fois avec des questions et des réponses…
Cela dit, le fait que les cinq pôles n'aient pas fusionné n'est pas seulement une leçon sur la spécificité des professions de conseil, mais résulte aussi de la divergence des angles de regard et de mise en mouvement dont la société à besoin sur la vie professionnelle : adopter naïvement une volonté de regarder de manière unique la question de l’information conseil sur un tel sujet ne suffirait pas pour permettre toutes les résolutions socialement nécessaires. A la cité des métiers, on a essayé de la classer la documentation disponible sur les métiers simplement par secteur, en suivant un découpage unique, univoque. Or, les éditeurs, le CIDJ, l'ONISEP, le ROME , les conventions collectives, les éditions privées, l'Etudiant ... respectent chacun des logiques propres ; force est de constater qu’elles divergent souvent : le découpage des bases d’offres d’emploi, des atlas de la formation initiale, des diplômes, des accords sociaux sont loin de se correspondre et un index croisé entre Onisep, Rome, Actuel Cidj et Conventions collectives n’est pas pour demain en raison de la non équivalence des thésaurus de ces quatre principales "encyclopédies des métiers" françaises. Présenter l'organisation des professions selon le système éducatif, n’est pas équivalent à les présenter selon le résultat des négociations sociales pour les conventions collectives et il y a une troisième logique qui est de présenter selon les volontés, tout à fait respectables d'ailleurs, de lobbies corporatistes pour faire exister telle ou telle réalité professionnelle.
La situation de l'individu fait qu’il a -à un moment donné- besoin de tel ou tel angle de réponse ; les pôles d’une Cité des Métiers respectent la segmentation des métiers de conseil en place publique, métiers qui sont fragmentés, mais aussi la variété sociale non réductible à un seul angle de regard sur la vie professionnelle.
D.3.4 Les cités des métiers : quelques difficultés à courir plusieurs lièvres à la fois
A La Villette, la cité des métiers se propose d'atteindre plusieurs objectifs complémentaires. D'une part, elle doit être directement utile à ses usagers, en les rendant plus acteurs de leur vie professionnelle ; d'autre part, elle se propose de les amener dans une logique d'anticipation et de développer leur curiosité culturelle. Pour clarifier la situation par rapport à cette seconde ambition, on peut découper ce rôle de marche-pied culturel en trois fonctions complémentaires.
Une première fonction consiste à aider les usagers à oser considérer plus que l'urgence. Venant pour trouver un emploi ou une formation, un usager devrait pouvoir aussi entreprendre une réflexion à plus long terme comme changer sa vie professionnelle ou créer son activité par exemple. Dans les faits, on observe que les usagers sont très nombreux à faire des allers et retours entre plusieurs pôles, lors d'une ou plusieurs venues à la cité des métiers. C'est sans doute au moins autant les entretiens avec les conseillers que la lisibilité des pôles qui favorise ce passage de l'urgence à la construction d'un projet à plus long terme.
Contrairement à ce passage du court au long terme, de l'urgence à une construction de projet qui concerne l'offre interne à la plate-forme, la deuxième fonction "culturelle" consiste à donner aux usagers l'envie et les moyens de se documenter et de chercher "ailleurs". A la CSI, il s'agit particulièrement de les inciter à franchir un couloir et à utiliser les ressources de la médiathèque (revues, annuaires et études professionnelles, rapports d'activités et bien sûr documentation technique). Pour ce faire, une brochure est distribuée qui fait le lien entre les préoccupations individuelles et les différentes ressources documentaires de la CSI ; sous le nom d'ILE (pour Identifier, Localiser et Elargir ses recherches), elle sera bientôt doublée d'un système de recherche informatisé. Actuellement, un usager de la cité des métiers sur trois utilise aussi la médiathèque.
Quant à la troisième fonction culturelle, c'est celle qui doit conduire les usagers à découvrir et utiliser l'ensemble des ressources d'un aussi grand centre STI que la CSI, en particulier les expositions. La cité des métiers n'est là que la porte d'entré et au delà, les choses sont là plus compliquées, et ce pour au moins deux raisons. D'une part, les expositions sont payantes et d'autre part le lien d'utilité n'est pas immédiat. Cela implique qu'il faut baliser le chemin qui conduit depuis la plate-forme dont l'intérêt personnel est évident aux ressources proprement "culturelles".
Dans ce travail, force est de constater que nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux balbutiements. Fonctionne d'ores et déjà une "université ouverte de la société de l'information et des réseaux" sur financement FSE [77]. A partir de documentaires ethnographiques produits avec La Cinquième, elle propose de multiples débats sur les transformations du travail et de la formation liés à Internet.. Signalons aussi, cette fois pour des publics collectifs (demandeurs d’emploi et jeunes sans qualification), un programme de soixante "segments d'initiation aux nouvelles technologies" de trois jours chacun par an. D'autres outils sont en cours de mise en place pour consolider ce chaînon fragile entre construction de projet professionnel et acculturation technique et scientifique. C'est ainsi que des bornes permettront bientôt d'écouter des témoignages sur la vie et les évolutions professionnelles tout en se trouvant en situation dans les expositions. Sont prévus aussi bien des parcours par secteurs (automobile, métiers du son) que par problématiques ou thématiques (créer son activité, arts et techniques).
Plus globalement, nous travaillons sur l'idée de proposer à la CSI une "université ouverte" qui permettrait de se construire sur plusieurs mois, en fonction de ses objectifs, un parcours à la carte dans l'ensemble des ressources CSI. En amont des cycles habituels de promotion sociale ou de formation continue, elle pourrait permettre à ceux qui hésitent à en franchir le pas de se remettre le pied à l'étrier. Pour ce faire, en plus des expositions, événements, ateliers, lieux documentaires, didacthèques et autres bibliographies, elle devra proposer un bureau d'aide au choix de parcours. Sans doute est-ce seulement au prix d'un tel dispositif que de véritables objectifs d'ouverture culturelle pourront être atteints. Car attention aux pensées simplistes en la matière ! L’amalgame courant du “ développement de la culture scientifique et technique ” donne à réfléchir : ne devrait-on pas parler séparément de pratiques techniques d’une part et de méthode scientifique d’autre part ?
Clarifier le mariage entre l'action culturelle STI et les dispositifs d'insertion
L'histoire a fait qu'à La Villette, la cité des métiers vise deux finalités à la fois. D'une part celle d'être une plate-forme multipartenariale d'insertion et d'évolution professionnelle et d'autre part celle de servir de porte d'entrée vers la développement culturel STI. De l'extérieur, cette double ambition est difficile à saisir et à séparer . Elle obscurcit quelquefois des volontés d'essaimage de la cité des métiers et la mise en place de certains projets de plate-forme sont brouillés par l'inscription de celle de La Villette dans des objectifs culturels plus vastes. Il s'agit bien de niveaux différents et sur le terrain, on retrouve d'ailleurs les deux types: certains se fixent de purs objectifs d'insertion et d'orientation alors que d'autres reprennent les deux niveaux d'objectifs. La vérité est qu'aujourd'hui se pose simultanément le problème de l’ouverture culturelle et celui de l'insertion et qu'il a urgence à définir plus rigoureusement les objectifs croisés des politiques dans ces deux domaines .
Aller plus loin dans l’hybridation des acteurs
Mais c’est bien là qu’apparaît une des difficultés clés de la formation tout au long de la vie. Ces acteurs sont ils capables d’agir ensemble et de converger massivement ? Nous vivons dans des systèmes fragmentés. Les appareils administratifs s’organisent selon des découpages en voie d’obsolescence. Instruction publique initiale d’un côté, chômage et relations sociales de l’autre, beaux arts et patrimoine d’un troisième, sans oublier sports et jeunesse et bien sûr industrie, commerce artisanat et développement économique… Quelle place pour une véritable impulsion d’éducation permanente dans une telle tectonique des plaques ? Serions nous condamnés à de petites expérimentations là où le tissu local est clairevoyant ?
En réalité, c’est sans doute la vocation même de l’appareil culturel qui doit être interrogée aujourd’hui. Comment ouvrir massivement la responsabilité des acteurs culturels -au delà des beaux arts et du patrimoine- aux urgences culturelles d’aujourd’hui ? Comment inventer des modes de convergences succeptibles de se démultiplier ?
Faire le lien entre les avancées scientifiques et techniques et les préoccupations quotidiennes
Dans nos sociétés démocratiques, une des questions clé des politiques culturelles est celle de la lutte contre l'exclusion et de la réduction des inégalités. Cette question devient même cruciale lorsque sont construits ou aménagés d'importants bâtiments destinés au plus large public, comme des grands musées ou bibliothèques publiques. Si l'on n'y prend garde, ils peuvent finalement se révéler n'être fréquentés que par ceux qui ont déjà l'habitude et la pratique de tels lieux. Leur résultat social est alors l'inverse de celui souhaité : ces établissements fonctionnent comme machines à renforcer l'exclusion culturelle au lieu de la réduire. Face à ce risque, comment s'assurer qu'un équipement va effectivement être utile à l'ensemble des catégories de public, voire même plus particulièrement à celles qui présentent le plus de risques d'exclusion ? Sa politique d'ouverture aux divers groupes scolaires et son implantation géographique sont bien sûr déterminants, mais la nature même de son offre l'est plus encore ; la prise en compte des préoccupations de tous les publics visés dans sa conception est alors essentielle. Heureusement au moins que l’on a renoncé à vouloir faire de tels lieux des temples dédiés à la détection de l’élite future.
Lorsque qu'il s'agit d'action culturelle scientifique, technique et industrielle, le risque est particulièrement fort de renforcer l'exclusion. Il n'est malheureusement pas rare de devoir constater a posteriori que telle action ou tel équipement conçu pour tous les publics n'a finalement touché que ceux qui étaient déjà les plus passionnés et les plus culturellement nantis. Ne reste alors qu'à regretter d'avoir amplifier l'élitisme technologique. Si l'on se fixe au contraire comme priorité de réduire l'analphabétisme technique et scientifique, l'offre que l'on propose doit toucher aussi (et sans doute surtout) les publics qui ne fréquentent pas naturellement de lieux de culture STI. Quelle doit être sa nature pour qu'elle puisse amener ces publics, ceux qui n'y viendront pas par simple curiosité, à se préoccuper des évolutions STI ? Répondre à cette interrogation implique de partir des préoccupations individuelles : la vie professionnelle, la sienne ou celle de ses proches, apparaît alors comme l'un des domaines où chacun d'entre nous est confronté aux effets des évolutions STI.
Et ce d’autant que les représentations des lieux éducatifs et culturels comme lieux de mise à disposition de savoirs figés ne sont plus de mise. La chaîne éducative ne peut plus être regardé comme la remplissage de la tête de celui qui ne sait pas par le savoir dont dispose celui qui sait. On sait bien aujourd’hui qu’éduquer se réalise par une confrontation de représentations, dans un processus où la prise en compte des représentations préalables de l’apprenant est essentielle, autant que le sont les envies d’apprendre de tous les interlocuteurs.
Si l’on veut poursuivre dans cette logique d’ouverture, on peut aussi créer des cités de la santé, sur le modèle de la cité des métiers pour faire converger appareils d’éducation à la santé et de prévention, système d’accès aux soins, gestion des assurances maladies et lieux culturels…
(voir sur ce site les articles concernant la cité des métiers)
D.3.5 L'espoir de la Cité de la santé. La déception relative...
Dans le même esprit pragmatique de service individualisé, nous avons également décidé de développer l’offre de notre médiathèque médecine santé afin de compléter la réponse documentaire par des banques d’écoute et de réponses personnalisées.
Nous étions en effet confrontés à de multiples questions des publics démunis et en difficultés dans leur vie quotidienne. De nombreux usagers étaient porteurs de préoccupations aussi concrètes que se faire expliquer ce qu’à dit le médecin, comprendre en quoi consiste tel examen, tel traitement, telle analyse, se renseigner sur une maladie, un trouble psychique ou encore choisir une thérapie, un régime, un sport, prévenir des risques. Pour d’autres, il pouvait s’agir de rentrer en contact avec une association de patients qui pourrait les aider ou encore clarifier les démarches pour accompagner un proche malade ou handicapé.
Autant de questions pour lesquelles nous avions vite identifié qu’il serait fructueux d'allier aux compétences documentaires des médiathécaires, celles de professionnels de santé pour développer: le conseil et l'orientation en information santé.
Une association avec quinze partenaires de l’information santé
Pour mettre en place ce nouveau dispositif, avec le soutien de la Direction Générale de la Santé, nous nous sommes donc associés à une quinzaine d'organismes œuvrant dans ce domaine.
Ouverte de manière expérimentale de puis fin 2001, au sein de la médiathèque, la Cité de la santé est un espace de dialogue, d'information et d'orientation, en accès libre et gratuit. Ni lieu de soins, ni lieu de diagnostic, il s'adresse aux jeunes, aux adultes, aux enfants et aux parents ainsi qu'aux seniors. Pour faciliter les démarches dans la recherche d'information sur une pathologie, une thérapeutique, l'existence de lieux de soins, de prévention, d'accueil, la Cité de la santé s’est structurée en quatre grands thèmes distincts:
"Entretenir sa santé, prévenir",
"S'informer sur un problème de santé",
"Vivre avec une maladie, un handicap, accompagner un proche",
"S'informer sur ses droits".
L'accès à l'information s'effectue gratuitement dans le respect de l'anonymat et de la confidentialité des usagers. Sur place on trouve plusieurs points d’accueil, où l'on peut s'entretenir librement avec des conseillers en santé, professionnels venant de 12 organismes spécialisés.
On y a accès à près de 20 000 ouvrages et revues en libre service sur la médecine et la santé, couvrant le droit aux soins, l’évolution des connaissances biomédicales sur les pathologies et leurs traitements, les grandes questions de santé publique et d’éthique, les handicaps physiques et mentaux, leur prévention, leur prise en charge, le développement de la personne au cours des âges de la vie, la psychanalyse.
On y dispose également d’un espace de navigation multimédia en accès libre pour consulter une sélection de sites Internet, de cédéroms et de films consacrés à la santé, référencés dans le cadre de la plus grande collection de documents santé accessibles au grand public en France.
Enfin, une équipe de médiathécaires est présente en permanence pour aider dans les recherches documentaires.
Toutes ces ressources sont disponibles sans rendez-vous pendant les heures d’ouverture. Cet espace de conseils s'appuie sur une gamme de compétences complémentaires apportées tant par des professionnels que par des associations d'usagers, à savoir Aides Ile-de-France, le Centre Régional d’Information et de Prévention du sida, l’Institut National d’Education en Santé, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, le Comité de Paris de la Ligue Contre le Cancer, le Comité Régional d’Education pour la Santé d’Ile-de-France, les Etablissements publics de santé Esquirol, Maison Blanche, la Fédération Nationale d’Aides aux Insuffisants Rénaux, la Fédération NAtionale de Patients et ex-patients en psychiatrie, Sida info service, l’Union Nationale des Parents et Amis de personnes handicapées, l’Union Nationale des Associations Familiales, les associations “ Vie libre ” et Arémédia.
Une plate-forme partenariale au service des préoccupations des usagers
Une première étude des usagers de la cité de la santé a été réalisée à partir des questions des utilisateurs relevées au cours au premier trimestre 2002. Plus des deux tiers d’entre eux étaient des parisiens, un autre quart venait de banlieue (dont la moitié de la Seine St Denis). 54% étaient des femmes (50% sur le pôle Entretenir et 62% sur le pôle S’informer sur un problème). L’âge médian est d’environ 32 ans pour le pôle Entretenir et S’informer sur un problème et de 36 ans pour le pôle “ Vivre avec ”. Un tiers des demandes concerne des problèmes non pas du visiteur lui-même, mais de membres de sa famille : cette étude a en effet en particulier montré que la Cité de la santé est particulièrement pertinente pour l’information et l’écoute de problème de santé concernant les proches (famille, proches, voisinage, travail).
Des parcours mobilisant des modalités complémentaires d’information
Cette étude a également permis de conclure que la mutualisation, le découpage et les intitulés des pôles recouvrent bien les préoccupations, même si de nombreux chevauchements sont inévitables et si un premier accueil se révèle indispensable pour aller au devant de visiteurs souvent surpris, voire même quelquefois perplexe face à ce nouveau service.
Il est également apparu que la complémentarité des ressources (documentation imprimé, multimédia et médiation humaine) est particulièrement pertinente, mais que leur richesse impose une formation systématique de tous les intervenants s’appuyant sur des protocoles construits ensemble. Ainsi, plusieurs séminaires réunissant conseillers et médiathécaires ont eu lieu, en particulier pour affiner les principes déontologique et formaliser des protocoles de réponses. Il se précise ainsi que la fonction du lieu doit se définir comme “ informations et orientation ” en matière de santé et qu’une grande vigilance est nécessaire pour respecter un positionnement en amont de toute consultation.
En se rapprochant de la science et de son schéma de pouvoir, nous nous sommes éloignés du public.
D.3.6 La Cité de la santé comme analyseur de la Cité des métiers
Cette Cité de la Santé, nous l’expérimentons avec ma collègue Tù-Tam Ngûyen de la médiathèque depuis fin 2001 en étroit partenariat avec 15 organisations (Conseil de l’ordre, CRIPS, DGS, Etablissements publics de santé, INPES, Amicales de médecins retraités et de nombreuses associations de patients, comme AIDES, la Ligue contre le Cancer, Vie Libre, la FNAIR, la FNAP-Psy). Elle accueille des utilisateurs six jours sur sept : quatre pôles prévus dont deux qui marchent vraiment, un qui vivote et un qui devrait naître bientôt :S'informer sur un problème de santé, Vivre avec une maladie ou un handicap, accompagner un proche, Entretenir sa santé, prévenir, S'informer sur ses droits. Et alors là pour moi ça a été une découverte, renouvelée au quotidien, de constater à quel point le fait de piloter cette cité de la santé me fait prendre du recul par rapport à la réalité des métiers à la cité des métiers.
Ainsi, A La Cité de la Santé, les professionnels disent « ça va pas, on ne peut pas être appeler conseiller en santé, on voudrait des badges indiquant « orientateur », ou à défaut « conseiller en orientation » parce que la notion de conseil n'est pas assez claire, le conseil en santé pose un problème de déontologie insurmontable, nous ne conseillons pas en matière de santé, nous « orientons ». Le plus frappant, c’est que -dans les Cités des Métiers - si on mettait « orientateur » ou conseiller en « orientation » de manière indifférenciée sur tous les pôles il y aurait une émeute. Le mot qui marche pour désigner les professionnels de manière générique à la cité des métiers c'est « conseiller », alors que ce mot presque tabou à la cité de la santé.
Autre illustration de l’intérêt du parallélisme Métiers / Santé : sur « entretenir sa santé, prévenir » on retrouve une volonté et une dualité très similaire à celle de « choisir son orientation/découvrir les métiers » au lieu de nous aider à répondre aux questions de nos utilisateurs, de multiples institutions nous viennent voir à la cité des métiers en nous demandant de les aider à faire la promotion des métiers de tel ou tel secteur (travaux publics, paramédical, filières scientifiques…) ; en parallèle, le monde de la santé est dominé par une logique qui est très comparable à cette logique info métiers, on oublie l'éducation des choix et on fait de la campagne de prévention descendante, ce matin c'est la mammographie, demain c'est la journée mondiale de l'herpès et la journée mondiale du SIDA lundi. On ne trouve quasiment pas de partenaires à but non lucratif pour répondre aux demandes du public au rythme où elles vont et viennent. Ils veulent tous, et l’INPES en tête, agir par campagnes d’information thématique ; logique prophylactique oblige, semble-t-il.
Rien de très nouveau, la prévention semble bien être un système, -si je dis d'infantilisation, je vais me faire des ennemis-, qui oublie facilement la question de l'éducation des choix au profit du bourrage de crânes. Pourtant évidemment la question de l'éducation thérapeutique est une question essentielle en terme d'information santé, mais surtout quand on est déjà malade (et devenu « patient ») mais la question de la professionnalisation des métiers de l'éducation santé n'est pas clairement posée aujourd'hui, même si elle l'a été un peu par effet secondaire de l’arrivée d’emplois jeunes, éducateurs ou médiateurs de santé ; dans la récente période de canicule on est retombé dans d'autres urgences « faites les boire, faites les boire » (même si le risque du déficit en sels minéraux est oublié !).
Troisième illustration de cette fonction d’analyseur, celle-là liée aux différences de contexte sémantique de la « prescription ». A la Cité de la Santé , en garde-fou, est écrit partout qu'on n’y fait ni consultation, ni prescription . Voilà qui est destiné à être clair : pas question d’être un lieu de prise de décision. Par contraste, je me demande si on ne ferait pas quand même un peu de prescription à La Cité des Métiers? et si on ne serait pas un peu dans le cas où on décide à la place des gens. Réciproquement, la santé radicalise le problème de ce que l’on a le droit de dire : Va-t-on dire brutalement « le pronostic est vital ou mortel dans 6 mois dans 80% des cas ». En fait, on accorde la précision de ce qu'on dit à ce qu'on sent dans la question comme demande de précision. Déontologie à méditer en relation avec les perspectives adéquationistes en matière d’orientation professionnelle.
J'ai appris un mot essentiel en pilotant -avec les associations de santé engagées sur ces questions de droits des citoyens-, la mise en place de La Cité de la Santé : le mot empowerment, un anglicisme , un anglo-saxonisme même. Il n’a pas vraiment d’équivalent en français et désigne le contraire de l'infantilisation, l’en-pouvoir-ment ou l'émancipation si vous voulez. Il y a ici dans la salle des amis québécois je pense qu'ils connaissent le mot et son sens de contribuer au transfert de l'appropriation du pouvoir par l'individu lui même. La Cité de la Santé remet donc cette question de l’éducation des choix dans une perspective plus large que celle de l'orientation et de la vie professionnelle : entre prescription à un patient ou émancipation d’un concitoyen.
En bref, la Cité de la Santé se situe sur un champ social différent de la cité des métiers, avec des marges de manoeuvres différentes. Elle radicalise les problèmes et les interrogations générées par la cité des métiers. Quatre différences :
Sur son économie : faute de professionnalisation du "conseil" santé" en France, on trouve plus de volontariat individuel à la CDS et moins d’engagement institutionnel concret.
Sur sa sémantique : à la CDS on trouve "conseil" très connoté et chargé, donc ambigu et on voudrait qualifier toute l'activité de "orientation". ; dans les CDM françaises, c'est exactement symétrique.
Sur sa fonction d’autonomisation : à la CDS on va beaucoup plus loin sur la question de l'autonomie des individus. Un des maître mot c'est l'empowerment. La question des individus décideurs, non infantilisés est posée de manière plus radicale. Sans doute cela provient-il du fait qu'il y a à la CDS d’authentiques représentants des usagers (avec des associations dont c'est la fonction première, comme AIDES, la FNAPSY par exemple).
Son l’implication des professionnels: une supervision (au sens psychologique du terme), ou au moins des débriefings s’est vite révélée plus incontournable à la CDS ainsi que la nécessité de produire des guides de protocoles de réponse pour les conseillers.
Finalement en profitant de cet éclairage apporté par le rapprochement entre "éducation des choix", la fonction de "tenir conseil" et "l'empowerment" mis en exergue par certains acteurs de la santé, revenons à la question posée : « dans quel champ professionnel plus large s'inscrivent les métiers de l'orientation ? ». Pour ma part, je vois trois cadres de rattachement :
d'abord il y a le plus évident, déjà cité, qui est celui de la psychologie scolaire dans son ensemble.
on peut aussi les positionner dans un autre qui serait celui des métiers de l'insertion et du maintien dans l'emploi, ce qui correspond à les charger d’une logique plus socialement adéquationiste,
et ma troisième hypothèse, c'est dire que les métiers de l'orientation font partie d'un ensemble de métiers dont nous avons besoin pour que nos sociétés soient vraiment démocratiques. Cet ensemble, c’est celui des métiers de l’empowerment, qui ont pour but de rendre à l’individu la disponibilité de lui-même et de son avenir.
Bien sûr, cela sous entend de s’émanciper de la logique de prise en charge ou de contrôle de l'insertion et de l'orientation professionnelle. Avec quels appuis ? Les syndicats traditionnels peuvent-ils jouer le rôle de boucles de feed-back et des représentants des usagers de l'orientation tout au long de la vie ?
En France, le fait que le très récent accord professionnel sur le co-investissement de l'individu, instituant un « droit individuel à la formation » ait été signé à l’unanimité par tous les partenaires sociaux est significatif. Il va sans doute mettre plus que le faisait la précédente loi de 1971, le bénéficiaire, l’usager, le citoyen au centre et donc théoriquement en maîtrise du processus de décision, tout comme la toute récente loi sur le dossier médical fait sortir le « patient » de sa traditionnelle position d’attente. Il faut dire que l’on partait de loin. Dans la loi « formation professionnelle » de 1971, l’individu ne signait même par son propre contrat de formation : on était loin du co-investissement et de la co-responsabilité… Voilà donc peut-être un terreau favorable pour effectivement positionner les métiers de l'orientation comme s’inscrivant en sous ensemble des métiers de l'empowerment.
Et comme en témoigne la mise en place de ces cités de services centrées sur les préoccupations des citoyens, pourquoi ne pas aller -plus globalement- de l’empowerment vers des stratégies culturelles nouvelles, celles des médiations ascendantes, par opposition (ou symétrie) au schéma dominant des injonctions, prescriptions et vulgarisations descendantes qui dominent encore beaucoup nos schémas éducatifs et culturels ?
… fructueuse confrontation de deux dispositifs parallèles d’empowerment : la question de la propriété de son corps et de sa gestion se gère-t-elle de la même façon que la question de la propriété de ses compétences et de son avenir professionnel ? On peut aussi imaginer , selon la vieille idée des boutiques de sciences des cités du consommateur de technologie… Alors à quand de telles plates-formes ? A quand des lieux culturels qui se définiront comme des offreurs de services aux clients et usagers du progrès ?
Les autres cités de services (bricolage, mp3...) reconnecter avec les pratiques techniques, retrouver les acteurs sociaux concernés par l'éducation populaire scientifique, mais là vraiment dans une logique d'empowerment.
D.3.7 D'autres pistes de MCA ?
On peut aussi s'interroger sur le lien des MCA avec les travaux sur la "dramatisation" du récit scientifique, tel que ce concept a été proposé en 1987 par le club scientifiction autour de Denis Guedj, Isabelle Stengers, Francoise Bastide et al. On peut aussi faire le lien avec des stratégies d'empowerment scientifique et technique, comme celles des ateliers participatifs sur lesquels travaille J.-P. Natali et qui s'inspire des pratiques (danoises ?) d'associations des profanes à des choix scientifiques.
A contrario, il nous semble que les pratiques d'échange des savoirs, comme elles sont par exemple définies par Claire Hebert-Suffrin, ne recouvrent pas systématiquement des MCA. Le concept des échanges de savoirs consiste à alterner des pratiques de "fourniture" de savoir, sans imposer forcement une autre posture par rapport au contrôle de la médiation. Tout au plus peut-on faire l'hypothèse que cette alternance sachant / profane doit favoriser un co-contrôle des processus de médiation. Il en va de même en ce qui concerne les débats publics, même à l'initiative des partenaires sociaux, comme ceux organisés dans la mouvance de l'association ASTS. Malheureusement, force est de constater que la participation des syndicalistes à un débat ne garantit en rien la modification de la posture par rapport au savoir. Le concept d'expert a une forte résistance, même en regard de la tragédie AZF.
D.4.
S’engager pour une autodidaxie fondée sur le contrôle de
sa propre construction des savoirs
Qui contribue vraiment à éviter que la science soit perçue comme une religion ou tout au moins un système (dogmatique) dans lequel on doit avoir foi, et qui fournit des "biens de salut" (Heilsgüter, pour reprendre l'expression de Max Weber) ?
Et d’ailleurs peut-on vraiment y arriver ? Et la sacralisation de la science dont nous nous rendons en réalité complices est-elle une catastrophe ou un moindre mal ? En notre âme et conscience, est-on capable de dire s'il vaut mieux une culture scientifique dogmatique plutôt que pas de culture scientifique du tout. Tout dépend de la finalité idéologique et sociale... Bien sûr, pour ma part, je réponds non... Mais constate que toutes mes actions collectives finissent par ressembler à des formes sournoises de dogmatisme...
ANNEXE 1 : Texte de E-E Baulieu cité par Hamelin
Extrait de l’intervention de Etienne-Emile BAULIEU, Président de l’Académie des Sciences, intervention prononcée lors de la séance solennelle de rentrée des cinq Académies, sur le thème : « Changements de la science, progrès pour l’Homme ? ».
« L’Homme domine le monde vivant, grâce à la science. Celle-ci progresse sans nul doute, mais soudain une question surgit : ses changements contemporains seraient-ils devenus contre-productifs ? Comment cette science plus féconde que jamais, si spécifique de notre espèce, peut-elle être mise en examen au tribunal du progrès humain ?
L'humanité est-elle devenue hypocondriaque pour douter à ce point de sa santé collective ! Le sentiment de progrès est un sentiment de confiance ; aujourd'hui le doute a remplacé la confiance. Pour nous scientifiques, l’activité de la science vise à comprendre : comprendre le monde, comprendre le destin de l’homme et participer à son questionnement métaphysique.
Nous, scientifiques, savons combien notre condition humaine, équilibre entre le corporel, le cérébral, le spirituel est à la fois vulnérable et aléatoire. Nous savons que nous ne savons pas prédire l’avenir de notre espèce, et peut-être est-ce la grandeur de notre condition humaine. La première perception du progrès tient aux différents usages de la technique : des améliorations concrètes, immédiatement utiles. Le génie de l’homme, son infatigable manie d’essayer, l’ont conduit à voler le feu, à capturer le vent, à semer des graines, à inventer la roue… à « faire » avant de comprendre, à agir avant d’analyser, et bien souvent la technique a interrogé et stimulé la recherche fondamentale par ses observations. Dans l’histoire de l’humanité, la technique a souvent précédé la science. Mais, naturellement aussi, la technique accompagne la science et fréquemment lui succède en concrétisant ses concepts et en appliquant ses découvertes. La science et ses applications ont engendré deux percées refondatrices de la condition humaine : d’une part l'extraordinaire développement des moyens de communication, qui abolissent les distances entre les hommes ainsi qu’entre les cultures, et, d’autre part, l’implacable accroissement jusque-là silencieux de la longévité humaine.
Le doute qui saisit l’époque me paraît lié au double sentiment de pouvoir et d’impuissance qu’a l’homme vis-à-vis de la nature et de lui-même.
Le sentiment de pouvoir est sans doute né des interrogations et des craintes sur l’usage de l’énergie nucléaire : l’homme maintenant craint son propre pouvoir. Il a désormais plus peur de lui-même que de la nature ! Or, depuis l’origine, les phénomènes naturels ont menacé de très près les hommes.
L’homme a réussi à résister, se protéger, et même à utiliser bien des forces de la nature : le feu, l’électricité, l’atome… La science a libéré l’homme de ses peurs, de ses superstitions d’une nature enchantée car la science donne à voir la nature comme indifférente. C’est en quelque sorte un libre arbitre conquis par rapport à la nature.
Mais désormais l’homme s'interroge : saura-t-il protéger la nature de lui-même et de ses excès ? Certains redoutent que l’activité des hommes n’altère notre environnement, notre climat, nos océans, notre atmosphère, ne les fragilise, ne les prive de leurs possibilités de régénération. Au point qu’ils s’interrogent pour savoir si notre développement est durable, ou s’il faut en changer. La question du rapport de la science avec la nature est au coeur du doute actuel sur les progrès de la science et se pose en des termes nouveaux à propos du monde vivant, animal et végétal. À partir de l’exemple des organismes génétiquement modifiés, les O.G.M., je voudrais illustrer la passion et la difficulté des rapports de la Science avec le sentiment de progrès.
Voici que vient de commencer la grande aventure de la maîtrise des éléments fondamentaux du vivant, avec la découverte de l’arrangement de l'A.D.N. des gènes. « Maîtriser le vivant » veut dire que l'on sait de mieux en mieux isoler, découper, recombiner, transférer cet A.D.N. des gènes.
Dans le cas des O.G.M., les caractéristiques du monde végétal peuvent être directement soumises à notre volonté : créer des plantes qui ont un meilleur rendement, qui résistent mieux au froid ou au chaud, à l'eau ou à la sécheresse, à certains pesticides, qui peuvent empoisonner spécifiquement les prédateurs animaux, créer des plantes qui se conservent mieux… Or le sigle O.G.M. est mondialement stigmatisé, plus encore que les produits euxmêmes. Quel affreux symbole, cet été au Larzac, d'avoir mis en avant des centaines de volontaires prêts à les faucher ! Pourquoi tant de haine ?
Cette violence est à la mesure de la peur, de l’ignorance et de l’idéologie. Cette peur, on peut la comprendre tant il s'agit d'un tournant, d'un grand changement de la science : fondamentalement, on détourne sciemment le « naturel ». À la vérité, ce que nous appelons « naturel » évite de se souvenir que, par sélection et hybridation, les hommes avaient depuis des millénaires, modifié des espèces végétales au fur et à mesure de leur histoire, et selon leurs besoins alimentaires et culturels.
Cette découverte théorique de la maîtrise des gènes inquiète : en suscitant une alternative à la sélection darwinienne, la science fait accéder l'homme à un niveau jusque-là réservé à l'obscur dessein de l'évolution, si ce n'est à une puissance divine plus ou moins redoutée.
Cette inquiétude a pour première réponse la méthode de critique et de doute qui gouverne la science. C'est parce que son propos est de conquérir le savoir qu'elle est suspectée d’arrogance. A-t-elle la tentation du pouvoir ? Les hommes de science d'aujourd'hui ne sont pas, contrairement à l’image du positivisme d’Auguste Comte, les adeptes du «tout-scientifique », pas plus que d’un quelconque « tout-économique ». Ils savent que ce sont les croyances, les valeurs morales, politiques, culturelles
et affectives d’une époque qui déterminent le bon ou le mauvais usage des découvertes.
Après la peur, l’ignorance. L’exemple d'un nouveau maïs, le « maïs-t» illustre bien un malentendu qui repose d'abord sur une mauvaise compréhension du mécanisme en cause et des objectifs poursuivis. Dans «maïs-t », le « t » représente l’élément génétique d'une bactérie (bacillus
thuringiensis) qu'on ajoute à l'A.D.N. du maïs (c’est l'objet de la modification O.G.M.) et qui permet la synthèse d'une protéine tueuse de la chenille pyrale, ennemie du maïs. Le maïs ainsi modifié, la récolte sera épargnée par la chenille. La méthode plus traditionnelle est l'utilisation complexe et polluante d'insecticides qui, certes, sauveraient la récolte, mais qui causeraient d’autres effets négatifs sur l’environnement. L’histoire des insecticides, du D.D.T. aux pastilles enrobées qui menacent nos abeilles, est celle d’un équilibre entre les avantages pour les récoltes et les inconvénients pour l’environnement. Les méthodes ont évolué, sans qu'il faille ostraciser ou diaboliser l’une plutôt que l’autre. Comment sauver aujourd’hui ces nouveaux êtres de la famine sans une nouvelle révolution agraire ?
La révolution des O.G.M. est un progrès indispensable. Ceci ne veut pas dire que notre confiance doive être aveugle. Dans le cas d'espèce, la science se doit de prévoir l’apparition et la multiplication d'insectes résistant au gène si efficace contre la chenille : pour se débarrasser de ces mutants, il faudra encore plus de recherche pour détecter et circonvenir cette évolution possible. Il faut conserver des champs de maïs non transformés et prévoir des O.G.M. en quelque sorte « alternatifs ». C'est la science évolutive dans la société, au service d'une humanité plus nombreuse et qui vit plus longtemps.
Ce qui est fascinant avec les O.G.M., c'est l'implication conjointe des éléments essentiels de la matière vivante – les gènes, aussi redoutés qu'incompris – et de nos comportements parmi les plus fondamentaux, ceux liés à notre alimentation. Les ressorts de ces comportements sont, pour chacun de nous, enracinés familialement, culturellement. Ils s’inscrivent même parfois dans une tradition religieuse. Dans notre pays, l'alimentation a fait de la gastronomie un des beaux arts. Son impact sur notre santé est mieux établi que jamais. Notre nourriture fait partie intégrante de notre personnalité.
Il semble aussi difficile de se faire aux O.G.M. au début du XXIe siècle, que de monter dans les trains au milieu du XIXe, où l'on craignait de mourir dans les tunnels, ou d’installer des fils électriques dans les églises après la découverte de Franklin, alors qu'ils étaient considérés comme
blasphématoires. Après la peur et l'ignorance, voici enfin l’idéologie : ceux qui s'opposent violemment aux plus précautionneuses recherches sur les O.G.M., et le font avant même de connaître le résultat des expériences. Ainsi le nécessaire débat entre la science et la société se trouve faussé et obscurci. Il est pourtant urgent de montrer, de donner à voir ce que sont ces découvertes, et de débattre de leur utilisation. Il importe de ne pas faire du principe de précaution un principe de suspicion ni une pratique d'inaction, mais de rechercher, vérifier, contrôler, sans négliger aucune critique, et d'être toujours prêt à des solutions différentes. C'est le devoir d'humanité et la responsabilité politique des scientifiques dans la Cité…
…Comment ces changements et ces progrès influencent-ils notre bonheur, personnel, amoureux, familial ? Je crois qu'avec le feu, l'électricité, les antibiotiques, nous sommes plus heureux que les hommes qui dessinèrent Lascaux : nous avons plus de temps à vivre, pour être libre et pour aimer. Mais leur art nous parle et nous touche : le continuum entre nous tient sans doute à l'affectivité, à l'imaginaire, aux désirs, qui ne se résument pas à des conditions de vie, à des savoirs. Nos progrès nous déterminent : ils ne nous définissent pas. On pourrait aujourd'hui avoir la tentation de s'en tenir aux acquis d'une humanité qui dispose déjà de tant de moyens pour mieux vivre, et choisir de mieux les partager. Je comprends ce sentiment, cette intuition qu'il faudrait marquer une pause.
Mais il ne faut pas compter sur un palier de l'évolution scientifique, sur un moratoire du changement : c'est une hypothèse totalement irréaliste – et bien des conservateurs tranquilles, qui ne me sont pas antipathiques pour autant, vont le regretter. L'homme invente, veut savoir toujours plus, qu'il s'agisse du climat, des planètes alentour, des possibilités de vie prolongée en bonne santé et pleine lucidité. C’est irrépressible. Aux hommes et aux femmes, à leurs représentants, à leurs civilisations, d’en faire des bonheurs, d’accompagner ces percées, et d’inventer les règles de vie qui en feront des progrès pour le genre humain ».
ANNEXE II : Introduction du plan Aillagon
« La Science et la Technologie sont trop souvent présentées dans les médias comme étant essentiellement sources de problèmes : on ne parle que rarement de la première pour montrer que son rôle est toujours nécessaire pour révéler et comprendre ces problèmes, ni de la seconde pour dire qu’elle peut apporter des solutions, lesquelles sont ensuite mises en oeuvre, ou ne le sont pas. On oublie qu’Internet ou le téléphone portable sont des conséquences du travail de physiciens, et les immenses succès de la science finissent par créer une sorte de saturation de l’émerveillement, tout en laissant subsister l’inquiétude. Au Québec, on essaye d’attirer des enseignants étrangers afin de les recruter dans les Universités, grâce à une dispense de tout impôt sur le revenu pendant cinq ans.
Un million de personnes ont participé en 2003 à la Fête de la science. La Cité des Sciences et de l'Industrie a franchi l'an passé le seuil des 3 millions de visiteurs. Les clubs de loisirs scientifiques rencontrent un vif succès partout où il s'en crée. Des ouvrages de vulgarisation scientifique connaissent une grande réussite. Près de 9 millions de téléspectateurs ont vu le film L'Odyssée de l'espèce. Il en va des Français comme des autres Européens, dont la moitié déclarent un intérêt pour la science et la technologie. Dans le même temps les manifestations du progrès scientifique suscitent un certain scepticisme, voire de la méfiance. Les Européens portent un regard désenchanté sur les sciences. Les risques nouveaux associés aux avancées technologiques sont aussi présents à leur esprit que les progrès liés à l'innovation. Face à l'évolution très rapide des techniques et des sciences, les citoyens manquent de repères pour comprendre le monde qui les entoure.
L'ambition économique de la France nécessite de plus en plus l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. Or les vocations scientifiques reculent. Les inscriptions dans les filières de sciences de la matière diminuent par exemple de 4 % par an. S'interroger, s'intéresser aux sciences est une chose. Affronter la matière aride de la science, accepter les règles strictes de la démarche scientifique en est une autre. Le découplage entre l'intérêt ludique pour les sciences et l'engagement dans un métier scientifique n'est cependant pas une fatalité. Par exemple, l'organisation par l'Allemagne en 2000 d'une « Année de la physique » a réussi à inverser la tendance, jusqu'alors à la baisse, des inscriptions d'étudiants en sciences physiques et en astronomie. Elle s'est maintenue depuis à la hausse. Le partage des connaissances, la diffusion du savoir et des enjeux de la science est une demande très forte de nos concitoyens. Les questions scientifiques sont en effet entrées au coeur du débat politique et citoyen : réchauffement climatique, clonage humain, OGM… Ces débats ne peuvent demeurer réservés à une minorité d'experts. Le rôle incontournable des sciences et des techniques dans notre société, mais aussi dans notre vie quotidienne, de plus en plus structurée par des innovations, exige la mise en place de relais adaptés auprès du grand public. Il s'agit de diffuser des informations, des repères, des clefs de compréhension du monde pour un public varié. Au fil du temps, un foisonnement d'institutions, de produits éditoriaux, d'associations et de services se sont mis en place qui participent à la diffusion d'une culture scientifique : musées scientifiques, associations de loisir scientifique, organismes de recherche, médias, bibliothèques… Les collectivités locales et les associations ont très souvent joué un rôle majeur dans l'émergence de projets de culture scientifique et technique. L'Etat doit savoir accompagner ces acteurs, en fonction de leur diversité et de leurs spécificités. Le plan national pour la diffusion de la culture scientifique s'articule donc autour des principaux relais de culture scientifique auprès du grand public.
Sous titre : mise en culture de la science et préoccupations profanes, un acteur sur le fil du rasoir entre mystification et partage.
Posture : analyse par un acteur de la médiation scientifique de trente cinq années de pratiques, de leurs ambiguïtés et des obstacles à la persévérance.
Questions concrètes : nos actions peuvent elles favoriser l’appropriation de méthodes et démarches scientifiques d’investigation et de modélisation ? Permettent-elles de développer les démarches expérimentales et l'esprit critique ? Peuvent-elles répondre à des préoccupations formulées par nos concitoyens ?
Ce texte est aussi un travail d’objectivation de plusieurs hypothèses :
mettre en question le dogmatisme implique de savoir distinguer croyances, convictions et savoirs étayés (par l’observation de la régularité des phénomènes ou le raisonnement logique) ; il en va de même pour tout dialogue constructif interculturel,
un système d’instruction publique privilégiant sélection et formation des élites productrices de la techno science normale discrédite aux yeux du plus grand nombre esprit et méthodes scientifiques
ce système instaure une coupure entre filières scientifiques et littéraires dont on peut se demander pourquoi il se maintient, si ce n’est pour produire des ingénieurs et scientifiques inféodés aux paradigmes dominant à fin de les rendre les plus économiquement fertiles
toute implication humaine, tout travail de recherche présuppose des convictions et des croyances.
Dans son texte "Is Technology Historically Independent of Science ? A Study in Statistical Historiography" (1965), Price pense que "l'on peut tracer un spectre allant de la science pure à la pure non science, mesurant et disposant selon magnitudes décroissantes la proportion de citations de front de recherche à celle de citations d'archive" [187]. Ce qu'il expose cinq ans plus tard dans "Citations Measures of Hard Science, Soft Science, Technology and Nonscience" (1970). Il est question ici de faire la distinction entre "science dure, science molle, technologie et non science" grâce à la mesure des citations. Price explique que le problème à résoudre est de savoir "ce qui distingue l'information scientifique, dans son contenu, de tout autre information" [188]. Utilisant toujours le Science Citation Index, son intention est de diagnostiquer si "un champ de connaissance agit comme "science" ou comme "non-science"" [189].
http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d02/2polanco3.html (texte de Polanco, INIST ?)
En fait, ce qui importe le plus c'est de voir la proportion entre cette "immédiateté du front de recherche" (research front immediacy) et "l'usage normal de l'archive" (the normal archival use of the literature). A cet effet, Price propose de prendre en considération comme un indice empirique raisonnable "la proportion des références qui sont faites de la littérature des cinq dernières années" [205] et que lui-même appelle "l'indice de Price" ; la convention est ici qu'au-delà de cinq ans l'effet d'immédiateté caractérisant le front actuel de la recherche est pratiquement nul.
Encore un mot à propos de l'obsolescence, étant définie en 1974 par Line et Sandison comme le déclin en validité ou utilité de l'information au cours du temps (decline over time in validity or utility of information), elle est un sujet intéressant la bibliothéconomie ; mais il semble que les résultats obtenus sont trop imparfaits pour qu'ils représentent une aide à la gestion de bibliothèques ; telle est au moins l'avis de Kaye Gapen et Milner dans leur évaluation de la question, dans le numéro spécial de Library Trends (1981) consacré à la bibliométrie [206].
1A.1
 10. L'indice
de Price.
10. L'indice
de Price.
Cet indice est le pourcentage de références datées dans les cinq dernières années. A part les quelques cas aberrants, l'utilisation de cet indice est un outil de diagnostic pour déterminer si "la croissance se fait à partir de l'épiderme plutôt qu'à partir du corps". Un indice faible est le signe que nous avons un type de métabolisme qui est propre aux humanités [207].
Selon l'avis de son auteur, "l'indice de Price semble correspondre très bien avec notre intuition au sujet de la hard science, de la soft science, et de la non-science lorsque nous descendons dans l'échelle" [208]. Dans un échantillon de 154 périodiques, la physique et la biochimie présentent des indices de 60% à 70% ; les périodiques des sciences sociales se situent à mi-échelle entre 40% et 50% ; et la "non-science" se trouve en bas de l'échelle, ce sont les périodiques qui ont un indice très faible, plus bas que le quartile inférieur [209]. Son interprétation est que les revues avec un indice plus élevé que le quartile supérieur sont sans doute une variété de la science dure, et celles avec un indice supérieur à 60% sont juste celles où tous les symptômes de la compétition, la mode et les collèges invisibles sont évidents [210].
Price déduit également de cet indice une prescription concernant le système d'information. On pourrait à l'aide de cet indice savoir si l'on gère une archive, une bibliothèque, ou bien une véritable base de données de la littérature la plus avancée des fronts de la recherche. "Si le gens écrivent des articles avec un indice de Price bas, on doit juste maintenir une bibliothèque d'archive ; si au contraire ils écrivent des articles avec un indice de Price élevé, c'est l'indication que le système d'information est plus actif et il correspond au front de recherche" [211].
Ceci s'accompagne de la conjecture sociologique selon laquelle "la science dure, la science molle, la technologie et la non-science" sont toutes des "systèmes sociaux différents", présentant chacun "sa machinerie particulière pour traiter les processus de publication et de communication entre les gens qui se trouvent dans les fronts de recherche, aussi bien qu'en arrière de ces fronts". Price suggère que "la compréhension de la science en tant que système social permettra d'éliminer la méconnaissance naïve qui entoure l'industrie de l'information scientifique" [212]. C'est la reconnaissance du besoin qu'il y a d'une sociologie des sciences dans l'analyse des systèmes de communication scientifique, et par voie de conséquence dans l'analyse des problèmes concernant l'entreprise de l'information scientifique (Price écrit : the business of science information).
Pour la définition du "programme fort" en sociologie de la connaissance scientifique, voir D. Bloor, Sociologie de la logique ou les limites de l'épistémologie. Traduit de l'anglais par D. Ebnöther. Paris, Pandore, 1982. Une approche sociologique de ce type en scientométrie est surtout développé par le Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI) de l'Ecole des Mines de Paris utilisant le programme LEX
